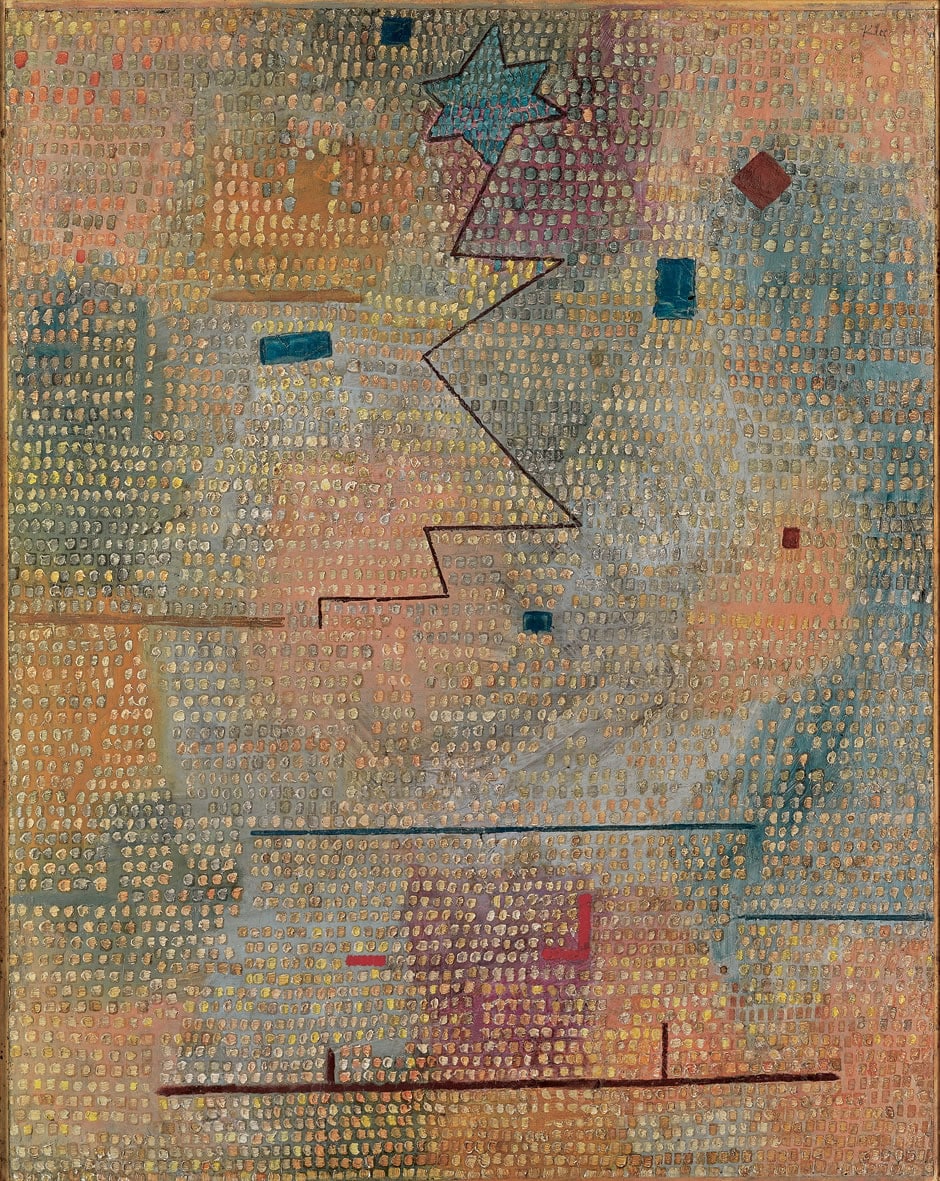Philippe Beck alterne régulièrement désormais la publication de livres de poésie et de livres de philosophie. La philosophie qui s’y déploie emprunte aux branches classiques de la discipline (morale, métaphysique, politique) mais lui en ajoute une, la ramification née du croisement de la politique et de la poétique. Dans La berceuse et le clairon, il travaille sur les liens entre littérature et société et sur le rôle que peut encore jouer l’écrivain pour l’existence même de la communauté.
Philippe Beck, La berceuse et le clairon. De la foule qui écrit. Le Bruit du temps, 496 p., 29 €
Si Platon chasse le poète de la cité, c’est par une mesure de salut public : son expression charmeuse risquerait de le tromper et le rythme de sa berceuse de l’endormir. Ce faisant, il fonde certes la philosophie comme science du général, mais il renonce à une chose : au risque d’une parole vraie, d’un discours authentique qui pourrait être porté par un individu particulier. La berceuse et la clairon sont les deux musiques de l’expression poétique qui d’un côté prend soin des peurs et de l’autre pousse des cris d’alarme.
Mais les choses ne sont pas si simples qu’elle puissent s’exprimer en une alternative. Ce n’est pas la berceuse ou le clairon, mais bien la berceuse et le clairon car dans toute expression qui cherche à se dire (clairon), il y a une élaboration, un rythme qui lui donne une forme (berceuse). Si la beauté et l’harmonie sont a priori du côté de l’envoûtement, les cuivres font aussi de la musique. C’est ainsi que se règle un rapport entre les deux, au-delà de leur opposition. Les choses ne sont pas si simples non plus car elles s’inscrivent dans une histoire, celle de sociétés qui n’accordent pas toujours la même place au poète et à sa parole pour la constitution de la communauté. Philippe Beck inscrit sa réflexion dans le fil de celles de Rousseau et du romantisme allemand qui rappellent que la parole authentique, pleine de la liaison étroite qu’elle noue entre l’humain et la nature, la parole vraie, ne peut exister que dans la poésie. Ce lieu d’une métaphysique sans la métaphysique, d’une vérité qui peut être exprimée dans l’écriture est précisément ce qui fonde la politique au sens moderne, c’est-à-dire que son ciment, sa soudure, peu importe la métaphore, se situe dans l’expression.
Mais Philippe Beck part d’une situation actuelle qui le contraint à faire deux constats. Voici le premier : le désir d’écrire n’a jamais été aussi partagé ni les conditions de faire de chacun un écrivain autant réunies. Il donne des chiffres : 55 000 écrivains publiants en France aujourd’hui. « Au sens large, il faut concevoir des centaines de milliers d’écrivants, des millions dans le monde, que ne peut accueillir le système éditorial habituel, serait-il celui d la publication en ligne. » Il ne s’agit pas de le déplorer mais de comprendre d’où vient cette multiplication et ce désir effréné, dont Montaigne était déjà très surpris en son temps. C’est le sens du sous-titre du livre : « de la foule qui écrit ». Car la foule n’est pas un peuple, elle n’est pas une communauté. Ce qui l’anime, c’est la rivalité des êtres, chacun enfermé dans sa pulsion d’expression. Lui manquent une éthique interne qui pourrait régler cette rivalité, mais surtout une éthique externe, pragmatique, qui apaiserait la peur entraînant ce besoin trop particulier pour être absolument nécessaire. Au sein de cette multitude, celui ou celle qui écrit par nécessité – en poussant le cri déchirant qu’il n’émet pas pour lui mais pour l’humanité tout entière – est en exil. Comme l’était le poète au XIXe siècle. Et il faut reconnaître à Philippe Beck, parmi toutes les choses puissantes qu’il pressent et qu’il exprime, de savoir créer des communautés par delà les époques (et le poète est peut-être cela, celui qui sait la contemporanéité qu’il a avec Baudelaire, Montaigne, Coleridge, Mandelstam), et de dire des choses sur l’exil, la migration, les mouvements actuels, extrêmement fortes, parce que pas seulement adossées à des explications sociologiques ou politiques, mais à des relations au dire, au vouloir-dire, à l’impossibilité de dire.

Philippe Beck © Philippe Matsas/Opale/Leemage
Le deuxième constat procède du premier : la multitude résiste à faire communauté. Elle entrave son devenir politique. Pourquoi ? Parce que la multitude, agrégat d’individus désirants et en rivalité, est dans l’oubli de la communauté, donc dans l’oubli de l’expression. Elle oublie que pour écrire il faut lire, et que le poète n’est pas seulement celui qu’on prétend devenir, mais aussi celui ou celle qu’on a lus. La berceuse et le clairon, en cela, est aussi un livre extraordinaire sur la lecture et sa capacité à créer du commun. Parce que nous vibrons aux émotions, aux peurs du passé et à ce que certains écrivains ont fait de ces émotions et de ces peurs, nous sommes capables de former une pensée commune, qui nous rassemble et qui donne une forme communément désirée au monde dans lequel nous vivons. Les deux parties qui composent le livre, l’une de réflexion, l’autre d’études sur la pensée de l’expression, dans laquelle Beck se confronte au cuivre sensible de Thoreau, au silence de Bartleby (fabuleux chapitre, au cœur du livre, sur ce que signifie ne pas dire), à l’inventive bibliothèque qui le possède et dont il sait nous rendre ce qu’elle lui a apporté, rappellent que nous ne sommes pas faits uniquement de ce que nous faisons, mais de ce que nous lisons et que la mémoire des liens est peut-être plus politique que les pseudo-gestes d’avenir. La force persistante des œuvres de langage, des œuvres expressives, doit continuer à nous rendre sensibles à ce que parler veut dire.
La lecture, en effet, ne cesse de nous inviter à rencontrer notre semblable. Et la poésie (ou la littérature, selon le mot que les époques ou les cultures emploient) ne cesse de nous enjoindre de prendre en charge les dangers de la communauté. « La responsabilité de la matière phrasée est sa puissance de répondre en avant aux questions posées en elle, et de répondre de l’enregistrement de la forme qui la tient. » Une humanité qui ne veut plus être enseignée ou raffermie par ceux-là seuls qui sont les résistants, qui sont capables de se détourner du chant des sirènes en consentant à leur démon (le démonique est le nom que donne Beck à la poésie sans sommeil, au poète constamment habité par le désir de vérité) est une humanité en péril, dispersée, individuelle, consentant à mourir.
Le risque de la littérature est un risque énorme, que nous rappelle Philippe Beck : celui de résister au chant des sirènes, de crier dans le désert, de ne jamais être entendu et de n’entendre, même lorsqu’on crie, même pas le chant affaibli des oiseaux, mais la rumeur de ce qui recouvre le cri. Ce n’est plus aujourd’hui le charme qui endort (proposé par d’autres médias), mais, encore, le rappel des liens, l’humanité en partage ou la liaison avec la nature, tout ce qui nous fait sortir de l’individuel. Parce qu’elle rappelle que notre mort est « commune », la littérature peut nous libérer de l’effroi que l’on ressent ou du sentiment de notre existence vaine.
Tout cela est dit sans arrogance, mais avec vigueur et dans une apparence d’obscurité. Apparence, car pour qui sait la lire ou l’entendre, l’écriture de Philippe Beck est parfaitement libératrice : elle n’endort en rien et elle ne claironne guère. C’est un livre qui nous accompagnera longtemps car il ne donne pas de leçons immédiates. Il fait le constat d’une détresse profonde, mais sans nommer de coupables. Il se met à l’épreuve de ce qu’il énonce, à la folie du langage qui crée des liens neufs et nécessaires. C’est au sens strict une écriture de pensée, difficile parce qu’inconnue, parfois ardue, mais animée d’une puissance d’envoûtement qui inscrit pour chacun et chacune la mémoire de la berceuse et l’alarme toujours bientôt éteinte du clairon. L’expression qui a été capable de relever tant de craintes, de se remettre de tant de guerres et de tant de tristesse, a accumulé dans les livres des trésors dont certains sont encore cachés et nous sont destinés. Les chercher nous enjoindra d’inventer des chants neufs.