Petite chronique du temps qui passe et des livres de poésie dont il aurait fallu parler en 2018 et même avant… ce qui n’a pas été fait par manque de temps et de place, ma disponibilité et l’espace du journal n’étant pas extensibles à l’infini. Il faut savoir ne pas s’intéresser qu’aux auteurs consacrés. C’est pourquoi, après le Marché de la Poésie et avant la rentrée automnale, j’ai pensé nécessaire de présenter quelques-uns des poètes que j’ai retenus, conservés près de moi, sur ma table. Chaque fois, des personnalités originales, des parcours singuliers, des livres qui ont attiré ma sympathie et parfois suscité mon enthousiasme. Pour commencer, voici Françoise Clédat, Anne Malaprade et Seyhmus Dagtekin.
Françoise Clédat, « Que peut le poème pour Fukusima ? », revue Triages, supplément 2015 : Que peut le poème ? Lutte et exemplarité, Tarabuste, 90 p., 18 €
Ils s’avancèrent vers les villes. Tarabuste, 325 p., 20 €
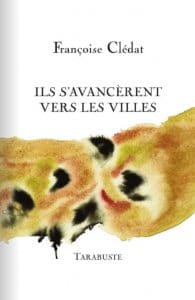 Grands cheveux roux bouclés, relevés sur la nuque, corps menu, voix posée, Françoise Clédat lit un long texte à l’IMEC-Paris, à l’occasion du colloque qui fête les trente ans de la revue Triages. Nous sommes en février 2018. Sa voix semble avancer dans une vision de cauchemar, elle explique, elle constate, elle décrit, avec des mots très simples, ce qu’elle a vu avec les yeux et les textes des autres, après la catastrophe de Fukushima : Furukawa Hideo, Ryoko Sekiguchi, Suga Keijorô… Et surtout elle se heurte à la question fondamentale de savoir s’il est tout simplement possible d’écrire la catastrophe.
Grands cheveux roux bouclés, relevés sur la nuque, corps menu, voix posée, Françoise Clédat lit un long texte à l’IMEC-Paris, à l’occasion du colloque qui fête les trente ans de la revue Triages. Nous sommes en février 2018. Sa voix semble avancer dans une vision de cauchemar, elle explique, elle constate, elle décrit, avec des mots très simples, ce qu’elle a vu avec les yeux et les textes des autres, après la catastrophe de Fukushima : Furukawa Hideo, Ryoko Sekiguchi, Suga Keijorô… Et surtout elle se heurte à la question fondamentale de savoir s’il est tout simplement possible d’écrire la catastrophe.
Elle se demande non seulement si l’écrivain peut parvenir à trouver les mots pour raconter ce qui n’est pas nommable, mais également si se livrer à l’action d’écrire dans un tel contexte n’est pas une sorte de viol, ne conduit pas à se sentir coupable « d’écrire “sur”, à même la terre sinistrée ». Et elle poursuit, dans sa langue qui est celle de la poésie, laquelle permet d’interroger « la place et la réalité de l’invisible » : « Je pense à l’Iliade. Je pense à la Première, à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à la litanie des villes détruites dont j’ai entrepris de faire poème par ordre alphabétique, commencer par Alep à la lettre A et maintenant Fukushima à la lettre F ». Ce livre, Ils s’avancèrent vers les villes, constitue le prolongement de son poème, la catastrophe y est celle de la guerre, de l’avancée des hordes et de la barbarie comme on la trouve chez Cavafy dans En attendant les barbares.
Furukawa Hideo, rappelle-t-elle, peut « n’écrire qu’une sorte de poème » avec Ô chevaux la lumière est partout innocente ; Samar Yazbek, dans Feux croisés. Journal de la révolution syrienne, recueille les témoignages et, ce faisant, agence « ses cellules mortes sous forme de lignes dans un livre » ; Yoko Tawada, dans Journal des jours tremblants, dit la nécessité des livres qui résistent aux séismes. Ce qui, pour Françoise Clédat, est « l’aulne absolue ». Cependant, elle poursuit avec désespoir : « Un seul, un seul de mes poèmes serait-il “résistant à la catastrophe” ? Avouer : aucun. Et moins que tous celui que je m’obstine à écrire sur Fukushima. Qu’on ne vienne pas me parler de nécessité intérieure. Qu’on ne vienne pas me parler de cerisiers en fleur. Qu’on m’en parle pourtant comme ils en parlent presque tous, et du chant des oiseaux survivants, comme moi de mon amour. »
Il faudrait tout citer de ce texte, et particulièrement ce qui a trait aux animaux, aux vaches, inquiètes de ne plus sentir autour d’elles de présences familières, aux chevaux sinistrés de Sôma, dont Furukawa Hideo déplore de ne pas parler la langue, ce qui lui aurait permis de les consoler. Inventer une forme poétique « qui aurait puissance effective de résistance », tel est l’enjeu du texte ; s’en remettre « à la lettre du nom comme manière d’en approcher l’esprit », le pouvoir du poète.
Anne Malaprade, L’hypothèse Tanger. Centre international de poésie Marseille, coll. « Le Refuge en Méditerranée », non paginé, 15 €
Parole, personne. Isabelle Sauvage, 95 p., 17 €
 Avec L’hypothèse Tanger, dont il faudrait écrire, comme elle, la lettre A en la renversant, Anne Malaprade nous entraîne dans un récit-poème fiévreux et haletant, qu’on lit comme un roman policier dont l’enjeu ne serait pas la découverte d’un criminel et de son mobile mais celle d’un crime qui se cache, d’une fuite qui perdure, d’une ville où elle a séjourné, vulnérable comme un corps, d’une femme réelle qui se confond avec d’autres : « J’ai croisé à plusieurs reprises Teresa, une Tangéroise parlant français avec un accent espagnol : elle lisait, dansait, traversait la ville avec de grands sacs […], se foulait les chevilles, dévalait les rues vers le port ».
Avec L’hypothèse Tanger, dont il faudrait écrire, comme elle, la lettre A en la renversant, Anne Malaprade nous entraîne dans un récit-poème fiévreux et haletant, qu’on lit comme un roman policier dont l’enjeu ne serait pas la découverte d’un criminel et de son mobile mais celle d’un crime qui se cache, d’une fuite qui perdure, d’une ville où elle a séjourné, vulnérable comme un corps, d’une femme réelle qui se confond avec d’autres : « J’ai croisé à plusieurs reprises Teresa, une Tangéroise parlant français avec un accent espagnol : elle lisait, dansait, traversait la ville avec de grands sacs […], se foulait les chevilles, dévalait les rues vers le port ».
D’où vient que ce livre qui ne livre pas ses secrets, presque pas, se lise néanmoins avec tant de hâte et de fascination ? Que cette réflexion sur le sexe et l’écriture, sur la féminité et ses désastres, ressemble tant à une énigme dans laquelle on piétine sans cesser de courir vers un but : la résoudre ? « Teresa regarde une carte pour perdre ces noms qu’on dit propres […]. De quel dictionnaire s’échappent les mots ? » Anne Malaprade invente un langage qui se transmet par osmose et sidération, « Le texte, cette autre science d’une transformation d’une matière », mais sans cesser de raconter : « Tu prends un escalier, tu glisses, tu te rattrapes […]. Kafka, toujours en toi, ne cesse de t’encourager ».
C’est le chemin qui compte, puisqu’au moins il conduit à un « désir d’inscrire », à un « désert d’écrire », même si « personne ne lit personne ». Écriture du secret qui déploie tant de force qu’on ne peut s’y dérober, qu’on ne cesse d’être intrigué et de vouloir saisir ce qui se cache là. « Dans la rue Teresa change de trottoir et traverse le masculin. Tout homme est le loup d’une petite fille, des inconnus l’abordent depuis des squares, la suivent, la pistent. » Les contes ne sont pas loin, qui disent à leur manière la vérité du vide. Anne Malaprade avance sur une ligne de crête, comme Teresa, son personnage, elle est une fille-tornade capable de chanter, de combiner le son au sens, capable aussi de mots violents – « lâche-moi, casse-toi » –, de se traiter de chienne. Il s’agit d’inventer une langue, c’est certain, une femme, c’est probable, et, s’enfonçant dans la nuit noire, de sortir du tracé de la version préexistante. Projet qu’elle poursuit avec son dernier livre, Parole, personne.
Seyhmus Dagtekin, À la source, la nuit. Le Castor Astral, 215 p., 9,90 €
Sortir de l’abîme. Manifeste. Le Castor Astral, 24 p., 4 €
 « Faites de votre vie un chef-d’œuvre », intime vigoureusement Seyhmus Dagtekin dans le manifeste publié à l’occasion du Marché de la Poésie. Le ton est déterminé mais la voix, quand le poète lit le texte, est douce, son maintien courtois et aristocratique. Né dans un village du Kurdistan turc, après des études de journalisme à Ankara, il s’installe à Paris il y a presque vingt ans. Il y écrit en français de la poésie et des romans, anime régulièrement des lectures, « Poètes en résonance », avec Naïma Taleb, il lui arrive aussi, lors de ses prestations publiques, de chanter en kurde en s’accompagnant d’un instrument traditionnel. Ce qui n’apparaît nullement comme une parenthèse exotique mais bien plutôt comme l’affirmation d’une culture, intensément présente dans ses écrits, rappelée et vivifiée par la voix, la musique. Je connais peu d’écrivains d’origine étrangère écrivant en français qui sachent si bien emporter dans leurs bagages leur culture d’origine tout en lui conservant sa radicalité et sa couleur.
« Faites de votre vie un chef-d’œuvre », intime vigoureusement Seyhmus Dagtekin dans le manifeste publié à l’occasion du Marché de la Poésie. Le ton est déterminé mais la voix, quand le poète lit le texte, est douce, son maintien courtois et aristocratique. Né dans un village du Kurdistan turc, après des études de journalisme à Ankara, il s’installe à Paris il y a presque vingt ans. Il y écrit en français de la poésie et des romans, anime régulièrement des lectures, « Poètes en résonance », avec Naïma Taleb, il lui arrive aussi, lors de ses prestations publiques, de chanter en kurde en s’accompagnant d’un instrument traditionnel. Ce qui n’apparaît nullement comme une parenthèse exotique mais bien plutôt comme l’affirmation d’une culture, intensément présente dans ses écrits, rappelée et vivifiée par la voix, la musique. Je connais peu d’écrivains d’origine étrangère écrivant en français qui sachent si bien emporter dans leurs bagages leur culture d’origine tout en lui conservant sa radicalité et sa couleur.
« Sortir des postures du paraître et du dire […], se défaire autant de nos servitudes intérieures que de celles qui s’imposent par l’extérieur ». C’est utopique, certes, « mais nous pouvons au moins nous poser en obstacle aux puissants ». Le texte est ambitieux sans grandiloquence, il exprime une sagesse dont sont pourvues toutes les cultures.
Dans son roman À la source, la nuit, Seyhmus Dagtekin passe du particulier à l’universel, du réalisme quotidien à la mythologie, avec une grâce qui n’appartient qu’à lui, il part à la recherche de son origine dans la nuit du passé : « J’étais petit. Mon village était petit, je le sus après. Mais quand j’étais petit, il était grand pour moi, grand à me faire peur quand je devais me déplacer d’un bout à l’autre. » L’écriture est économe, comme naïve. Elle part de la taille de l’enfant et du village et, tout de suite, elle s’élargit et elle embrasse : « C’était comme si je […] faisais le tour des cieux en hauteur et le tour des terres en profondeur […] À chaque cent mètres, je changeais de territoire, je changeais de peau ».
Tout le livre est un va-et-vient entre le microcosme et le macrocosme, la réalité terrestre et la spiritualité : « Les tortues vivent longtemps, nous disaient les grands. Elles savaient laisser passer les blessures pour continuer, de leurs pas mesurés, vers le sol qui allait accueillir tout retour. »












