Une adolescence dans un coin du Minnesota, en Amérique du Nord. Une région de lacs et de bois, de chiens de traîneaux et de loups. La narratrice du roman d’Emily Fridlund est fascinée par ces animaux, au point de faire sur eux un exposé qui donne son titre au roman. Confrontée à la mort et à la sexualité, notamment aux déviances sexuelles et aux dérives sectaires, l’adolescente pourrait s’interroger sur l’antique proverbe « L’homme est un loup pour l’homme ». Mais le déroulement du roman évoque davantage une citation de Hobbes : « L’enfer, c’est la vérité découverte trop tard. » Le lecteur plonge dans des eaux troubles et glaçantes.
Emily Fridlund, Une histoire des loups. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Juliane Nivelt. Gallmeister, 298 p., 22,40 €
Madeline, dite Mattie, ou plutôt Linda, petite dernière d’une famille isolée, issue d’une communauté hippie, semble plus à l’aise dans les bois, sur un lac ou avec ses chiens que parmi les jeunes de son âge. Au collège, on l’appelle « la Soviet », « la Cinglée », sans même un prénom. Elle se rêve « jeannette » (variété de scoute) experte en loups, mais aussi « Janet » comme dans Jane Eyre.
La mort apparaît dès la première page du roman d’Emily Fridlund. Qui meurt ? Un petit garçon de quatre ans dont Linda a été la baby-sitter quand la famille Gardner s’est installée de l’autre côté du lac. Des allusions à un procès laissent entendre que ce décès aurait pu être évité. Les parents du petit Paul, adeptes de la science chrétienne, croyaient pouvoir le guérir par la force de leur foi, la maladie n’existant à leurs yeux que dans l’esprit. L’autre affaire qui préoccupe l’adolescente concerne sa camarade de classe Lily et un professeur, M. Grierson. Là aussi, il y a un procès. Rumeurs de pédophilie, réalité brutale d’une grossesse ; comment savoir ce qui s’est réellement passé ?
L’adolescente s’attache à des personnages vulnérables, en particulier Paul et Lily, mais côtoie aussi des espèces de prédateurs : le professeur pédophile et le scientiste chrétien. Figures qui se superposent dans l’esprit de Linda quand elle apprend que Leo, le père de Paul, a été le professeur de Patra, la mère. Elle projette la scène intime qu’elle surprend entre eux sur ce qu’elle imagine qu’il a pu se passer entre Lily et M. Grierson. Au milieu de ces histoires sordides, elle est la survivante, avec la culpabilité qui accompagne cet état. Elle aurait pu être une mineure violée, comme Lily. Elle aurait pu succomber à une maladie dans ce lieu isolé, comme Paul. Et pourtant, ne les a-t-elle pas jalousés, l’une parce qu’elle était jolie et désirée, l’autre parce qu’il était choyé comme jamais elle ne l’a été ?

La distinction entre proie et prédateur ne suffit donc pas ; Freud n’a pas dit autre chose dans Malaise dans la civilisation. Comme l’explique Linda dans son exposé sur les loups, « un animal alpha peut n’être alpha qu’à certains moments, et ce pour des raisons spécifiques ». M. Grierson, si fringant de prime abord, finit par inspirer la pitié. Paul, si jeune et innocent soit-il, reproduit sur une petite fille la posture agressivement guérisseuse de son père. Quant à Lily, malgré ses airs d’ingénue, elle ne saurait être réduite à la qualité de proie facile : « Quand ils sont pris au piège, beaucoup d’animaux feignent d’être morts. […] [Lily] a trouvé un stratagème pour échapper à la vie médiocre qui l’attendait s’ils l’avaient forcée à épouser le père de l’enfant ». Et Linda, dans tout cela ? Jamais aussi enfantine que le voudrait sa mère, mais pas assez adulte pour sauver Paul. Tour à tour docile et provocante. Elle est comme Max dans le célèbre livre pour enfants de Maurice Sendak, Max et les Maximonstres : elle se rêve plus sauvage que les plus terribles monstres, mais surtout, au fond, désirée et aimée. Les rares passages racontés par une Linda plus adulte vont dans ce sens.
Le roman d’Emily Fridlund donne à voir le lien entre fiction et réalité, entre dire (ou imaginer) et faire ; plus exactement, il expose les dangers de la croyance et du fantasme quand ils empiètent sur le réel : « Quelle est la différence entre ce qu’on veut croire et ce qu’on fait ? C’est la question que j’aurais dû poser à Patra […] Quelle est la différence entre ce qu’on pense et ce qu’on finit par faire ? C’est la question que j’aurais dû poser à M. Grierson ». Passer du désir à l’acte peut avoir des conséquences désastreuses, mais ne pas agir, au nom d’une croyance par exemple, est potentiellement tout aussi dramatique. Ce « j’aurais dû » de la narratrice résonne comme la « vérité vue trop tard » de Hobbes ; dans le cas de M. Grierson comme dans le cas de la famille Gardner, elle a perçu que quelque chose clochait, distillant un malaise qui prend le lecteur à la gorge, grâce à la langue précise et changeante d’Emily Fridlund.
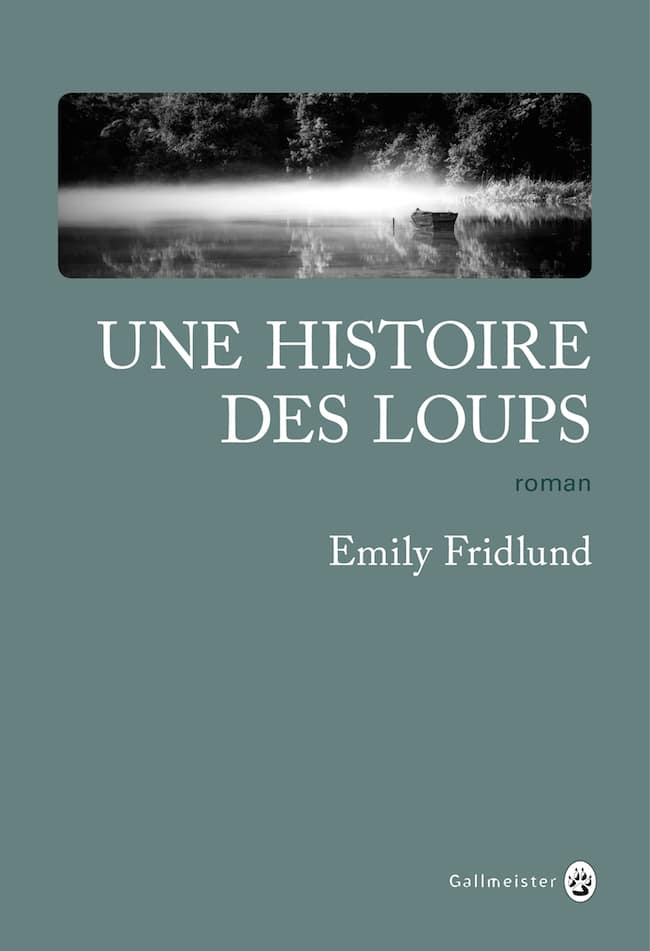
Lire, c’est aussi (se) raconter. Linda, qui connaît et observe tant de choses, sait distinguer les espèces d’oiseaux et le degré d’usure d’un billet de banque ; elle semble avoir développé une aptitude instinctive à la détection du monstrueux. Pourtant, sa lecture des événements et des autres n’empêche pas le pire. Le malaise est diffus, la source reste obscure. Elle se raccroche à des signes plus ou moins arbitraires, voit le nombre onze partout (nombre des apôtres après le trahison de Judas, trace d’éducation biblique), ce qui n’est pas plus éclairant que la « lecture » d’une carte de tarot ou des étendues célestes. Le malaise qui sourd dans la famille Gardner est compensé pour Linda par d’agréables sensations de proximité qu’elle n’a guère connues dans sa propre famille. Elle se moque des jeux de Paul, de sa « ville » faite d’écorces et de cailloux, mais elle aussi se raconte des histoires, à sa manière. Et se raconte tout en racontant.
Le lecteur pourra avoir l’impression qu’il sait où on le mène puisqu’il sait Paul condamné ; mais, fidèle à une certaine tradition américaine, Emily Fridlund lâche cet élément comme un appât. Au bout du compte, le puzzle du récit permet de reconstituer une jeune fille qui s’identifie facilement aux autres (par ennui ou par empathie ?), mais est en conflit avec sa mère (d’ailleurs, l’est-elle vraiment ?) et en décalage avec les figures féminines incontournables d’une certaine Amérique : la pom-pom girl, la patineuse, l’Indienne, la mère-ado ou l’ado-mère, la dévote. On découvre aussi une nouvelle plume, aux sources d’inspiration multiples. Malgré quelques longueurs, c’est un roman qui enchante autant qu’il hante, comme une nuit d’hiver au fond des bois.












