Ce long récit d’un ancien soldat de l’armée hitlérienne met une nouvelle fois les Allemands face à leur responsabilité individuelle ou collective au temps du Troisième Reich. Rien de nouveau, dira-t-on, après Les bienveillantes de Jonathan Littell, La fabrique des salauds de Chris Kraus, Le transfuge de Siegfried Lenz, et beaucoup d’autres romans encore. Mais la guerre actuelle en Ukraine donne au livre d’Alexander Starritt une dimension singulière : elle se passe sur les mêmes terres déjà ravagées dans les batailles des années 1940 qu’évoque le narrateur. La guerre de 2022 est sans doute très différente, mais sa violence ravive les cicatrices laissées par l’ancienne dans la mémoire des hommes, comme si l’actualité d’aujourd’hui renouait avec un passé qu’on voulait croire révolu. L’Histoire hoquetterait-elle ?
Alexander Starritt, Nous, les Allemands. Trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Diane Meur. Belfond, 208 p., 20 €
Le roman se présente comme une longue lettre d’un grand-père allemand, Meissner, à son petit-fils, Callum Emslie, qui est, lui, à demi anglais. On peut supposer qu’Alexander Starritt, fils d’une Allemande et d’un Écossais, aborde ici un sujet qui le touche, et qu’il a à portée de main de quoi nourrir ses personnages. La vie que raconte le vieux Meissner ressemble à celle de toute une génération d’Allemands ayant grandi sous Hitler : après les longues années de guerre et la captivité, la rencontre d’une femme qui signe le retour à la vie « normale », et enfin l’accession progressive au confort matériel (après, dans son cas, avoir fui la RDA communiste en 1960). Meissner est le premier étonné d’avoir survécu et mené sa vie comme si de rien n’était, comme si huit années avaient été mises entre parenthèses ; d’avoir travaillé, aimé, fondé une famille. Il s’efforce de ne rien cacher, même s’il sait que les souvenirs, loin d’être figés une fois pour toutes, se transforment avec les années et remontent à la conscience à travers les strates de la vie ultérieure, prenant de nouvelles couleurs. Certaines images sont obsédantes : celle des civils ou des partisans pendus en masse à un même arbre, celle d’une femme crucifiée vivante par des Feldgendarmen.

Des soldats allemands brûlent un village pendant leur retraite (août 1944) © Bundesarchiv, Bild 101I-281-1110-03 / Petraschk / CC-BY-SA 3.0
Meissner, qui n’a combattu que sur le front russe, raconte ici ses derniers mois de guerre, la débandade de la Wehrmacht devant l’Armée rouge, et toutes les horreurs qui l’accompagnent : exécutions de civils (et de soldats déserteurs), viols, villages incendiés… « Nous avons abattu les piliers soutenant l’édifice de la civilisation », dit-il, conscient de la responsabilité de son pays. La guerre menée avec une rare sauvagerie s’achève en sauve-qui-peut général où chacun participe à la folie meurtrière tout en veillant sur sa propre peau – à moins que, poussé à bout, il ne préfère mettre fin à ses jours. Meissner partage cette déroute avec une petite escouade de quatre hommes rencontrés par hasard, et les voilà condamnés à se serrer les coudes pour survivre. En dépit de leurs antagonismes parfois virulents, ces soldats perdus finissent par former une véritable équipe où subsiste encore une infime parcelle de leur humanité, alors qu’ils se sont affranchis de toutes les règles communes. Dans cet écroulement final digne de la violence d’Apocalypse Now ou de l’embrasement du Walhalla, un poney qu’ils ont adopté contre toute raison est comme un dernier lien fragile avec leur vie d’avant, avec le temps où leurs mains caressaient au lieu de tuer.
Le lecteur français ne manquera pas de relever la différence que le narrateur observe entre la guerre à l’Est et la guerre à l’Ouest, opposant le déchainement de cruauté de l’une à la relative tranquillité de l’autre : « Je ressens encore la brûlure du désir que j’avais d’être envoyé non pas à l’Est, mais à l’Ouest, et d’aller faire la guerre en France. Là-bas, les soldats se trouvaient comme en villégiature dans la Loire ou la Dordogne, à manger du fromage et à visiter des châteaux ». Une vision quelque peu idyllique sans doute, dont on retrouve l’équivalent dans les Lettres de guerre de Heinrich Böll. Mais c’est aussi à travers les clichés et les images usées que se transmet la mémoire, ou plutôt que se transmettent les mémoires : le soldat allemand avait sûrement raison de préférer une permission à Paris à l’enfer russe, mais les Français ne sont pas près d’oublier l’occupation, les privations, les bombardements, les milliers de déportés, les fusillades d’otages, Tulle, Oradour-sur-Glane ou Vassieux-en-Vercors. Mais pourquoi Meissner revient-il si longuement sur ses propres souvenirs de guerre ?
S’il éprouve le besoin de répondre de manière circonstanciée aux questions de Callum, c’est moins pour se justifier a posteriori que par souci de transmettre avant de mourir une expérience humaine qu’il juge profitable, à la manière de ces anciens samouraïs qui « portaient par écrit leurs leçons de vie pour contribuer à l’éducation de leurs fils et de leurs petits-fils ». Pour hasardeux qu’il fût, un tel projet atteste que le grand-père ne peut s’empêcher de voir aussi les épreuves qu’on a infligées à sa génération comme une école de courage et de promotion des vertus anciennes, même s’il se défend d’avoir été nazi ou d’avoir seulement aimé la guerre : « Je pense que quiconque a vu le vrai courage ne l’oublie jamais plus, sans doute parce qu’il ne ressemble à rien d’autre dans notre caractère ». Il est vrai que d’autres que lui poussent encore beaucoup plus loin l’apologie de la vaillance et de la virilité censées s’épanouir dans des situations extrêmes.
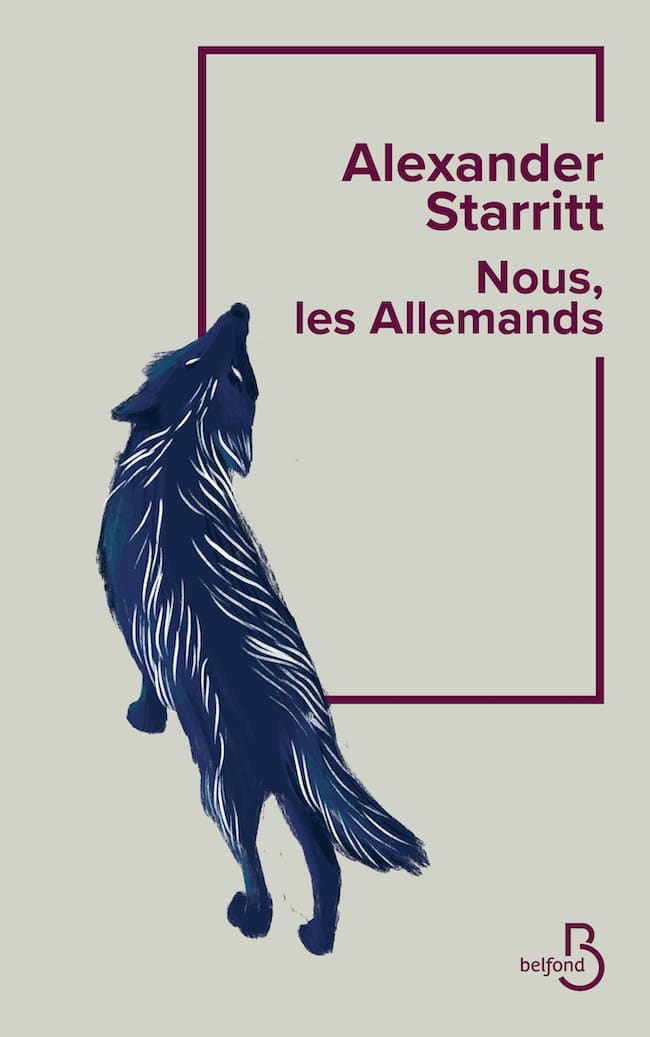
On se méfie avec raison des propos qui manquent de nuances. Le « nous » contenu dans le titre du roman (en anglais comme en français), en donnant au récit du grand-père une portée générale, exprimerait-il une singularité des Allemands parmi les autres peuples, au risque de propager quelques clichés aussi tenaces que ceux qui visent les Français ? Meissner condamne sans appel ce « désastreux orgueil » qui le conduisit comme les autres à combattre jusqu’au bout. Mais est-ce parce qu’on lui a inculqué le sens du devoir et de l’obéissance que l’individu allemand s’est soumis au collectif, au point de ne plus écouter sa conscience ? Dans son long témoignage, le grand-père répond en mettant en avant la notion de honte, qu’il juge plus pertinente que celle de culpabilité : à son éducation protestante, qui lui a appris à juger de la qualité d’un acte en considérant la pureté de son intention, il substitue la honte, celle d’Œdipe qui commit sans aucune mauvaise intention un acte abominable. Le soldat peut se défendre d’être coupable, et même s’il ne l’est pas du point de vue de la loi, il ne se débarrassera jamais de la honte éprouvée devant les actes commis par ceux qui portaient le même uniforme que lui. Le coupable relève du tribunal, mais « avec la honte, ce n’est pas comme avec la culpabilité, il ne s’agit pas de réparations […] La honte ne s’expie pas ».
Il fallait sans doute que ce livre fût écrit par quelqu’un qui n’a pas vécu la guerre, mais qui peut aussi s’inclure dans ce « nous » dont il partage la moitié des gènes et surtout la culture. Et qui peut, avec son regard extérieur et en utilisant une autre langue que l’allemand, placer son sujet à distance. Mais les évènements d’Ukraine modifient aussi notre propre regard sur le roman d’Alexander Starritt, sur ce qu’il nous dit des hommes et de la guerre, du temps qui passe sur les pays dévastés. « Rien en nous ne reste immuable », dit Meissner, « notre esprit n’est pas une archive ; tout est perpétuellement re-digéré par le présent […], l’herbe repousse sans fin sur la terre brûlée. » Mais la terre peut-elle aussi brûler sans fin quand l’herbe a repoussé ?












