Ohio, premier roman de Stephen Markley, raconte les évènements mystérieux et violents d’un soir de 2017 dans une petite ville de l’Ohio, où quatre ex-camarades de lycée reviennent par hasard le même soir sur les lieux de leur enfance. EaN a pu interviewer l’auteur à distance, depuis les bureaux de son éditeur (l’attachée de presse a installé l’application gratuite sur l’iPhone de notre collaborateur). Ce fut l’occasion d’en savoir plus sur les inspirations de Stephen Markley, dont les influences reflètent le changement d’époque : pour certains auteurs de sa génération, la musique et le cinéma comptent autant que la littérature.
Stephen Markley, Ohio. Trad. de l’américain par Charles Recoursé. Albin Michel, 560 p., 22,90 €
Vous êtes de Mount Vernon, une petite ville dans l’Ohio, transformée ici en « New Canaan ». Quelle est la spécificité de la situation géographique de ce livre ?
La ville est un amalgame de différents endroits dans la région centrale du nord-est de l’Ohio. Dans le Midwest, il y a tous ces lacs et ces villes aux noms bibliques, je cherchais quelque chose dans cette veine, et j’ai aimé la musicalité du nom « New Canaan ». Quant à l’Ohio, je crois que c’est la quintessence du Midwest, que ce soit pour sa folle et sanglante histoire ou pour son image, dans les représentations de l’après-guerre, de banlieue conformiste remplie de pavillons identiques, ou encore pour la manière d’évoquer aujourd’hui l’ennui et la désuétude. Je voulais bouleverser tout cela au cours d’une seule nuit.
Quand j’ai entendu le titre, j’ai tout de suite pensé à Ohio, chanson de CSN&Y (Crosby, Stills Nash & Young), avec son refrain incantatoire : « Four dead in Ohio. » Dans votre roman, il y a quatre grands chapitres désignés par des noms de personnages, et il y a quatre morts.
Mon éditeur et mon agent ont choisi ce titre, pour sa simplicité et son rythme : la mutation des voyelles. En effet, j’ai pensé à la chanson. C’est vrai, il y a des coïncidences et des connexions bizarres dans notre culture littéraire et musicale, que l’auteur peut ignorer lui-même, ou avoir enfouies au plus profond de son inconscient.
Alors, quelle était la bande sonore du roman, si ce n’était pas la chanson de CSN&Y ?
Beaucoup de Springsteen, Patti Smith, Fiona Apple, du rap des années 90, beaucoup de Tupac. Le livre est évocateur de tous ces musiciens que j’écoutais enfant, et des sensations qu’ils ont produites chez moi. Une des questions les plus difficiles pour moi, lors des entretiens, concerne mes inspirations littéraires : je n’ai pas de réponse, parce que pour ma génération, ayant grandi avec la cacophonie du multimédia, les influences sont plus larges, je n’avais pas de modèle littéraire, j’étais obsédé par le cinéma, la musique, la lecture, tout cela était diffus. J’ai toujours été attiré par des musiciens littéraires, tels Springsteen et Fiona Apple, Bob Dylan, Tupac Shakur, ce sont des écrivains et des poètes déguisés en musiciens.

Stephen Markley © Michael Amico
Donc vous êtes d’accord pour le prix Nobel décerné à Bob Dylan ?
Ouais, donne-le-lui. Donne le prix aussi à Springsteen !
Ohio raconte l’histoire de quatre personnages qui, ayant quitté leur ville natale, y retournent par hasard la même nuit, en 2017.
Exactement. Il y a Bill, un alcoolique toxicomane, militant politique qui patauge dans la vie. Ce soir-là, il sert de « mule » pour un paquet mystérieux qu’il transporte de La Nouvelle-Orléans. Ensuite, il y a Stacey, doctorante qui revient pour affronter la mère de son ex-amante. Il y a Dan, vétéran d’Iraq et d’Afghanistan, qui va dîner tard dans la soirée avec son ex-petite amie du lycée. Et, enfin, il y a Tina. La concernant, je dirai juste qu’elle vient de droguer son fiancé et qu’elle retourne en ville pour des raisons qu’on découvrira.
Vous avez une voix singulière, à la fois vulgaire et lyrique.
On me dit souvent qu’il s’agit d’un mélange du littéraire et du populaire. J’aime bien créer un effet poétique, suivi d’une description ou d’une observation qui sort de nulle part. Sinon, je ne recule pas devant la rudesse, par exemple l’impact du mot « fuck », ou la manière dont les gens s’expriment vraiment, les choses méchantes qui sortent de leurs bouches. J’aime mettre tout cela ensemble.
C’est l’idiome juvénile et vulgaire de notre époque.
Je l’utilise moi-même dans la vie quotidienne, donc je le mélange avec le langage des rêveries juste avant qu’on s’endorme, la poésie qu’on a à l’esprit à ce moment-là, que j’essaie aussi de mettre sur la page.
Mis à part le langage, peut-on dire que l’aspect le plus important dans Ohio, c’est l’intrigue ?
À l’origine, oui. Mon idée, c’était d’écrire un polar où on ignorait le crime, où on ne savait même pas s’il y en avait eu un avant d’arriver aux dernières pages.
Des quatre personnages principaux, il me semble que le plus important est Stacy et que sa relation avec Lisa constitue le noyau dur du roman.
Absolument. C’est l’histoire d’amour au cœur du livre qui devient le point de départ pour les révélations aboutissant à l’éventuelle résolution du meurtre qui n’a pas eu lieu. Quels que soient son genre ou sa sexualité, tout le monde vit un tel bouleversement lors de son premier vrai amour, et c’est ça que la relation entre Lisa et Stacey représente.
Pour les femmes de votre génération, être lesbienne dans une petite ville de l’Ohio, était-ce un problème ?
Oui, c’était incroyablement dur, ce n’est pas pour rien que beaucoup de gens fuient ces petites villes. Cela dit, les choses ont évolué au cours des deux dernières décennies, mais ça reste encore problématique.
Vous êtes de la première vague de la génération des milléniaux. Portez-vous un regard un peu particulier sur Internet ? Internet est un peu absent ici.
Je me souviens d’une époque avant Internet, et je peux encore y résister. Mais je dirais quand-même que Facebook joue un rôle intégral dans la tromperie (au cœur de l’intrigue du roman). Il faut se rappeler que je l’ai écrit bien avant 2016, bien avant qu’on commence à réfléchir sur les « sock puppets » (des faux comptes sur les réseaux sociaux) et la manière dont on se présente à travers ces prismes.
Vous avez écrit la majeure partie du roman au célèbre Iowa Writers’ Workshop. Ce programme d’écriture créative a-t-il eu une influence sur l’évolution du texte ?
J’ai rencontré des gens qui ont freiné ma tendance à trop étirer la narration, en me conseillant de me focaliser sur l’élaboration de personnages et de scènes bien serrées. On m’a aidé à dépasser mes instincts juvéniles.
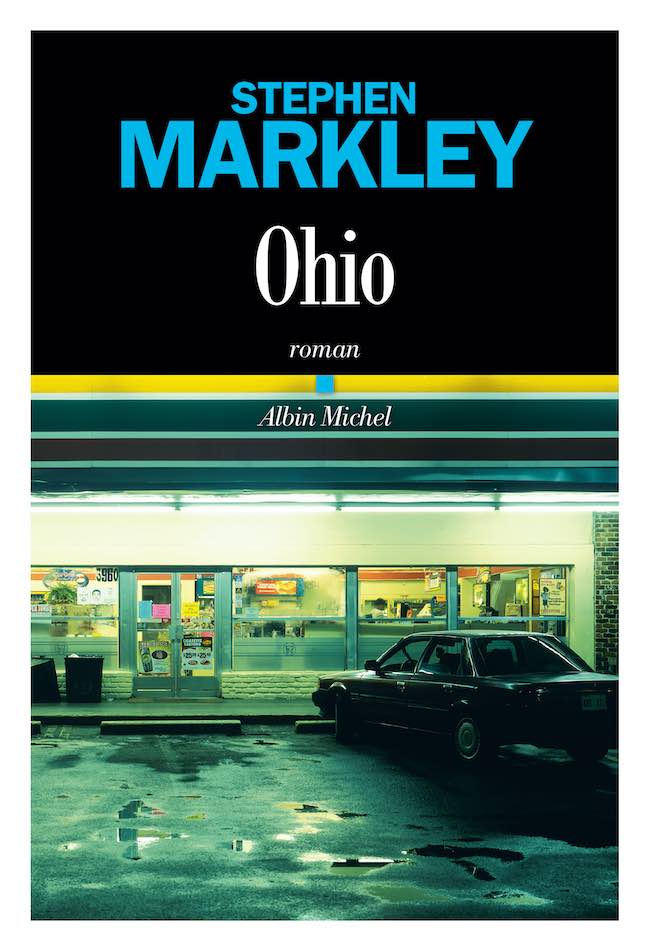
L’« instinct juvénile » : on songe à l’ambiance du lycée (high school), si bien captée ici. Est-ce un thème typiquement américain ? J’ai récemment interviewé Stefan Merrill Block : ses personnages aussi restent éternellement bloqués au lycée.
C’est très juste : l’expérience du lycée préoccupe énormément l’imagination américaine. Ç’a été le cas pour moi. Comme vous dites, ce thème est constamment recyclé, c’est un trope qui fonctionne dans tous les genres : horreur, romance, etc. Pourquoi ? Je crois que cela remonte à l’après-guerre : je songe à American Graffiti, cette idyllique virée en voiture, où l’on cherche à rencontrer des filles. Ce genre de narration sera recyclé sans fin : le public ne s’en lasse jamais.
À part American Graffiti, il y a d’autres livres ou films fondamentaux sur ce thème ?
Quand j’étais au collège il y avait une résurgence des films d’épouvante de mauvais goût sur les adolescents, à partir de Scream. Et puis il y avait tout un tas de films d’horreur et de romance, ça a infléchi la culture, et depuis ça n’a pas vraiment diminué. Je peux en comprendre l’intérêt, parce que les années lycéennes sont intrinsèquement bizarres : l’âge adulte approche, on est capable d’avoir des pensées mûres, tout en étant piégé dans la jungle de la fratrie de ses pairs. Entre-temps, les hormones font rage, tout est intensifié. Je me souviens d’une anecdote assez loufoque : pendant la campagne pour l’élection présidentielle de 2012, on a interviewé un homosexuel qui avait été persécuté au lycée par Mitt Romney et ses amis, on l’avait immobilisé et on avait coupé ses cheveux. Et pendant l’entretien on parlait de cet épisode comme si c’était l’événement le plus traumatique de leur vie, comme s’il datait d’hier, alors que les hommes avaient la soixantaine. On voyait bien que l’incident était encore imprimé dans leurs cerveaux, ils ne l’ont jamais oublié, ils ne l’ont jamais surmonté. Et je me suis dit : voilà, c’est ça le lycée, il laisse des traces beaucoup plus indélébiles que ce qu’on peut vivre à vingt-sept ans.
Stefan Merrill Block m’a dit la même chose. Les Américains sont-ils un peuple d’éternels lycéens ?
(L’auteur éclate de rire.) Cela semble juste. Maintenant je travaille à Hollywood, je remarque sans cesse que c’est exactement comme au lycée, sauf qu’il y a plus d’argent.
Les années de lycée sont souvent marquées par des actes de violence, notamment des viols. Celui du roman s’inspire-t-il de faits réels ?
Il y a eu un célèbre fait divers dans la petite ville de Steubenville. Une jeune femme a été agressée par un groupe de joueurs de foot américain. Ce genre d’incident devient banal chez les adolescents, il se répète à intervalles réguliers. On dit que la société évolue, mais je n’y crois pas. Il y a encore beaucoup d’incidents de ce genre qu’on passe sous silence, c’est un tabou qui n’a pas été brisé comme il faudrait.
Votre style un peu juvénile, que certains appellent « gonzo », s’inspire-t-il de précurseurs ?
J’ai été un énorme fan de Hunter Thompson, il est sans doute l’un des auteurs que j’ai le plus admirés.
Propos recueillis par Steven Sampson












