Ces dernières années, Alain Veinstein semblait avoir un peu délaissé l’écriture pour la peinture, son autre (et antérieure) passion. Mais le voici de retour avec À n’en plus finir, un livre qui, de bout en bout, est un accomplissement, ou plutôt même un éblouissement, bien que la lumière qui en émane, rarement colorée, convoque surtout les teintes les plus sombres : rouge du sang versé, violet.
Alain Veinstein, À n’en plus finir. Seuil, 233 p., 18 €
C’est que cette lumière tirant vers la nuit naît dans la chambre noire d’une obsession majeure chez Alain Veinstein, celle de la mort omniprésente, de la terre où s’abîme le corps emmailloté dans les bandelettes de souvenirs récurrents (le père disparu, la mère peu aimée, peut-être peu aimante, les amours plus rêvées qu’accomplies, ou qui n’ont plus de vitalité immédiate).
L’admirable suite de dix-huit poèmes qui porte comme sous-titre « Après minuit » pourrait ainsi, en première lecture, être assimilée à un thrène dont le héros malgré lui est un enfant « claquemuré dans la tombe, / seul à jamais » car dans l’incapacité de construire, sur quelques miettes de bonheur volées, un roman familial heureux. Une enfance vouée à l’effroi essentiel, celui d’être au monde, relayé par l’effroi conjoncturel dû au contexte de guerre. L’enfance est d’ailleurs le thème central d’À n’en plus finir.

Alain Veinstein (2020) © Jean-Luc Bertini
Cela implique-t-il que le fond, sans conteste noir, de ce recueil où l’individu pourchassé, menacé, hanté par des images de terre remuée, d’ensevelissement, mais aussi d’échec, de ruine des espérances, d’occasions manquées, s’offre chargé d’une tristesse si incurable qu’elle exerce sur le lecteur une influence déprimante ? Non, et ce paradoxe apparent tient au contraste entre la noirceur thématique de la plus grande partie des évocations du marasme intérieur et l’énergie de l’écriture née d’une personnalité jamais en repos, qui oppose à l’effondrement qui s’avance, et cela en toute expérience négative actuelle, en toute réminiscence de blessures psychiques remontant du passé, l’efficace d’un verbe dont la seule capacité à exister contre le malheur vaut exorcisme.
Chez Michaux, autre poète affronté à l’innommable, la lutte pour une portion, même infime, d’aise et de quiétude provisoire s’accompagne de violence destructrice. Lui veut « écarteler » ce monde invivable. Rien de tel à la base de la procédure d’exorcisme pratiquée chez Veinstein. Sans doute parce que la peur originelle et acquise y prédomine et empêche de transmuter la malédiction d’être en un explosif brisant. Mais surtout, malgré un sentiment de solitude qui rend inutile tout effort continu pour cisailler les barbelés de la prison mentale, l’artiste souffrant qui fait entendre dans ces pages sa plainte profuse ne perd pas totalement l’espoir de toucher quelque frère d’élection et, en fait, écrit pour quelqu’un.
Rien de plus éclairant à cet égard que la confidence d’auteur qui figure à la fin du livre dans une de ses séquences les plus opaques, « Un noir plus sombre que la nuit » : « Je manœuvre au vent. Recueille les mots au petit bonheur comme des naufragés. J’en choisis deux ou trois que j’avance à pleine voix de la même façon que le pianiste joue quelques notes pour lancer l’orchestre. Pas d’autre ambition, au fond, que de faire corps avec une poignée de mots qui vont droit au cœur. C’est aussi simple que ça […] Je parle pour me taire sans me replier entièrement sur moi-même ».
Cette poésie – car, mesurée grâce au seul retour à la ligne, sans lyrisme revendiqué ni recherche rythmique, ou même disposée en paragraphes, la prose de Veinstein tend toujours à la poésie – se désigne donc explicitement comme destinée à d’autres affligés et même comme guérisseuse (« mots qui vont droit au cœur »). Elle est autarcique – le monde extérieur à l’esprit tourmenté du poète y a peu de place – mais non pas égoïste et, venue du cœur, va à la rencontre d’autres cœurs. Ce qu’elle réussit comme en se jouant, parce qu’elle refuse tout élitisme, toute recherche stylistique excessive, et n’utilise qu’une vocabulaire simple, les mots et les tournures de tous les jours.
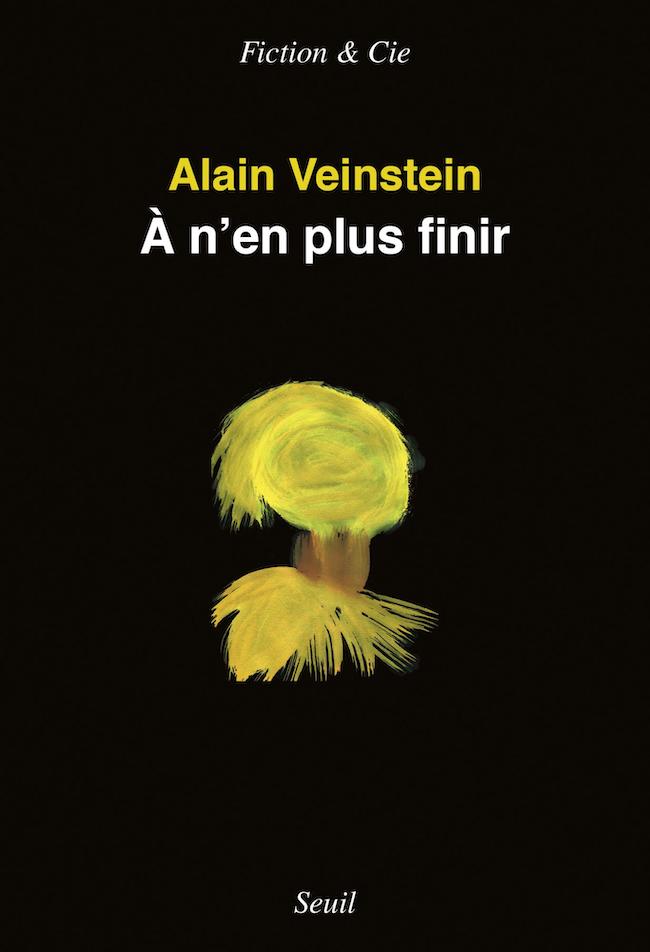
Mais si le choix des mots, notamment dans les poèmes en vers libres, semble obéir à une loi de lisibilité immédiate, comme si la langue du poète pouvait s’accommoder du tout venant de la conversation ordinaire, et par là traduire en somme les sentiments et les affects du commun des mortels – ce qui est très loin d’être le cas –, toute la complexité rhétorique du discours à soi-même, du continuel ressassement intérieur, du monologue sans voix ni cri émis à travers l’espace de communication banal, se réfugie dans la disposition strophique, élaborée et savante.
Tantôt le texte descend sur la page d’une seule coulée (dans « Elle, dernier jour »), comme si la hâte d’échapper au mal qui court (« je n’entends même plus les battements de mon cœur ») serrait à la gorge le fugitif. Tantôt, par exemple dans le magnifique « Un silence de mort », la distribution des vers en strophes varie en fonction des poussées de l’angoisse, de l’afflux des souvenirs vrais ou faux, des pauses que doit se ménager l’indicible pour enfin venir au jour : un distique, un huitain, quatorze vers qui ne composent pas un sonnet mais le rappellent, enfin un septain de « conclusion », auquel l’impair confère le pouvoir de nier toute « clôture » définitive, bien que ce dernier mot, suivi d’un point final, paraisse enfermer la méditation sur la mort du père derrière la porte métallique d’une sorte de tombeau.
Ce n’est ainsi pas grâce à son élocution apparemment si aisée à comprendre que la poésie de Veinstein touche la sensibilité de chacun et, sans être aucunement émotive (rien de mièvre ici ou de forcé), se révèle si émotionnelle. Ce qui bouleverse dans chacun de ces textes, assez maîtrisés par leur auteur pour ne susciter en nous qu’une réaction d’empathie quasi fraternelle, c’est la proximité non factice qu’ils établissent d’emblée entre le petit garçon éternel, éternellement condamné à mort, qui les traverse comme ce fantôme pathétique photographié les bras en l’air dans un terrible cliché du ghetto de Varsovie (personnage de victime innocente constamment présent en filigrane du livre), et l’idée même d’enfance, de notre enfance à nous qui l’avons vécue si fragile et si menacée, dans son combat permanent et finalement perdu contre l’adversité.












