Les éditions Bleu autour viennent de republier le premier roman d’Aziz Chouaki, Baya, long monologue intérieur d’une mère de famille algérienne qui s’exprime avec une liberté et un humour impensables aujourd’hui encore. Trente ans ont passé depuis la première édition. Nous avons passé deux longues heures avec l’écrivain pour revenir sur la genèse de Baya, sur son parcours et celui de son Algérie natale qu’il aimait et se désolait de voir claudiquer. Quelques jours plus tard nous avons appris sa mort.
Aziz Chouaki, Baya. Rhapsodie algéroise. Préface de Martine Mathieu-Job. Bleu autour, 114 p., 13 €
S’il est permis d’évoquer les circonstances d’un entretien, j’ajouterai quelques lignes émues. Je n’avais pas vu Aziz Chouaki depuis plusieurs années. Il est arrivé chez moi avec un chapeau de guingois, une démarche fatiguée et un sourire d’enfant pas sage et plein de tendresse. Nous avons commencé dans la cuisine – café, tablette de chocolat –, échangé des nouvelles de ses enfants, de son travail théâtral, des livres que nous avons édités au début des années 2000, des virages de sa vie, de la mienne, puis continué autour d’une table avec un smartphone enregistreur.
Ce fut une conversation chaleureuse, qui fusa, éclatée, inquiète. J’aimais Aziz Chouaki pour son honnêteté absolue, son franc-parler, son talent criant, une gouaille qui allait avec une grande pudeur. Il fut étonné que je cite le nom de James Joyce, mais je me souvenais de son admiration pour celui qui réinventa la perspective en littérature. L’Irlandais était la jauge de cet écrivain francophone qui revendiquait de vivre en « Poestrie ».
Farouche, il n’a jamais cédé à la tentation de devenir un porte-parole officiel de son pays natal, alors faut-il s’étonner que ses propos révèlent une Algérie aussi jeune, vibrante, explosive ? Aziz Chouaki avait sur la révolte actuelle un regard admiratif, teinté d’espoir, mais prudent. Il était lucide, si lucide.
« Floral », dit-il au sujet du souvenir de son adolescence algérienne. Le mot dit ce qu’il était, lui, son œuvre. Aziz Chouaki n’est plus là ? J’ai du mal à le croire.
La première publication de Baya a eu lieu en 1988, aux éditions Laphomic, une maison algéroise. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contexte de cette publication originale ?
J’étais musicien et j’avais publié à compte d’auteur un recueil de poèmes et de nouvelles, Argo, qui m’avait donné un peu de visibilité et d’estime dans le milieu universitaire. Laphomic était une maison privée, j’ai été contacté par un éditeur qui aimait beaucoup mon travail. C’est une époque majeure en Algérie puisque que c’est l’année où il y a eu les premières émeutes – 600 morts – qu’on appelle les émeutes d’octobre 88. La jeunesse a pété les plombs, elle est descendue dans la rue, réclamant tout, avec violence. J’avais 32-33 ans. Malheureusement, cette magnifique révolte a été récupérée par les islamistes, complétement, des pieds à la tête, ils ont tout récupéré. Aux élections de 1991, les premières élections libres, soi-disant, en Algérie, ils ont raflé 51 % des voix.
C’était une révolte légitime, attendue – tout le monde l’attendait depuis l’indépendance –, qui a été confisquée. La sortie de Baya correspond un peu à ce merdier. Ç’a été une coïncidence, mais, à le relire aujourd’hui, donner la parole à une femme, par exemple, symboliquement, c’est extrêmement violent pour les islamistes, et même pour les Algériens, pour la conscience sociale simple, algérienne.
Qu’est-ce qui a décidé les éditions Bleu autour à republier le texte en 2018 ?
Il y a six mois, une certaine Martine Job me téléphone et me dit : « J’ai toujours voulu revoir ce texte publié parce qu’il est devenu introuvable ». Il était totalement épuisé. Laphomic a fait faillite dans les années 1989-1990, quand c’était le chaos en Algérie, quand les islamistes ont pris le pouvoir. Il y a eu une première vague d’émigration d’intellectuels, dont je fais partie puisque je suis arrivé en France en 1992. Laphomic a aussi été fermée pour des raisons politiques. Aujourd’hui, c’est un miracle que le texte existe.
Comment qualifieriez-vous ce livre ? de roman ? de pièce de théâtre ? de long monologue intérieur ?
Pour moi, le livre était un roman, mais il a été immédiatement adapté au théâtre. À l’époque, le directeur des Amandiers de Nanterre était Jean-Pierre Vincent. En 1990, il est venu à Alger parce qu’il organisait une semaine algérienne à Nanterre. Il cherchait des textes nouveaux, on l’a dirigé vers moi. Il m’a dit : « Aziz, on voudrait adapter votre texte, Baya, au théâtre ». Je me suis défendu : « Je n’ai jamais écrit de théâtre, je ne sais pas écrire de théâtre ». Il m’a répondu par la phrase de monsieur Jourdain : « Vous faites du théâtre sans le savoir. Quand on lit une page de votre texte, on voit tout de suite le plateau ». C’est grâce à ça que je suis devenu auteur de théâtre. Ça s’est fait un peu par hasard.
Vous avez fait une thèse sur Ulysse, de Joyce. Est-ce que vous y pensiez en écrivant Baya ?
Absolument. C’était en 1988-1989, j’étais encore à Alger, je préparais ma thèse, c’est-à-dire que pendant que le pays était en flammes, j’étais dans Joyce et dans Baya. Le pays brûlait, c’est Rome qui brûlait : c’est une véritable image. J’écrivais, et autour de moi je voyais les bus en flammes, l’islam, Allah Akbar, ça hurlait… Jusqu’au jour où un ami du quartier m’a dit : « Aziz, on a vu ton nom dans le quartier, sur les murs de la mosquée – parce qu’ils affichaient des noms, comme des dazibaos –, c’est fini pour toi, il faut que tu partes. » J’avais un ami français qui travaillait au Centre culturel français, Michel Pierre, qui m’a confirmé : « On a un dossier sur toi, par les RG français. » Il m’a fait une lettre de recommandation.
J’étais accusé d’être le diable, d’être musicien, d’être beau gosse, d’être écrivain. J’étais une cible alléchante pour les Frères musulmans. Je dirigeais un club de jazz, un des seuls d’Afrique du Nord.
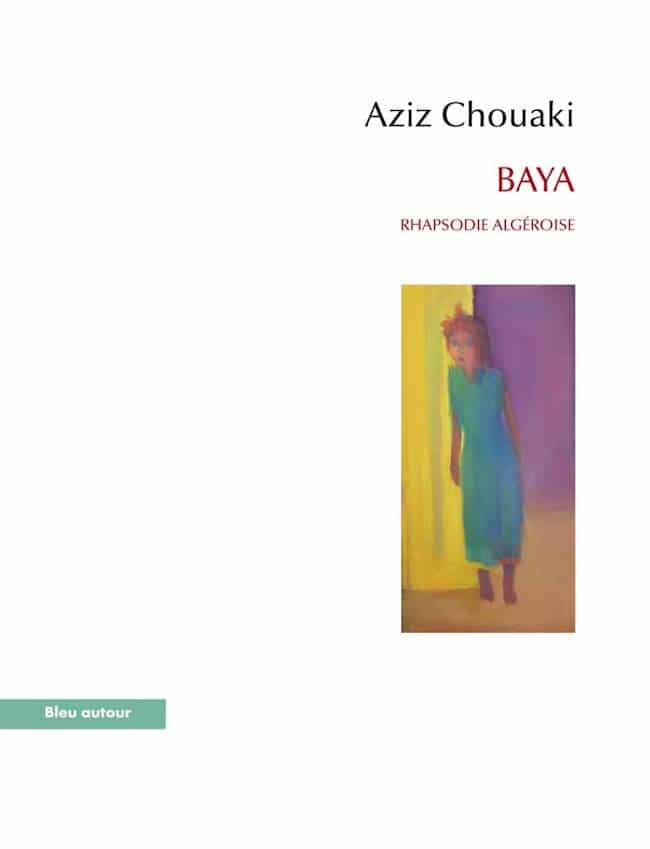
Pourquoi avoir choisi de donner voix à une mère de famille, une femme qui dit qu’elle a arrêté ses études en seconde ?
Ce n’est pas une femme très lettrée, mais son père, sa famille, étaient lettrés. Avant d’écrire, je m’étais aperçu qu’on n’avait jamais donné voix à une femme. Et ce n’est pas par patriotisme ni par féminisme que je le dis. Je pensais que c’était offensif, qu’il y avait là quelque chose qui pouvait bousculer la conscience sociale que les gens avaient de la femme. Par ailleurs, je viens d’une famille d’instituteurs, ma mère était institutrice, mon grand-père était issu de l’École normale algéroise. Baya est un type de figure féminine que je connaissais grâce aux femmes qui gravitaient autour de ma mère. Elles étaient toutes belles, très italiennes, très occidentales. J’ai intégré une scène dont je suis très fier, que beaucoup m’ont reprochée, qui est une scène de masturbation féminine.
Aujourd’hui, je me rends compte que donner la parole à une femme, c’est encore explosif. La pièce a été montée à Alger, en arabe, en 1992, je n’y suis pas allé mais des amis m’ont dit que ç’a été la bataille d’Hernani, des gens se sont levés en claquant la porte, en claquant les sièges. On m’a accusé d’être un nostalgique de l’Algérie coloniale parce que Baya revendique un peu ça, avec ses copines de classe, notamment…
Avez-vous effectué des changements entre la première et la seconde édition ?
Non, très peu. Quelques changements cosmétiques, pas plus.
Dans la deuxième partie, Baya se souvient d’être allée à Paris. Elle tient des propos assez durs sur les Algériens qu’elle y a vus. Page 75, elle dit à propos d’un Algérien en chemise dans la rue : « Il me donne honte d’être Algérienne. J’ai rien à voir avec cette chose crépue, moi ! »
Pour moi, Baya a un regard éthique, et non ethnique. Je me souviens, quand ma mère venait à Paris, elle me disait : « mais qu’est-ce qu’ils sont sales, ces arabes ». On ne sortait pas dans la rue n’importe comment. C’est le point de vue d’une mère de famille. Ce n’est pas un point de vue racial, ethnique. On me l’a très souvent reproché, y compris des intellectuels algériens. Pourtant, quand ils ont bu, eux vont plus loin que moi dans la critique, sauf qu’ils me disent : « Tu as raison mais ça ne se dit pas, sinon, que vont penser de nous les Français ? » J’essaie de ramener les choses au sol. Ils sont capables de faire des nuances… évidemment pour eux, le colonialisme, c’est une chose horrible… on vit toujours sous la houlette du FLN, dans le discours mental du FLN, qui va mettre un temps fou à se désagréger, y compris chez les manifestants d’aujourd’hui. Les gens demandent : « On va mettre qui maintenant ? » Un copain m’a posé la question, je lui ai répondu qu’en disant ça il perpétuait le discours du FLN.
Il faut qu’il y ait des institutions propres, contrôlées. Aujourd’hui la justice n’existe plus. Pour les manifestants, la seule solution est de chercher quelqu’un dans le sérail et de le nommer. Ça me rappelle ma formule : en Algérie il y a une dictature éclairée, mais, de temps en temps, il faut changer l’ampoule. Même sur Facebook, je vois les gens qui demandent : « Vous pensez que ce sera qui ? » Et chacun va à la pêche.
Que dirait Baya aujourd’hui des gens qui manifestent ?
Question Bac + 20… Il y a un fond moral qui me permet d’espérer que tout se passera bien. Mais je connais bien le tissu, et je n’arrive pas à avoir une idée claire, à savoir jusqu’à quel point le logiciel FLN a pris. La grande inconnue, c’est ça. C’est comme l’islamisme, il a disparu politiquement, mais pas dans les mentalités. Il y a deux ans, je suis allé en Algérie et j’ai été frappé, les jeunes transportent eux-mêmes, sans le savoir, les germes de l’islamisme. J’ai vu une bande de jeunes qui me ressemblaient quand j’avais vingt ans, en jeans, baskets… deux filles sont passées, comme à l’époque, quand on draguait, et j’ai entendu : « Alors, quand est-ce que tu viens à la mosquée, salope ? Je me suis dit que le logiciel est incroyablement planté, c’est la même chose pour le FLN, dont le logiciel date de 1954.

Louis Bénisti, « La darse »
Qu’est-ce que le logiciel du FLN exactement ?
C’est la pédagogie du FLN, la seule pédagogie politique qui existe en Algérie, c’est-à-dire la force, le parti unique, le marxisme tiers-mondain comme je l’appelle, dans lequel on peut mettre l’Angola, Cuba, Boumediene. C’est un marxisme encore d’actualité, dont est issu Saddam Hussein, dont est issu Kadhafi, dont est issu le père d’Assad, dont est issue l’Algérie avec Boumediene. C’était un mix entre un socialisme petitement marxiste et l’islam, mais c’était la nouvelle identité arabe, alors que personne n’avait dépassé la page 10 du Capital. C’étaient des bourrins, des petits militaires de caserne qui se retrouvaient chefs d’État ou ministres. Boutef a été ministre à 26 ans, pour un pays qui fait cinq fois la France.
Vous êtes pessimiste.
Pessimiste… oui, non, plutôt exigeant. Très exigeant, même. Je n’oublierai jamais les 600 morts d’octobre 1988. J’étais dans la rue, j’ai vu des bus renversés, en flammes, j’ai vu l’armée tirer au fusil-mitrailleur. J’ai la vision, que j’ai mise dans Les oranges, d’une gamine de quinze ans coupée en deux par un tir de fusil-mitrailleur. Je n’oublierai jamais. Après, ils te disent qu’on est tous des frères.
Il suffit d’une petite bavure pour que tout bascule.
Vous êtes né en 1951, quand je vous ai connu, au début des années 2000, vous n’étiez jamais retourné en Algérie, aujourd’hui vous y retournez tous les deux ans environ.
J’y retourne de moi-même, je n’ai jamais été invité comme écrivain. Mon écriture ne les intéresse pas, elle n’est pas assez nationaliste. J’ai inventé une phrase : j’ai perdu la nation comme j’ai perdu la foi. On ne me pardonnera jamais de perdre la nation… dans mon travail. Ce qu’ils adulent, c’est l’écrivain nationaliste, y compris en France. Les écrivains algériens qui marchent en France sont les écrivains qui parlent de l’Algérie de manière nationaleuse : le terroir, les figuiers, la femme exploitée… Il n’y a pas de risque littéraire, de littérature en elle-même.
Un adjoint d’un ministre algérien m’a demandé ici, à Paris, dans un salon : « Ça parle de quoi ton livre, Les oranges ? Dans quelle mesure c’est utile pour la nation ? » Ils t’enjoignent de te mettre au garde-à-vous. Sa question résume tout, et ça rejaillit en France.
Vous ne vous considérez pas comme un écrivain algérien, ni comme un écrivain français.
Je me dis écrivain francophone. On met les frontières de côté et on reste sur la langue.
Vos pièces sont-elles jouées en Algérie ?
Jamais. Baya, en 1992, c’était discret. L’édition Bleu autour n’est pas distribuée en Algérie, où elle coûterait l’équivalent de 700 balles pour un ouvrier. 13 euros, c’est 1 300 dinars, près de 10 % de son salaire. Acheter un livre est le dernier des soucis des gens. Récemment, j’ai été à la foire du livre internationale annuelle et, à la sortie, j’ai vu des types avec des piles de livres religieux sur la tête, des livres qui partaient comme des petits pains. J’ai des copains éditeurs laïcs ou athées qui vendent eux-mêmes des livres religieux pour vivre, pour payer leurs impôts, leurs imprimeries, leurs employés.
Vous avez une image assez noire de l’Algérie.
Oui, une image de non-nationaliste, donc de traître à l’Algérie. Ce que j’ai de floral, c’est mon adolescence, les rêves que j’avais quand j’étais musicien. J’imaginais une autre Algérie, une Algérie où on pouvait jouer les Stones, où j’avais des copines d’avant-garde… Je doute que cette Algérie puisse revenir, parce que la conscience morale des jeunes est plus fermée qu’avant, sous couvert de Facebook, de smileys, etc.
Essayez de lire les auteurs algériens actuels, ils sont d’un platonisme époustouflant, il n’y a pas un seul mot sexuel, pas de plaisir sexuel, ça n’existe pas, le corps est banni, barré, ils écrivent comme il y a cinq ou six siècles en France, et encore vous connaissez Villon, Rabelais… Alors que dans n’importe quel bar d’Alger, n’importe quelle cour de récré, il faut entendre ce qu’ils disent… On pense que ce sont des écrivains courageux. Ce n’est pas vrai. Leur fonds de commerce, c’est l’islamisme. Pour moi, ce qui définit un écrivain sera toujours le style. Un écrivain forge son propre style, c’est ce qui le définit par rapport à un autre écrivain.
Quelle est votre langue maternelle ?
Ce que me parlait ma mère ? C’est extrêmement compliqué. Ma mère me parlait en berbère parce que, pour simplifier, je suis aussi d’origine berbère, comme 30 % de la population. La berbérité n’est pas seulement une langue, mais une façon de vivre, une ethnie, un peu comme les Corses ici. D’ailleurs, ils veulent leur autonomie. Ma mère me parlait aussi en français, elle me lisait les contes de Grimm en kabyle et en français. J’avais une double langue maternelle.
Autour de vous, qui parlait arabe ?
Jusqu’à l’âge de six ans, j’habitais en Kabylie, mon grand-père était le patriarche, qui gérait trois ou quatre familles. Quand ont commencé les premiers bombardements français, il a eu peur, il a fait émigrer les trois familles. On est partis en camionnette, en camion, vers la banlieue d’Alger. C’était le début de la guerre, ils tiraient sans aucune nuance sur les villages. J’ai découvert l’arabe en arrivant à Alger, c’était la langue de la rue, de mes copains de jeux. Ils parlaient en arabe dialectal. J’ai un fatras linguistique dans la tête.
Propos recueillis par Cécile Dutheil












