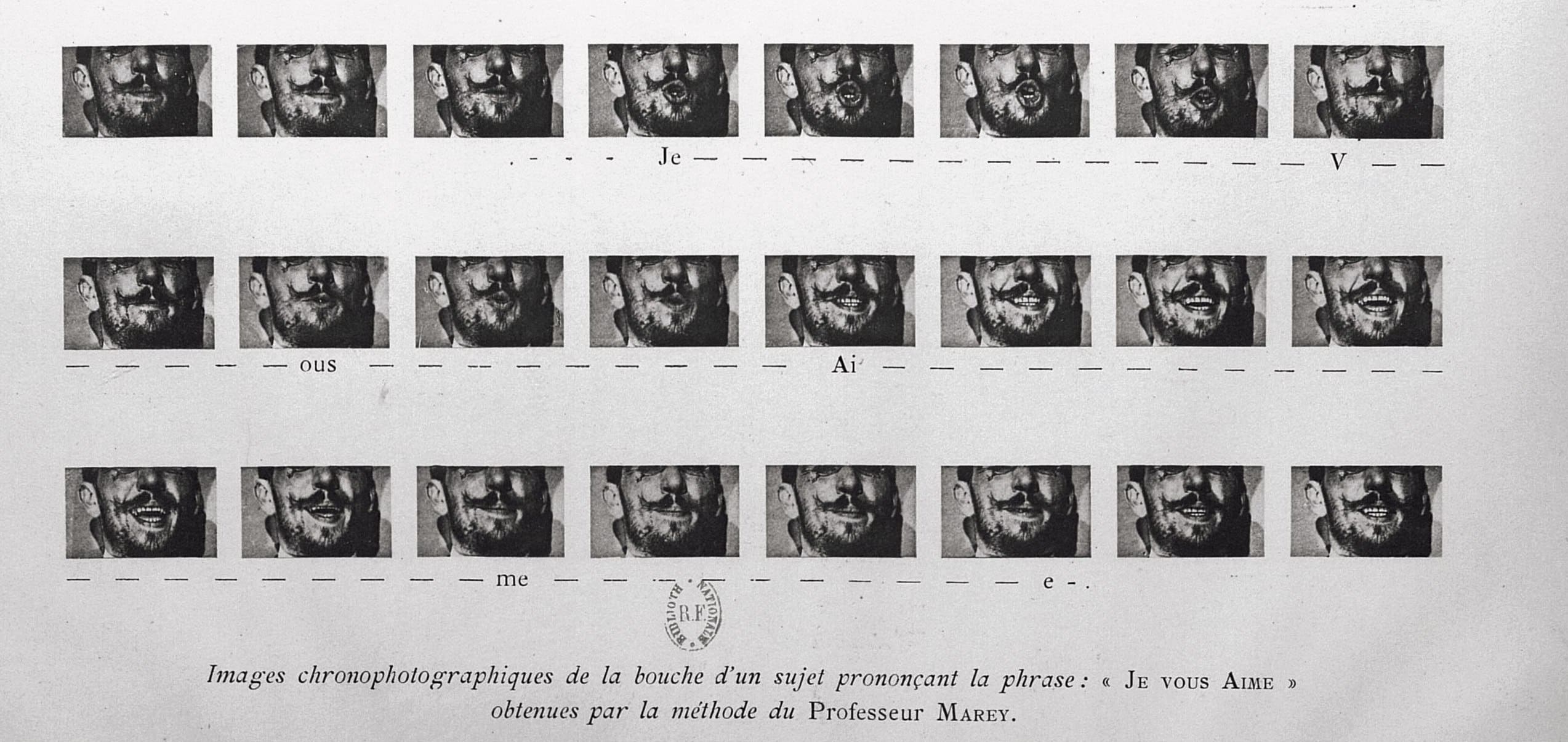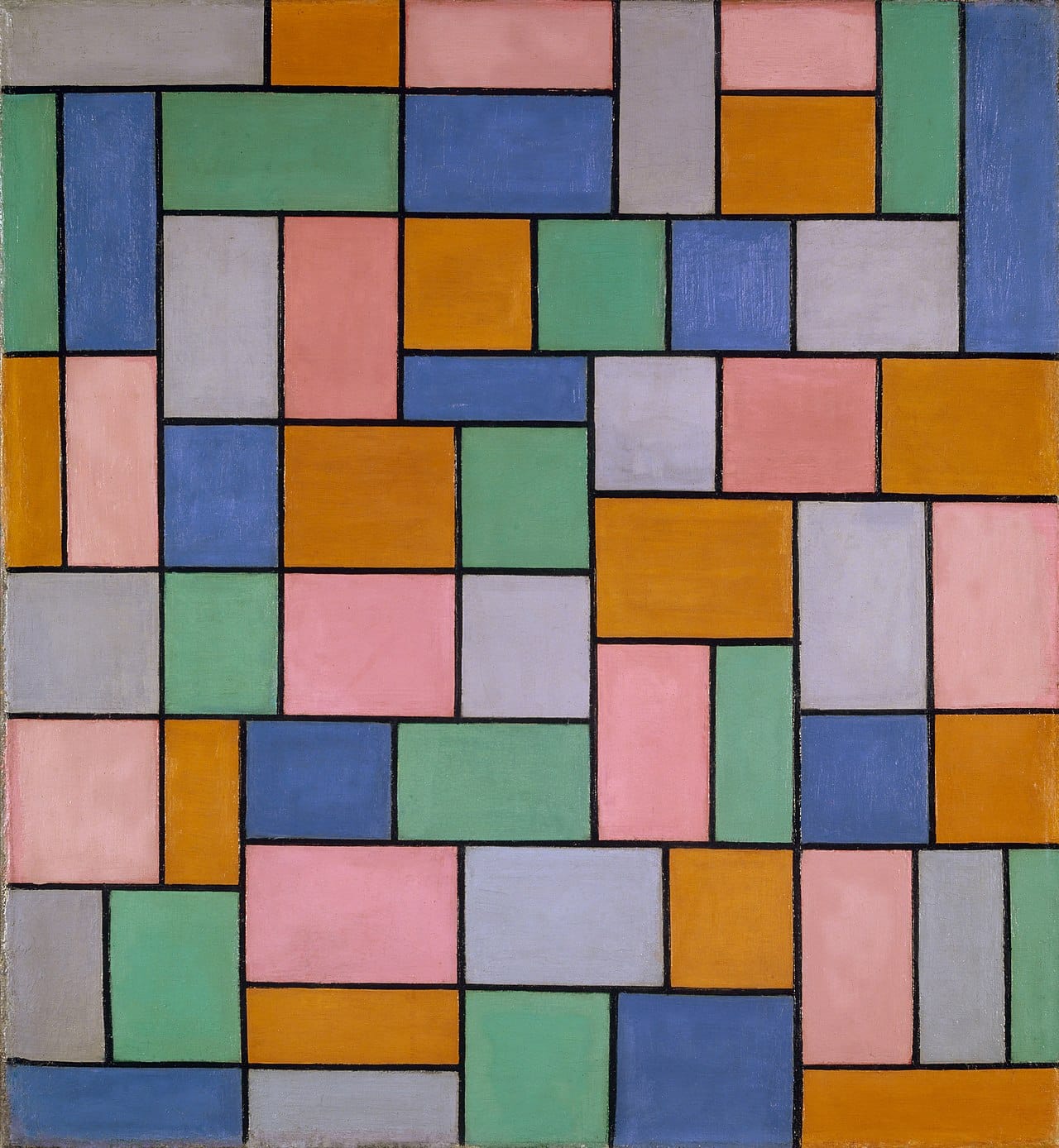Simon Leys lui avait consacré dix ans de sa vie : La mer dans la littérature française est une extraordinaire anthologie, qui reparaît aujourd’hui en un seul volume chez Robert Laffont
La mer dans la littérature française (de François Rabelais à Pierre Loti). Anthologie de Simon Leys. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1354 p., 33 €
Quand il publia Les habits neufs du président Mao en 1971, c’est-à-dire au moment où l’Occident n’avait toujours pas pris la mesure des désastres que la bande des quatre avait provoqués dans l’Empire du Milieu, cette partie du monde réputée si opaque, Simon Leys avait précisé en préambule que son livre se voulait juste le « témoignage d’une conscience forcée hors de sa retraite par le spectacle de ce qui lui semble être une gigantesque imposture », ajoutant que « malgré la véhémence qui perce parfois dans son propos, l’auteur ne croit détenir nulle certitude définitive ». Qu’il évoque la Révolution culturelle ou qu’il parle des Entretiens de Confucius (dont il donna d’ailleurs une version française en tentant, dit-il, de restituer « l’économie rugueuse et roublarde » de l’original) ; qu’il se fasse, comme dans Ombres chinoises, paru en 1974, le guide disposé à accompagner les voyageurs dans leur exploration de quelques hauts lieux touristiques, tels Suzhou ou Shaoshan, la ville natale de Mao, afin que ces étrangers égarés en Chine populaire dans ces années-là, malgré les « mesures prophylactiques visant à les isoler de la vie réelle », ne s’en tiennent pas à quelques images d’Épinal ; ou bien qu’il joue le rôle du grand lettré, rendant hommage à Stevenson, Gide ou Conrad ; qu’il revienne sur la traduction, dont il se demande si elle est un substitut de la création ou une œuvre d’amour dans laquelle le traducteur doit être l’homme invisible (lui-même a offert à ses lecteurs plusieurs traductions splendides, dont celle des Six récits au fil inconstant des jours de Shen Fu) ; ou que, sorti de son « studio de l’inutilité », il observe le monde et s’interroge sur ce qui restera de la révolte estudiantine après le massacre de Tiananmen de 1989, Simon Leys a toujours eu l’attitude d’un sceptique, prêt à renverser ce qui semble acquis, à remettre en question ce que tout le monde accepte comme une évidence. En se pénétrant de la pensée confucéenne, il s’est demandé comment une doctrine qui a inspiré tous les peuples de l’Asie orientale est devenue « synonyme d’obscurantisme et d’oppression », en se penchant sur quelques figures de la littérature française, il n’a jamais perdu de vue ce critère d’un art véritable édicté par Julien Green : « Les seules œuvres qui comptent sont celles dont on pourrait dire que leur auteur serait mort étouffé s’il ne s’en était délivré. »

Victor Hugo à Hauteville House (1868)
Grand érudit à l’esprit polémique, prompt à défaire toutes les réputations usurpées et toujours enclin à mettre à bas ce qui est communément célébré, Simon Leys a bâti son œuvre de réfractaire en emboîtant le pas à deux solitaires dont la lucidité inflexible est la meilleure armure qui se puisse trouver : George Orwell, auquel il consacra en 1984 un texte, Orwell ou l’horreur de la politique, et Lu Xun, dont il fait l’éloge dans un livre de 1983, La forêt en feu, soulignant que la grandeur de l’auteur de La mauvaise herbe ou de La véritable histoire d’Ah Q est d’avoir refusé la tentation de se réfugier « dans l’aveugle engagement partisan » ou de s’exiler « dans un individualisme misanthrope ».
Simon Leys s’est, lui aussi, efforcé d’éloigner de lui cette double tentation, peut-être grâce à une autre passion qui lui a permis de ne pas être un homme de lettres tout entier habité par le désir de gloire, ni un Alceste uniquement occupé à des querelles picrocholines. Cette passion, c’est la mer, dont Conrad, dans Jeunesse, dit qu’elle est une des grandes merveilles du monde. Cette passion a amené Simon Leys à traduire le roman de Richard H. Dana, Deux années sur le gaillard d’avant. Il avoue dans L’ange et le cachalot avoir réécrit trois fois le manuscrit de la version française et l’avoir gardé dix-huit ans sur le métier. Pour celui qui, en août 1958, alors qu’il était encore étudiant, avait navigué à bord d’un thonier breton (expérience contée dans un texte bref, Prosper), pour celui qui avait enquêté sur le naufrage, en 1629, du Batavia, et le massacre des survivants par l’un d’entre eux, un gourou plus que dément, il fallait unir ses deux passions, la mer et la littérature, en offrant aux terriens aussi bien qu’aux aventuriers des océans un « singulier monstre marin » : une monumentale anthologie, donnant à lire les plus fameuses pages sur la mer dans la littérature française, qui demanda dix ans de travail et ne s’acheva qu’en 2003. Elle devait voir le jour dans la collection « Bouquins » des éditions Robert Laffont. Finalement, après quelques aléas éditoriaux, elle fut publiée en deux volumes chez Plon. Elle reparaît aujourd’hui dans la collection à laquelle elle était naguère destinée.
C’est un imposant volume de plus de mille pages, consacré, rappelle Simon Leys, à la mer dans la littérature et non à la littérature de la mer. Placée sous l’égide de Su Dongpo, lettré chinois du XIe siècle (« Je vais larguer l’amarre de mon petit bateau et confier ce qu’il me reste de vie aux fleuves et aux mers »), l’anthologie renferme une multitude de textes propres à entretenir les rêveries autour de l’eau, et donne raison à Baudelaire qui recommandait à l’homme libre de chérir la mer, son miroir. Les pages les plus savoureuses du volume sont sans doute celles qui, à rebours du projet, proclament l’impossibilité d’une littérature marine. C’est Théophile Gautier qui, dans un article de 1836, avoue son ignorance des choses aquatiques, son impatience devant les œuvres océaniques d’Eugène Sue, car il est incapable de distinguer la proue de la poupe d’un vaisseau et refuse d’apprendre par cœur le dictionnaire de marine et de « se loger dans la tête le vocabulaire le plus formidable et le plus incongru qui se puisse imaginer ». Une fois débarrassé de cette mauvaise humeur, le lecteur doit encore compter avec les écrivains qui souffraient du mal de mer, comme Montesquieu, et ne s’intéressaient guère à ce qui, au contraire, allait faire les délices d’un Hugo, qui déclarait avoir eu deux affaires dans sa vie : Paris et l’Océan, où il trouvait des « abîmes de poésie », et n’hésitait pas à appeler les génies des siècles passés des « hommes océans », dans l’esprit desquels se retrouvent « cette âcreté utile, cette amertume qui fait l’assainissement de l’univers, cet âpre sel sans lequel tout pourrirait », en un mot tout ce qui, d’après lui, définit les profondeurs marines.

Arnold Bocklin, L’île des morts (1886)
S’il glisse avec malice dans son anthologie une réflexion de monsieur Prudhomme : « Une telle quantité d’eau frise le ridicule… Et encore, on n’en voit que le dessus », s’il se moque doucement de Racine qui vire au carton-pâte quand il évoque une tempête en mer (« Cependant sur le dos de la plaine liquide / S’élève à gros bouillons une montagne humide »), s’il rappelle sur un ton pince-sans-rire que Léon Bloy est parvenu à écrire tout un livre sur Christophe Colomb sans parler de la mer, si, à la confrérie de ceux qui, Rabelais en tête, savent exploiter les « ressources expressives du langage de la mer », et au club des auteurs de belles pages maritimes, il n’a pu adjoindre que deux noms de femmes, Madame de Staël et George Sand, Simon Leys paraît s’être délecté à composer cette anthologie où Forbin, le marin de Louis XIV, croise Louis Garneray, médiocre peintre soupçonné d’avoir eu recours, dans ses livres, aux services d’un nègre, où le trop méconnu J.M. Levet, si cher à Valéry Larbaud, côtoie « l’Émigrant de Landor Road » d’Apollinaire, où il y aurait une intéressante étude comparative à faire entre les poulpes chez Jules Verne et ceux qui sévissent chez Hugo, où Michelet rappelle que « toute nation a ses récits, ses contes sur la mer. Homère, Les Mille et Une Nuits, nous ont gardé un bon nombre de ces traditions effrayantes, les écueils et les tempêtes, les calmes non moins meurtriers où l’on meurt de soif au milieu des eaux, les mangeurs d’hommes, les monstres, le léviathan, le kraken et le grand serpent de mer, etc. », où Lautréamont, invoquant le « vieil Océan », voit en lui le symbole de l’identité, tandis que pour Tristan Corbière (dont on apprend au passage que son père, homme d’affaires, avait des ambitions littéraires et était l’auteur de nombreux romans maritimes) la houle se soulevant à l’horizon est semblable au « ventre amoureux » d’une « fille de joie en rut »…
Simon Leys était fasciné par L’Île des morts de Böcklin, où l’eau et les ténèbres semblent réunies pour des noces macabres. Mais dans cette riche anthologie, celui qui avait quitté la Belgique pour l’Extrême-Orient puis pour l’Australie, donne le sentiment d’avoir atteint le dernier degré de métamorphose d’un Protée tour à tour savant, virulent, joueur et ironique, mais toujours ennemi des mensonges collectifs et passionnément épris ce qui se singularise, ce qui nous transporte aux antipodes, loin de ce que Nabokov nomme la « Compagnie Internationale des Grands Clichés », plus près des ailleurs qui ne sont en aucune façon synonymes d’exotisme.