Voit-on plusieurs questions ou plusieurs aspects de la même question quand on confronte foi et savoir, religion et politique, Église et État, spirituel et temporel ? Il est clair, en tout cas, que la diversité de ces approches retentit sur les réponses vers lesquelles on se dirige, en particulier si l’on veut donner à entendre à un non-Français ce qu’il en est de la laïcité. On peut juger choquante celle qui aborde le débat par le biais le moins noble qui soit : l’argent. On peut aussi la juger éclairante.
Françoise Hildesheimer, Rendez à César : L’Église et le pouvoir. IVe-XVIIIe siècle. Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », 396 p., 24 €
Archiviste et conservateur général du Patrimoine, Françoise Hildesheimer est, en tant qu’historienne, principalement dix-septièmiste et spécialiste de Richelieu. Ce n’est pas seulement pour cette raison que la majeure partie de son nouveau livre est consacrée au Grand Siècle. Ce moment étant celui où elle décèle un tournant dans les relations entre l’Église et l’État, elle peut à juste titre le prendre comme point de vue à partir duquel considérer les relations entre ces deux institutions. On pense bien sûr à l’affirmation gallicane, même si celle-ci avait déjà été formulée dans la pragmatique sanction de Bourges édictée par Charles VII en 1438 – mais il y avait eu ensuite la Réformation, suivie du combat pro-catholique de la monarchie française. Le retournement peut être attribué à Richelieu qui, quoique cardinal, a fait passer la raison d’État avant les intérêts de l’Église, n’hésitant pas même à s’allier à des puissances protestantes contre des pays catholiques.
Il n’est pas surprenant que cette historienne relate en détail les dispositions prises aux diverses époques tant par la monarchie française que par la papauté, et s’efforce d’en évaluer les conséquences directes et indirectes. C’est ainsi qu’elle attribue une importance considérable à la bulle Unigenitus dans l’héritage négatif laissé par Louis XIV. On peut être plus sensible encore à la part qu’elle accorde aux questions d’argent. Françoise Hildesheimer n’est pas hostile à l’Église quand celle-ci décide de prendre en compte « la tension entre une tentation d’opulence et un idéal évangélique de pauvreté » et donc de « mettre l’accent sur les conditions très matérielles de la réalisation de cet idéal », lesquelles forment le contrepoint d’une histoire « trop exclusivement nourrie de spiritualité ». Ce n’est pas dénier l’importance de la spiritualité que de refuser de la dissocier de ses conditions matérielles : comme le reconnaissait un mauriste du XVIIe siècle, « la bonne administration temporelle contribue beaucoup à la spirituelle ».
Avant même Luther, une des constantes du discours anticatholique aura été de mettre en cause la richesse de l’Église, de la juger excessive par son existence même puisque contradictoire avec l’idéal évangélique de pauvreté. Le pape actuel en est conscient, qui se réfère à François d’Assise alors que, jésuite, il aurait pu, en choisissant ce nom, vouloir rendre hommage à saint François-Xavier ou à saint François Borgia, fondateur et troisième général de la Compagnie de Jésus. Françoise Hildesheimer n’entre pas dans le débat théologique sur l’authenticité chrétienne d’une Église à ce point soucieuse de sa propre richesse. Elle se contente d’énumérer les divers impôts prélevés par l’institution et de donner des chiffres dont l’énormité est en elle-même très parlante. Richelieu estime en 1625 que « le clergé possède le tiers des biens du royaume ». Vers 1789, le patrimoine ecclésiastique atteint « 40 % du produit national brut de la France ». Pour le dire autrement, le revenu ecclésiastique est alors comparable au montant total des impôts directs. S’il est acquis que l’Église a de gros besoins financiers, la question est de savoir comment elle se procure les ressources nécessaires – et ce ne peut être qu’en entretenant des relations serrées avec le pouvoir politique, seul à même de fournir la force de contrainte indispensable au recouvrement de telles sommes.
Inutile d’argumenter sur le point de savoir si l’Église a vraiment besoin d’être aussi riche pour aider les pauvres, puisque dans les faits elle n’a cessé de se comporter en ce sens. On pourrait d’ailleurs discuter à l’infini si et dans quelle mesure Jésus faisait une apologie de la pauvreté au sens pécuniaire du terme ; ce n’est en tout cas pas ainsi qu’un calviniste voit les choses, or il ne se réclame pas moins du christianisme que l’Église catholique. Le petit jeu qui consiste à opposer les discours de Jésus aux pratiques de l’Église a quelque chose de stérile, comme toutes les manières que l’on peut trouver d’opposer une institution à l’idéologie qu’elle revendique. Il s’agirait plutôt ici d’une question de cohérence interne.
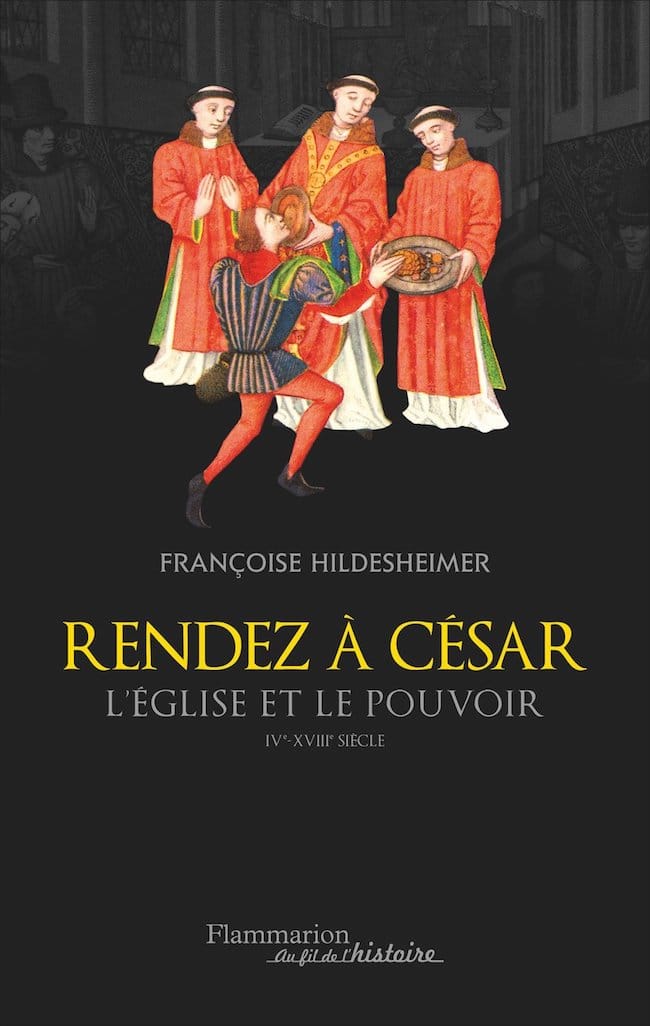
Une des caractéristiques du christianisme est en effet la stricte distinction des clercs et des laïcs qui, s’exprimant de multiples manières dont celle du spirituel et du temporel, justifie l’existence même de cette institution à nulle autre pareille qu’est l’Église. Son fondement théorique est la maxime évangélique de rendre « à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Dès lors que l’Église a d’aussi énormes besoins d’argent et qu’elle se donne les moyens de les satisfaire, elle ne peut plus faire comme si elle ne se préoccupait que du spirituel. Elle devient un acteur du pouvoir temporel, parfois même le principal. Succédant en quelque sorte aux empereurs romains, la papauté est ainsi devenue la puissance politique dominante de l’Europe occidentale, mais elle n’est pas seule en cause dans ce processus de sécularisation. C’est à tous les niveaux de la société que prêtres, abbés, évêques, deviennent des puissances politiques. Il ne faut donc pas s’étonner que l’on finisse par voir nommés évêques ou abbés des hommes qui n’ont même pas reçu l’ordination ou prononcé les vœux.
Cette énorme richesse est justifiée par la mission que s’assigne l’Église d’aider les pauvres. Ce qu’elle fait en créant hôpitaux généraux ou dépôts de mendicité. Françoise Hildesheimer remarque malicieusement que « le grand élan de charité incarné par Vincent de Paul » est contemporain du « grand renfermement décrit par Michel Foucault ». C’est que l’image des pauvres a changé à partir du XVIe siècle. Alors que « la vision médiévale était celle d’une image du Christ salvateur visant à transformer le cœur de celui qui donnait » aux pauvres, « la pauvreté a tendu à quitter la sphère théologique pour devenir un problème politique ». D’où à la fois l’action d’un Vincent de Paul et le grand renfermement. Si l’on dresse un bilan à la veille de la Révolution, on peut faire crédit à l’Église gallicane d’avoir construit « une structure paraétatique souvent plus efficace et cohérente que l’État monarchique en osmose avec lequel elle agissait ». C’est cette osmose qui fait problème, moins en termes moraux ou politiques qu’en ce qui concerne l’Église elle-même : dans une alliance aussi serrée entre l’autel et le trône, ce n’est pas le temporel qui perd son âme mais le spirituel : à terme, que peut-il rester de cette institution qui prétendait ne voir dans le temporel qu’un moyen pour le spirituel ? Guère plus d’un siècle après la Révolution, l’Église était confrontée à la loi de 1905 qui la dépouillait de toute sa dimension temporelle. Dès lors que la puissance publique prend en charge les pauvres et les malades, l’Église perd la justification de sa richesse. Le clergé aura désormais toute latitude de faire « primer le spirituel » et même de s’y consacrer exclusivement.
On peut considérer la laïcité à la française comme la suite et la conclusion de toute la démarche gallicane, ce qui expliquerait qu’elle soit si mal comprise dans des nations qui n’étaient pas « fille aînée de l’Église » et où les liens des deux institutions n’ont pas acquis la même force. Ce n’est pas le roi de France qui dut aller à Canossa mais c’est peut-être parce que le conflit entre l’empereur germanique et le pape aura été aussi constant que les Allemands sentent moins l’importance de la laïcité. Ils ont d’ailleurs pratiqué de longue date la sécularisation, au moins à partir de Luther.
L’incompréhension que suscite à l’étranger la notion française de laïcité peut étonner dans la mesure où la distinction du clerc et du laïc est une constante fondamentale du christianisme. On pourrait définir la laïcité comme ce qui est propre à tous les non-prêtres, par exemple, en pays catholique, le fait de pouvoir se marier. Auquel cas n’importe quel citoyen d’un pays marqué par le christianisme devrait aisément comprendre de quoi il s’agit. S’il n’en va pas ainsi, c’est que la notion de laïcité est à rapprocher du mot laïque, qui désigne non pas le non-clerc mais celui qui veut séparer la société civile de la société religieuse, le temporel du spirituel. Quand, au XVIIe siècle, un aristocrate pouvait devenir évêque sans avoir été ordonné prêtre, on aurait pu dire que cet évêque était un laïc mais certainement pas un laïque.
Le paradoxe veut que ce soit précisément l’énormité du pouvoir temporel de l’Église qui l’ait conduite à tenir dans la société un rôle dont il est finalement apparu possible de l’exclure, une fois que la puissance publique eut repris à son compte les tâches qui justifiaient cette puissance matérielle. L’Église de France s’est ainsi sécularisée elle-même.












