Jennifer Richard livre le troisième volet, entre flip book augmenté et théâtre d’ombres, d’une ample fresque consacrée aux déploiements mortifères de l’impérialisme à la conquête de l’Afrique centrale, du dernier quart du XIXe siècle à la Grande Guerre. À partir de la matière-Congo et sur trois continents, elle retrace la geste kaléidoscopique de l’ensauvagement du monde par un capitalisme inventeur de la race, et les atrocités qui escortent ce dernier jusqu’à nos jours.
Jennifer Richard, Notre royaume n’est pas de ce monde. Albin Michel, 736 p., 24,90 €
Ota Benga – personnage réel comme tous ceux du livre –, Pygmée d’Afrique centrale, fut l’attraction de zoos humains : en 1904, lors de l’Exposition universelle de Saint-Louis (Missouri), puis aux côtés de grands primates au zoo du Bronx où l’avait abandonné son mentor et supposé ami, l’aventurier Samuel Phillips Verner. En mars 1916, ayant compris que son long séjour outre-Atlantique avait fait de lui un autre et que sa forêt natale n’était plus, il se donna la mort, recouvrant ainsi la maîtrise de son existence. Ce suicide ouvrait Il est à toi ce beau pays (2018), premier volet, couvrant pour le reste la période 1873-1891, de la trilogie de Jennifer Richard, dont chaque volume peut sans dommage être abordé de façon indépendante.
Notre royaume n’est pas de ce monde restitue à ce jeune homme né en 1883 l’incommensurable richesse de sa courte vie. Dans ce nouveau roman retraçant les deux décennies 1896-1916, le natif de la forêt d’Ituri, jadis au rang de « ceux qui ne comptent pas » et autres « non-personnes », devient un protagoniste majeur aux côtés d’une foule de personnages historiques, retenus ou non par le Grand Récit colonial. Et surtout, il est le narrateur d’une saga ainsi muée principiellement en contre-récit.

Jennifer Richard © Pascal Ito
Roman historique étayé comme les précédents volumes (paru en 2021, Le diable parle toutes les langues opérait un gros plan sur le marchand d’armes Basil Zaharoff) sur une documentation et une bibliographie impressionnantes, Notre royaume n’est pas de ce monde se colore cependant – d’où le titre – d’une once de réalisme magique. « Quelque part, dans une dimension parallèle », Ota Benga a en effet convié autour d’un cocktail post mortem un concile des assassinés « pour leurs idées ». On y trouve Martin Luther King et Malcolm X qui se chamaillent, Rosa Luxemburg et Thomas Sankara qui sympathisent, Jean Jaurès et Émile Zola écumant Wikipédia sur un smartphone, Patrice Lumumba, Che Guevara, Modibo Keita, Pier Paolo Pasolini ou… Samuel Doe « qui fait peur à tout le monde », Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi et Oussama Ben Laden. Du haut de son hamac, Pierre Savorgnan de Brazza, mort en 1905 après avoir consommé un ragoût de chèvre suspect – et rédigé le rapport Brazza, publié en 2014 seulement –, survole les conversations.
Devant ce public choisi, un Ota Benga montreur d’images orchestre le défilement des scènes de la prédation coloniale, qui est alors à son acmé. De Bruxelles, Paris ou Londres à la forêt d’Ituri, de Luebo, Boma ou Mushenge à Boston, Walhalla ou Lynchburg, sa lanterne magique jette la lumière sur ses profiteurs veules – au premier rang desquels Léopold II, « ogre » vieillissant, et sa maîtresse, Blanche Delacroix, « le genre de femme à vous faire aimer les blattes » –, ses défricheurs d’hommes, ses ultimes aventuriers ambigus. Elle révèle aussi la mutation, en témoins de l’horreur perpétrée au Congo, d’une poignée d’hommes et de femmes de bonne volonté : deux couples de missionnaires, un nationaliste irlandais, un journaliste britannique, les fondateurs de l’American Congo Reform Association. Piégés de l’autre côté de l’Atlantique, deux guerriers tetela devenus prédicateurs et le Pygmée errant subsistent en vigies orphelines de mondes défunts.
Comme dans le premier volet de cette trilogie, les trois fils de l’emprise coloniale belge et française en Afrique centrale, de la confrontation brutale des impérialismes européens et de la marche heurtée vers l’émancipation des Noirs d’Amérique s’entrelacent. À l’anéantissement du royaume kuba au Kasaï, à la suite d’une bourde funeste de Verner ayant mentionné du « cuivre » dans une missive, répondent les lynchages dans le Sud états-unien : faisant de la mort d’un homme un « évènement sacré », la foule des lyncheurs « se dispute les restes d’un corps humain » pour les vendre.
Le défilement des scènes du théâtre nécropolitique du racisme et du colonialisme est scandé par les séquences consacrées au cocktail sine die, qui rappellent le sort de ses participants. L’ensemble compose le film global d’un impérialisme dont Ben Laden n’est qu’une des créatures. Une autre scansion, d’images rebelles celle-là, vient s’interposer entre l’imagerie coloniale et son hégémonie : les descriptions de clichés Kodak saisis par Alice Seeley Harris, missionnaire britannique. L’un montre, enveloppés de quelques feuilles dans une corbeille, les mains et les pieds coupés d’une petite fille et de sa mère, mutilées pour l’exemple. La révélation de l’ampleur industrielle des crimes commis au Congo s’intégrera, avec les développements de la photographie, au story board de l’entrée dans le XXe siècle. Fin 1901, le journaliste Morel se remémore, devant la statue du géant Brabo, la légende du port d’Anvers : « hand werpen, jeter la main ». Lorsqu’en 1910 Blanche Delacroix, dont le deuxième fils est né sans main gauche, héritière de « sommes délirantes » à la mort de Léopold II, est demandée en mariage par son amant français, ce n’est plus qu’une farce : « Assez, avec ces histoires de mains ! »
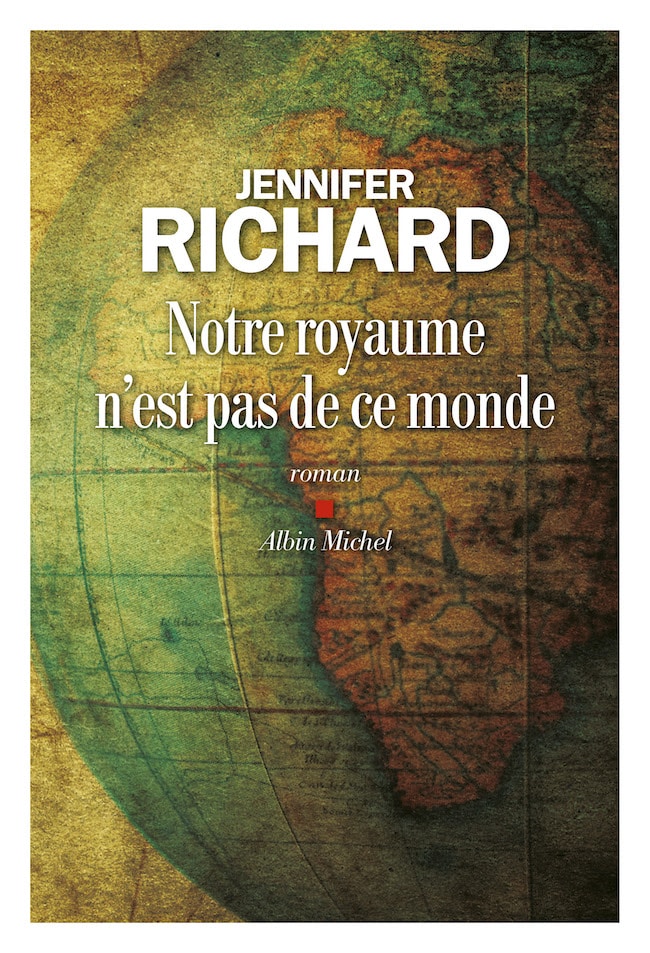
Aimé Césaire l’a établi en 1950, le roman de Jennifer Richard s’en souvient : « le geste décisif » est celui « de l’aventurier et du pirate », « de l’appétit et de la force », avec, « derrière, l’ombre portée, maléfique, d’une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d’étendre à l’échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes ». Le Congo – domaine privé de Léopold II avant de passer sous la coupe de l’État belge quand le scandale déborde, mais le Congo de l’autre rive et l’AEF ne sont guère en reste – fournit le paradigme de ce geste, de ses retombées et des ténèbres qui en découlent jusqu’à présent. Joseph Conrad hante naturellement le récit, le Céline des Lettres et premiers écrits d’Afrique ou du Voyage aussi. Depuis l’autre scène d’où il opère, le Pygmée dont la trajectoire a croisé celle de Geronimo livre un apologue limpide : « Pourquoi faut-il en permanence vous rappeler l’humanité de l’Autre pour que vous ressentiez quelque chose ? Qui pleure les derniers Pygmées des forêts, égorgés à l’heure des réseaux sociaux et des QR-codes ? C’est l’appel du coltan, du cuivre et du nickel. Si vous écoutez bien, vous entendrez aussi celui de la terre rare. Quand vous répondez à cet appel », alerte-t-il alors qu’un smartphone sonne dans l’assemblée, « il est déjà trop tard. Nous avons disparu ».
Tout ou presque est réel dans ce roman, y compris ce qui excède l’imagination. Dans la bibliographie, prennent place, à côté de Mark Twain (Le soliloque du roi Léopold) ou Conan Doyle (The Crime of the Congo), Les fantômes du roi Léopold (1998) d’Adam Hochschild et Congo, une histoire (2012) de David Van Reybrouck. Le roman historique et son implacable érudition se superposent cependant à l’archive, sauf en fin de volume où celle-ci affleure en coupures de presse. Rejoignant d’autres silhouettes sur les pages de ce méga flip book verbal, les rares subalternes dont une mémoire ait été conservée intègrent avec les témoins un théâtre d’ombres – Brazza quant à lui aura été piégé au XXIe siècle dans un mausolée.
Le statut d’Ota Benga vacillait déjà de son vivant : « Plus tard, lors de ses entretiens à la presse, [Verner] affirma qu’il m’avait acheté à des marchands d’esclaves et qu’il m’avait sauvé la vie. C’est la version que l’on retient aujourd’hui ». Saddam Hussein réagit : « Vous êtes connu ? Je croyais que vous n’étiez qu’un personnage fictif venu nous raconter une histoire. » Le dispositif de monstration autorise exhibition ludique des chevilles narratives et anachronismes verbaux, illustre les temporalités enchevêtrées de la postcolonie décrites par Achille Mbembe. Dans Le feu des origines (1987), Emmanuel Dongala avait incarné une histoire du Congo en Mandala Mankunku, homme-prodige et syndicaliste, en constituant sa légende merveilleuse en moteur du récit. Ici, le choix d’une narration de marionnettiste, plutôt que de servir la puissance de la fabula, en affaiblit la portée subversive, le contre-récit ne pouvant s’affranchir complètement de l’imagerie d’Épinal dont il procède.
« Même morts, surtout morts, nous incitons les hommes à la réflexion », affirment de concert, victimes d’une probable illusion, Brazza et Jaurès, le premier polyglotte en langues africaines comme européennes, le second joyeux d’accueillir dans son univers de pensée « un Pygmée occitan », mais infichu de retenir ou de prononcer correctement les noms africains. Il y en a pour confondre Rosa Parks et Luxemburg : ce sont « des noms de parcs », la seconde ayant beau protester depuis les pages du livre, sa mésange à l’épaule. Le raout funèbre des grandes espérances vaincues est peuplé d’icônes désabusées. Flottant, en vertu d’une forme d’ironie postmoderne, dans le Walhalla parfois peu regardant des martyrs de l’histoire et de l’impérialisme, les fantômes de Rosa Luxemburg et sa mésange, Ken Saro-Wiwa, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et quelques autres (le lecteur choisira les siens) sont piégés dans le rêve d’Autrui (Joseph Tonda, Afrodystopie, 2021), matérialisé par les fontaines à champagne à leur disposition. Est-il possible qu’ils mobilisent encore, dans le « combat toujours recommencé » contre les têtes renaissantes de « l’hydre coloniale », « la puissance de l’eau » ?












