Les altruistes, premier roman d’Andrew Ridker, raconte la chute d’un patriarche à Saint-Louis, déshérité par sa femme mourante et renié par ses enfants. En attendant Nadeau a pu rencontrer ce jeune auteur américain qui s’inscrit en faux contre l’héritage de Saul Bellow et de Philip Roth.
Andrew Ridker, Les altruistes. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Olivier Deparis. Rivages, 464 p., 23 €

Andrew Ridker © George Baier
Vous avez écrit ce roman tout suite après la fin de vos études.
En 2014, je venais d’avoir mon diplôme à la Washington University à Saint-Louis, et j’ai déménagé à New York. Mes amis se dispersaient : certains partaient pour des postes lucratifs dans la finance, d’autres pour des carrières plus altruistes, dont l’enseignement. Il me semblait que chacun des deux groupes était en porte-à-faux : je portais un jugement sévère sur mes amis de Wall Street ; alors que les autres me racontaient que leur employeurs manquaient d’argent ou que leurs élèves étaient indisciplinés ou qu’eux-mêmes ne se sentaient pas bien préparés. Donc j’ai conçu ce personnage (Maggie), habitant dans mon quartier, dont la vue depuis sa fenêtre était celle que j’avais de mon appartement.
Vous viviez dans quelle ville ?
Dans le Queens. Donc j’ai créé une sorte d’alter ego du point du vue des détails ; j’avais écrit soixante pages lorsque je me suis rendu compte qu’elle ne pouvait soutenir toute seule ce projet. J’ai commencé à développer son frère, son père et sa mère, et j’avais alors affaire à un roman de famille. Que faire de tous ces personnages ? quelle serait l’intrigue ? D’où cette idée d’une histoire tournant autour d’un héritage tronqué où le père court après l’argent de ses enfants.
D’autres romans de famille vous ont-il influencé ?
Les corrections (de Jonathan Franzen) est l’un des premiers livres pour adultes que j’ai lus en dehors de la classe. Un autre livre important a été De la beauté de Zadie Smith – bien qu’il y ait là deux familles –, pour sa façon de traiter le thème de la politique sur le campus ainsi que les questions de race et de classe.
Quant à Franzen, en ce qui concerne l’histoire de l’héritage, votre roman ressemble à Phénomènes naturels, si ce n’est, plus généralement, aux Corrections.
Pour la confluence d’idées, de la politique et de la critique sociale, tout cela enraciné dans une histoire très humaine. Et puis pour ses personnages peu aimables, qui ne cessent d’échouer et qu’on apprécie à cause de leurs problèmes. Sinon, j’aime beaucoup les grands écrivains juifs de l’après-guerre, Philip Roth et Saul Bellow. Lorrie Moore aussi fait partie de mes préférés, avec Edith Wharton : toutes ces comédies de manières, avec leur côté ironique et mordant allié à un élément de commentaire social.
Comme Franzen, vous affectionnez les personnages acariâtres.
Je n’ai jamais compris ce débat sur l’amabilité des personnages. Même dans la vraie vie, lorsqu’on rencontre un saint, on est un peu méfiant : il nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes. Un roman doit être – pardonnez la formule ! — un « endroit sûr » (« safe space », selon le langage du politiquement correct américain), où il est admis que rien n’est réel, où aucune personne réelle n’est blessée. Il me semble que certains lecteurs confondent lecture et réalité. J’ai toujours été attiré par des gens qui révèlent leur face affreuse ou égoïste, ça me soulage, ça crée un sentiment d’intimité, comme si on était libéré de la honte. En ce qui concerne Franzen, la honte et la culpabilité jouent un rôle important dans son œuvre.
Arthur est un peu égoïste, non ?
Oui ! Tout en constituant un hommage aux héros figurant chez Roth, Bellow et Updike, il les interroge. J’adore ces livres-là, j’ai grandi avec, je les empruntais dans la bibliothèque de mes parents. En même temps, ces personnages narcissiques et destructeurs ont mal vieilli. Pour ma génération, même si on apprécie la prose et les idées, on y trouve un certain aveuglement sur les questions de race ou de genre. Donc j’ai cherché à dépouiller ce héros de son autorité, de son pouvoir et de son argent. Concernant Herzog (héros éponyme du roman de Bellow), je me demandais : que se passerait-il si sa femme et ses enfants avaient chacun un chapitre qui leur était consacré ? De cette manière, on verrait l’incidence de ses actes sur eux.
Lequel des romans de Roth vous a le plus influencé ?
La tache, pour la manière dont le monde politique en dehors du cadre du roman – le politiquement correct et le scandale de Monica Lewinsky – infiltre le livre. Et puis le fait que Coleman Silk, professeur autrefois adulé, a injustement perdu son poste : la grande figure d’autorité réduite à recoller les morceaux de sa vie a influé sur le portrait d’Arthur.
Bellow et Roth font aussi subir des humiliations à leurs héros.
C’est vrai, mais leurs personnages demeurent héroïques, aspect que j’ai cherché à retenir tout en créant des points de vue multiples, un arrangement polyphonique. Aujourd’hui, quand je lis Herzog, je voudrais savoir ce que sa femme pense, ou même ce que pense Valentine (son meilleur ami et amant de sa femme), afin de sortir de la tête du héros, pour respirer, voir les choses sous un autre angle, obtenir un panorama de 360°, au lieu de rester confiné. Là aussi, c’est peut-être l’influence de Franzen, ainsi que de Zadie Smith, d’Eugenides et de tous ceux qui passent d’une perspective à l’autre.
Le titre fait écho à Franzen, même dans son ambiguïté.
En fonction du personnage, ce titre paraît plus ou moins ironique : Maggie s’affiche altruiste en public mais est égoïste en privé, tandis qu’Arthur, après avoir débuté comme elle, s’est transformé en cynique et en anti-philanthrope. Quant à Francine, elle a sacrifié sa carrière pour sa famille : son rôle de mère et de thérapeute la rend généreuse pour son entourage.
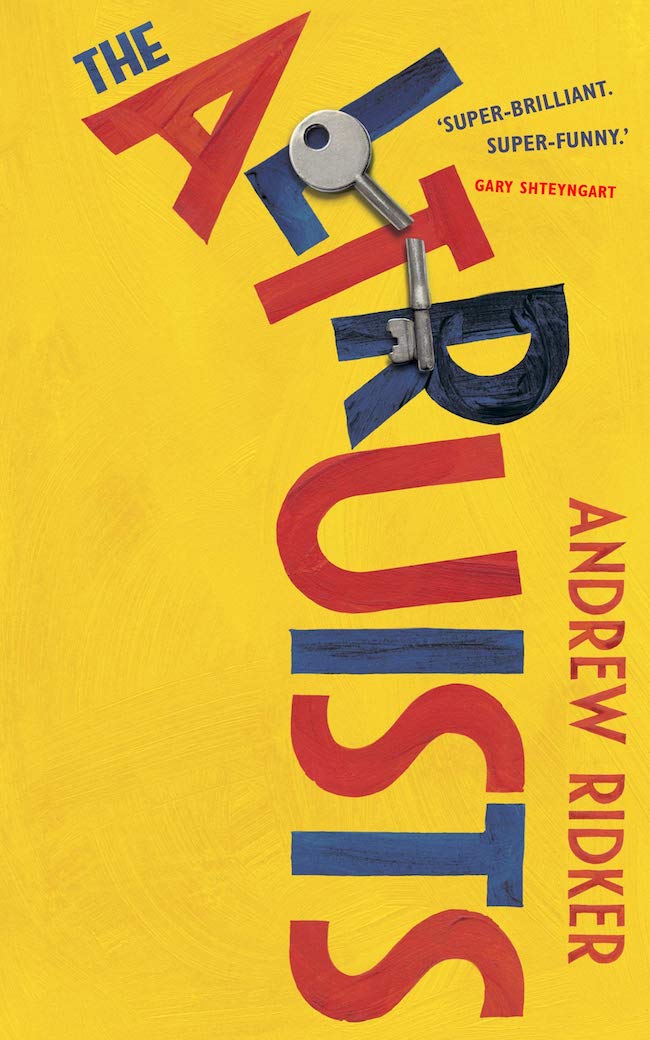
Le patronyme du héros, « Alter », ressemble au titre.
Aucun personnage ne partage ma biographie, mais ils sont tous des versions alternatives, idée résumée dans ce préfixe ( alter- ), ce dernier renvoyant également à l’altruisme. Et, enfin — c’est assez obscur —, j’ai pensé à l’histoire d’Abraham et d’Isaac, que de nombreux garçons juifs au Talmud Tora trouvent troublante : on se demande : « Mon père me sacrifierait-il ? » L’enjeu concerne la psychologie entre les jeunes hommes et leurs pères — un fils sacrifié sur un autel (« altar », paronyme d’Alter). Arthur sacrifie-t-il ses enfants ? Ou est-ce l’inverse ?
Enfant, vous vous êtes imaginé sacrifié par votre père ?
Lorsqu’on est jeune adolescent au Talmud Tora et qu’on apprend cette histoire pour la première fois, elle fait peur : on la rapporte à soi-même. Même si on ne croit pas en Dieu — c’est mon cas —, on se dit : « que se passerait-il si Dieu venait demander à mon père « Sacrifie ton fils » ? » Cette histoire m’a beaucoup marqué. Je sais que le dernier roman de Jonathan Safran Foer y puise son titre. En en discutant avec d’autres personnes, je me rends compte que beaucoup d’entre eux ont trouvé difficile ce passage.
Peut-on encore parler du « roman juif américain » quand presque rien ne reste de la judéité ?
C’est une excellente question ! Chaque artiste juif de la génération des milléniaux — s’il est séparé par au moins une ou deux générations de l’expérience des immigrants européens — doit l’affronter. Dans le contexte de l’ethnicité américaine, on est considéré comme blanc, même si historiquement on était une minorité vulnérable. Moi-même, je me sens ambivalent : sommes-nous blancs ? Peut-on avoir une culture sans religion ? L’assimilation est-elle une bonne ou une mauvaise chose ? Un essai de Vivian Gornick m’a interpellé, elle y prétend que la fiction juive américaine est morte depuis Roth et Bellow. Et ceci du fait qu’elle se nourrissait d’un sentiment d’exclusion, qui déclenchait colère et énergie. Peut-on encore se considérer comme un écrivain juif, ou serait-on juste un auteur assimilé exhalant un parfum un peu exotique ? Personnellement, je ne pense pas que cela dépende des pratiques ou des croyances, ni du degré d’éloignement de la génération des immigrants. Je crois plutôt à une évolution, que j’espère explorer dans ma carrière. J’ai grandi à Brookline dans le Massachusetts, après j’ai fait mes études à la Washington University — des environnements très juifs, ainsi qu’à New York, où j’habite actuellement —, et ce n’est qu’en intégrant le programme d’écriture créative à l’université d’Iowa que j’ai reçu l’étiquette « écrivain juif ». Cela renvoie à une citation, peut-être de Bernard Malamud : « Si vous ne vous sentez pas juif, ne vous inquiétez pas, quelqu’un vous le rappellera un jour. » Donc, oui, je me sens ambivalent, et l’ambivalence peut être créatrice.
À la différence de Franzen, vous n’avez pas grandi à Saint-Louis ; pourtant vous décrivez bien la ville. Que représente-t-elle pour vous ?
Saint-Louis a été le premier endroit où j’ai vécu adulte : j’avais du recul, mes antennes étaient redressées, j’ai remarqué les différences, alors que chez soi on prend tout pour acquis. J’ai été frappé par la disparité entre le Midwest et la côte Est : cette dernière a beau avoir une certaine diversité ainsi qu’une richesse en matière d’art et de culture, on y rencontre aussi un côté snob et arrogant. Tandis que dans le Midwest, même si c’est plus homogène et que les opportunités artistiques sont moins excitantes, on trouve une certaine gentillesse et de la sincérité, un sentiment de communauté et de chaleur. À part ça, pour un livre qui traite du rêve américain, Saint-Louis porte une valeur métaphorique : située au milieu du pays, la ville est intrinsèquement américaine. Côte pratique, l’intrigue concernant la maison n’aurait pas été possible à New York : acheter là-bas leur coûterait trop cher. Cela me plaisait bien, l’image d’une maison entourée par une clôture en lattes et dont l’hypothèque était remboursée. C’était la plateforme idéale pour interroger les valeurs américaines.
Sauf que l’hypothèque n’était pas remboursée.
Les milléniaux sont la première génération à ne pas gagner plus que leurs parents, à peut-être ne pas pouvoir acheter une maison. Jusqu’alors, il y avait la promesse que chaque génération gagnerait plus que la précédente, qu’elle aurait plus de confort, d’éducation et d’avantages. Aucun de mes amis n’évoque la possibilité d’être propriétaire, ce serait une chimère. On nous avait promis quelque chose qui ne s’est pas réalisé : la maison hypothéquée en est la parfaite représentation.
Jeffrey Eugenides m’a confirmé l’importance dans son œuvre de la figure de la maison.
Je n’y avais pas pensé, mais c’est vrai que, lors de ma première lecture de Virgin Suicides à la fac, ce qui m’a frappé, à part le lyrisme et le style, c’est le regard des jeunes adolescents de la banlieue, regard qui englobe la maison : les filles y sont retenues, la maison acquiert alors une valeur totémique. Cela arrive lorsqu’on grandit en banlieue : on va chez des copains pour jouer et on se demande : « tu vas dans quelle maison ? » ou : « chez qui vas-tu dormir ce soir ? ». Tout est situé dans la maison. Je me souviens de la première fois où j’ai dormi chez un copain quand j’étais enfant : on voit les habitudes des autres, s’ils mangent autre chose pour le petit-déjeuner, s’ils regardent la télévision lors du petit-déjeuner au lieu de discuter, ou s’ils sont silencieux. C’est à ce moment-là qu’on se rend compte que la famille qui nous accueille n’est pas la nôtre, que chaque famille a sa propre culture. Le réceptacle de cette culture familiale, c’est la maison.
Jeune comme vous êtes, comment avez-vous compris le désir d’un vieux professeur juif pour une Allemande de trente ans sa cadette ?
Depuis l’âge de huit ans, j’ai le sentiment d’en avoir cinquante : ma famille se moque de moi. Il y a des moments où j’ai le sentiment d’appartenir à ma génération, et d’autres où je me sens un peu aliéné. Je ne suis pas sur Twitter, je ne m’investis pas beaucoup dans la technologie, je ne m’intéresse pas aux nouvelles applis ou aux dernières avancées technologiques. En ce qui concerne Arthur, il a une aventure qui devient sérieuse avec une collègue allemande. Lui a soixante ans, elle à peu près trente. Ce phénomène de l’homme âgé sortant avec une jeune est répandu : les histoires entre professeurs et étudiantes, on en a déjà vu ; ce qui m’importait ici, c’était plutôt d’explorer une relation entre deux adultes consentants. Il me semblait que la jeunesse d’Ulrike aurait attiré Arthur : lui ne se sentait pas vieux, et puis elle était libre et ne dépendait pas de lui, n’étant ni étudiante, ni sa collègue dans le même domaine. Il n’y avait aucun décalage de pouvoir, juste celui de l’âge.
Propos recueillis par Steven Sampson












