Le philosophe britannique William Charlton, qui a notamment enseigné au Trinity College de Dublin, entreprend dans ce livre de démythifier la métaphysique.
William Charlton, Metaphysics and Grammar. Bloomsbury, 234 p., 15 €
Certaines questions, qui n’appartiennent qu’aux philosophes et sonnent étrangement, relèvent de ce qu’on appelle la métaphysique. Par exemple, observe Charlton, si la question « What time is it ? » est tout à fait sensée, il n’en va pas de même de celle-ci : « What is time ? ». « Qu’est-ce que le temps ? », « qu’est-ce que la vérité ? », « qu’est-ce que le bon ? »; s’agissant de ces questions : « Nous devons nous enfouir la tête dans le sable de vingt-quatre siècles de littérature philosophique pour nous rendre aveugles à leur bizarrerie. »
Ce n’est pas que la métaphysique n’existe pas ou qu’elle soit sans intérêt. Mais les sujets dont elle traite ne sont pas des entités que pourraient désigner des mots (« vérité », « existence », « causalité », etc.) ; ces sujets, seules les constructions grammaticales peuvent les exprimer. Si saint Augustin avait du mal à définir le temps, c’est parce qu’il n’avait pas vu que savoir ce qu’est le temps n’est rien d’autre que comprendre les constructions qui l’expriment dans le langage. Et c’est la même chose pour tous les sujets de la métaphysique. Quant aux mots qui semblent désigner ces sujets, ils ne s’appliquent pas à des choses mais à notre discours sur ces choses : ce sont des termes « du second ordre », les concepts en présence sont purement formels. Précisons que Charlton n’est pas un tenant du « relativisme linguistique » ; selon lui, au contraire, les différents systèmes grammaticaux expriment fondamentalement les mêmes formes de la pensée.
Dans la lignée de Wittgenstein, Charlton estime que la plupart des problèmes philosophiques naissent de mécompréhensions grammaticales, en particulier d’une confusion entre « grammaire de surface » et « grammaire profonde ». Par exemple, si je dis que mes amis sont loyaux, je peux affirmer aussi : « chacun de mes amis est loyal » ; mais si je déclare qu’ils sont nombreux, puis-je dire aussi facilement : « chacun de mes amis est nombreux » ? De même, lorsque je dis qu’une action est « prompte » ou qu’elle est « bonne », la différence essentielle entre ces adjectifs ne réside pas dans leur signification mais dans la façon dont ils signifient.
Selon Charlton, il ne faut donc pas se fier aux apparences ni se payer de mots (il est en cela le petit-fils spirituel de Locke) : en disant que quelque chose est vrai, on court le risque de croire qu’il y a une chose et que cette chose est vraie. Mais de quelle chose s’agirait-il ? D’une « pensée », d’une « proposition » ? Ces substantifs ne sont pour Charlton que flatus vocis. C’est plutôt d’un adverbe que nous aurions besoin : nous pouvons parler « vraiment » ou faussement. La simple utilisation de phrases au mode indicatif (indicative sentences) nous permet de saisir ce que c’est que d’émettre des énoncés vrais ou faux.
Quant à l’existence – Kant l’avait déjà dit –, ce n’est pas une propriété. C’est, pour Charlton, ce que nous exprimons lorsque nous quantifions ou que nous renvoyons à des choses comme existantes. Nous témoignons, par exemple, de notre idée générale du concept d’existence quand nous sommes en mesure d’affirmer : « il y a des moustiques dans la chambre ». L’être, en tant qu’il serait un nom, est une plaisanterie aux yeux de l’auteur, malgré les titres fameux (Charlton serait probablement tenté de changer la première voyelle de cette épithète) qui suggèrent le contraire. Mais rien n’interdit à personne d’écrire des ouvrages de fiction.
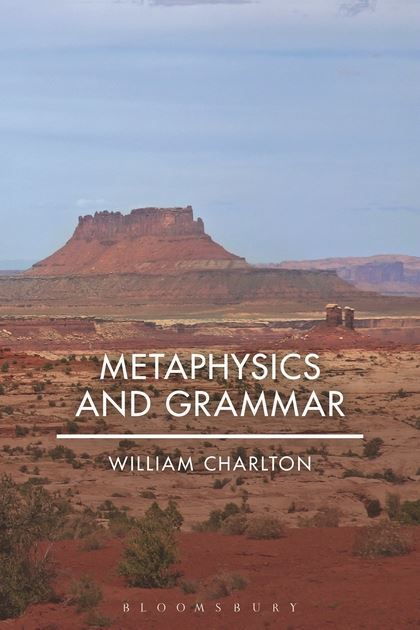
Il y a aussi le « bon » et le « mauvais ». Charlton est ici l’héritier des philosophes analytiques du XXe siècle (Alfred Ayer, Charles Stevenson, Richard Hare) pour lesquels les énoncés éthiques ne sont ni vrais ni faux mais traduisent des sentiments favorables ou hostiles. Pour l’auteur, les notions de « bon » et de « mauvais » renvoient à des conseils ou à des ordres. Le concept de « bon » se ramène à un but [1], et penser que quelque chose est bon, c’est le désirer. Dans la grammaire, cela peut s’exprimer par l’impératif, par le subjonctif, ou encore par une construction comme : « si seulement la pluie pouvait cesser ! ».
Le temps est ce qui est manifesté par certaines formes aspectuelles. Rappelons que l’aspect est la catégorie grammaticale indiquant la représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe (durée, déroulement, achèvement) ; il est illustré notamment par l’opposition entre l’accompli et le non-accompli (« Paul avait mangé », « Paul mangeait »). Certaines langues ne possèdent pas de distinctions de temps mais toutes, semble-t-il, présentent des oppositions d’aspect [2].
Ce que dit Charlton de la causalité évoque les développements de Hume sur ce sujet : on chercherait vainement une relation entre une action causale et un effet. C’est uniquement dans le langage, par l’usage d’énoncés explicatifs (avec, par exemple, l’emploi transitif des verbes), que l’action causale est liée à ce qu’elle produit. Le scepticisme sur la causalité, ajoute l’auteur, est similaire au scepticisme sur ce qui est « bon ». Les philosophes considèrent que, si quelque chose doit être bon objectivement, alors le « bon » doit être une propriété réelle ou un prédicat ; comme ce n’est pas le cas, ils écartent l’idée que quelque chose puisse être réellement bon. De même, si une action est la cause de quelque chose, alors il doit y avoir une relation entre l’action et ce qu’elle cause ; à défaut d’une telle relation, certains jugent illusoire l’idée qu’une chose puisse en causer une autre. Ces deux inférences reposent sur la même confusion ; ce n’est pas parce qu’on rejette l’essentialisme qu’on doit verser dans le relativisme ou le scepticisme.
Charlton n’est pas non plus de ceux qui réduisent nos raisons – lesquelles relèvent d’interprétations téléologiques – à des explications purement causales. Selon lui, l’idée contemporaine selon laquelle le mental peut être réduit au physique coïncide avec l’importance croissante de la science en Occident. Ailleurs, l’auteur remarque que, si les philosophes tendent à penser que l’altruisme est impossible, c’est parce que notre théorie économique moderne prétend que tout comportement vise l’intérêt propre de celui qui l’adopte ; « et nous vivons dans une société dans laquelle l’économie est institutionnalisée ». La phrase suivante exprime assez bien la position générale de Charlton : « La grammaire est un pont qui nous conduit de la matière à l’esprit sans que nous ayons à souscrire au spiritualisme ou au matérialisme. »
Les concepts métaphysiques n’ont pas d’existence autre que dans la syntaxe ; tout le monde ne pourra pas adhérer à une conception aussi « déflationniste ». Quoi qu’il en soit, ce livre, profondément original, est d’une rare liberté d’esprit.
-
Selon Charlton, nous avons trois objectifs fondamentaux : la préservation de notre santé ; le respect des règles collectives ; le souci des autres.
-
Quant aux erreurs que les philosophes ont faites sur le temps, elles ont tenu, d’après l’auteur, à leur volonté de transposer à la physique l’idée que l’existence serait un procès ou un état.












