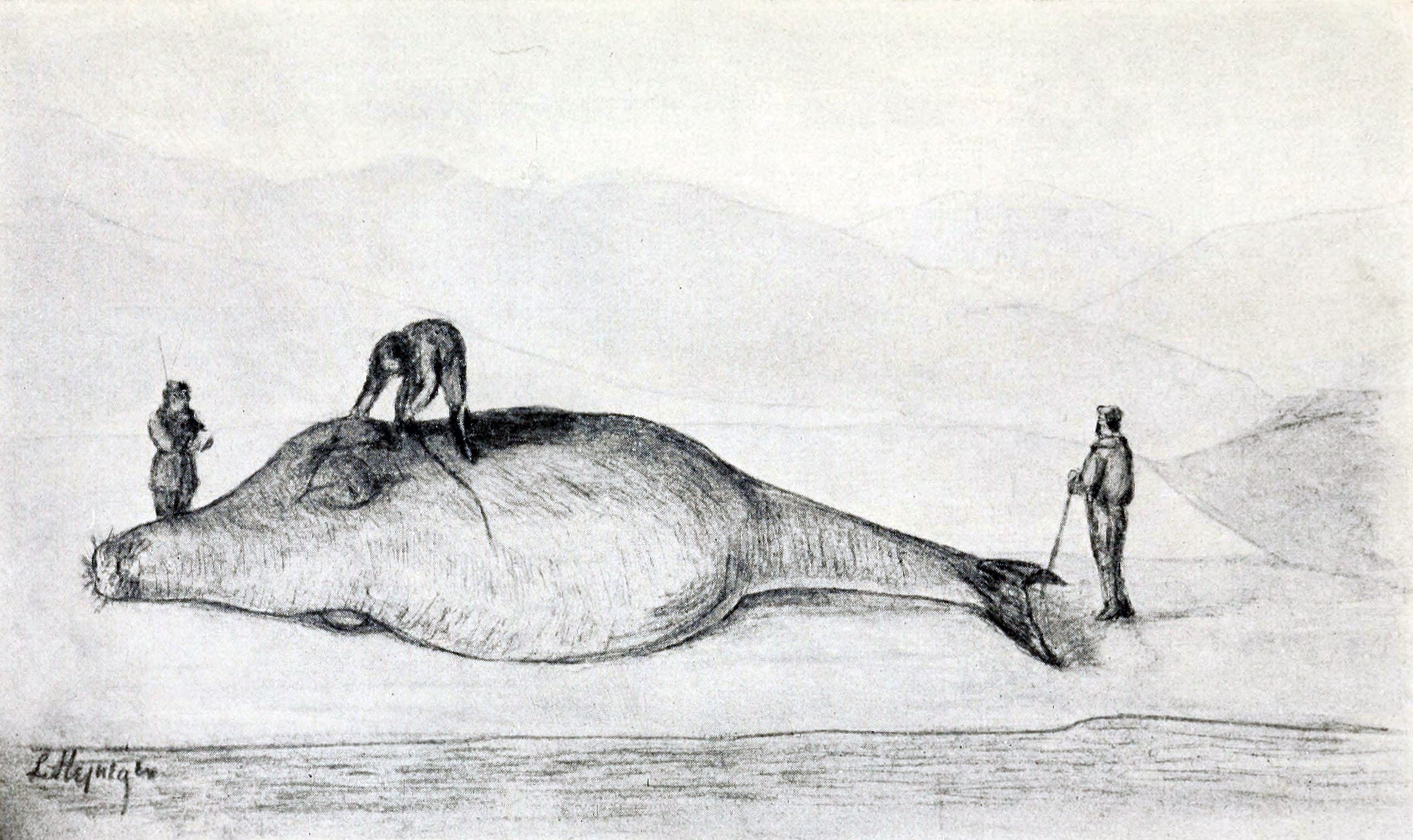« Moi, je n’aime pas les romans difficiles », déclare Natalia Ginzburg (1916-1991) dans l’un des articles de Vie imaginaire. « Il me plairait d’habiter au Quirinal » (résidence du président de la République), avoue-t-elle dans un deuxième. « Je déteste l’été », affirme-t-elle dans un troisième… Autant dire que dans ce recueil, paru en 1974 et qui rassemble trente de ses chroniques écrites pour La Stampa et le Corriere della Sera (plus une inédite, « Vie imaginaire »), l’auteure des Mots de la tribu apparaît d’abord sous son jour le plus affirmé et le plus faussement naïf.
Le recueil d’articles, aujourd’hui publié par les éditions Ypsilon, vient après deux autres, Les petites vertus (1962) et Ne me demande jamais (1970) ; il constitue avec eux une sorte de journal en public dans lequel Ginzburg, souvent en parlant d’autre chose, esquisse un autoportrait qui prolonge à l’âge adulte celui d’elle enfant qu’elle présentait dans son extraordinaire Les mots de la tribu (1963). Dans la première partie, Vie imaginaire chronique des œuvres littéraires et filmiques, évoque des amis ou des écrivains (contemporains de l’auteure) et, dans la seconde, se tourne plutôt vers des questions générales concernant la société, l’imagination, l’écriture, la vie affective.
Un point de vue tranché domine, souvent énoncé dans une formule en début d’article : Amarcord de Fellini est « un des plus beaux films jamais réalisés » ; un roman de Moravia « ne [lui] plaît pas » ; le monde des années 1970, elle « le hai[t]», etc. Voilà qui est dit, et pas sous forme interrogative ; l’affirmation est péremptoire, souvent à rebrousse-poil, puis au fil des lignes travaillée par des reprises, nourrie de souvenirs personnels, testée par des contrepoints de goût ou de morale.
Ainsi, que penser des dernières productions des gloires du moment, comme un nouvel opus d’Alberto Moravia ou la poésie de Giorgio Bassani ? Grazie no ! En effet, Moi et Lui de Moravia est écrit par « l’image publique » de l’écrivain, non par le véritable romancier, tandis que les poèmes d’Epitaffio de Bassani exsudent la complaisance. La nouvelle collection pour enfants d’Einaudi (ami proche et éditeur pour lequel elle travaille) ? Non in sogno ! Aux petits il faut loups, ogres, sorcières, avec leurs atrocités, et non du gnangnantisme moralisateur. En contre-exemple à ces mièvreries, elle recommande les fameuses Fiabe (Contes) d’Italo Calvino (son collègue aux éditions Einaudi) collectées par lui et publiées vingt ans auparavant.

Car elle n’est pas que « corsaire » (La Corsara est le titre de sa biographie par Sandra Petrignani) et, à ce qu’elle n’aime pas, elle sait opposer ce qu’elle aime, et en littérature souvent des écrivains moins ou très peu connus : Antonio Delfini, Tonino Guerra, Goffredo Parise, Elizabeth Smart… Pourtant, c’est toujours avec des frappes d’estoc et de taille qu’elle s’élance sur des thèmes politiques et sociaux : le féminisme, la judaïté, la Rome d’aujourd’hui, la vieillesse, le rapport aux enfants adultes…
Le féminisme ? Si elle se sent d’accord avec ses revendications, elle demeure rétive à cautionner des mouvements qui ne lutteraient pas pour les droits de tous, hommes et femmes. La judaïté ? Les Juifs d’Israël (on est au lendemain des événements des jeux Olympiques de Munich de 1972) ? « Si on les critique j’éprouve un sentiment de révolte et d’obscure offense… Si on en parle avec admiration et dévotion… j’ai… la sensation de ne pas partager ces sentiments », dit-elle, et, fondamentalement, poursuit-elle, « je pense que chacun doit dépasser les frontières de ses origines ». La vieillesse ? C’est faire connaissance avec « l’inexorable » et, en ce qui concerne les femmes, se voir demander « de débarrasser le plancher au plus vite car il n’y a aucune place pour les femmes vieilles dans le monde ». Les enfants adultes ? Des êtres qui portent sur leurs parents « un regard tantôt affectueux, tantôt sévère mais surtout profondément distrait » et dont il ne faut attendre aucun réconfort car cette fonction, c’est eux (les parents) qui l’ont assumée (bien ou mal) vis-à-vis de leur progéniture et elle demeure indélébilement et asymétriquement imprimée dans leurs rapports.
Vie imaginaire se clôt sur le texte qui donne son titre au recueil, petite autobiographie de la vie de l’imagination de l’auteure depuis son enfance et réflexion sur le rôle de la rêverie en général par rapport à la pensée rationnelle et au réel. Cette vingtaine de pages, qui fonctionne comme un appendice des Mots de la tribu écrit dix ans plus tôt, en possède un peu de la drôlerie mais y ajoute une force poignante donnée par le surcroît de temps écoulé.
C’est donc Natalia « l ’orageuse » (son surnom lorsqu’elle était enfant) qui, encore une fois, écrit dans cette Vie imaginaire, tout autant que Natalia la rêveuse, la mélancolique, la profondément morale… Et c’est bien un pavillon corsaire qu’elle fait flotter, fort différent de celui sous lequel d’habitude on se range lorsqu’on écrit des chroniques pour la presse. Hissé haut, il porte des couleurs originales et contrastées, juxtaposant provocation et stoïcisme, attachement à la pensée et idiosyncrasie, goût de l’espace domestique et curiosité pour le monde. Pessimiste, batailleuse, lasse parfois, la corsaire de ce recueil réussit encore une fois son abordage et nous livre ce butin précieux qu’est « le prodige habituel et naturel de la littérature ».
« Ohé, je m’en vais sur un grand voilier.
Jambe de bois, sabre de fer, je suis un corsaire. »