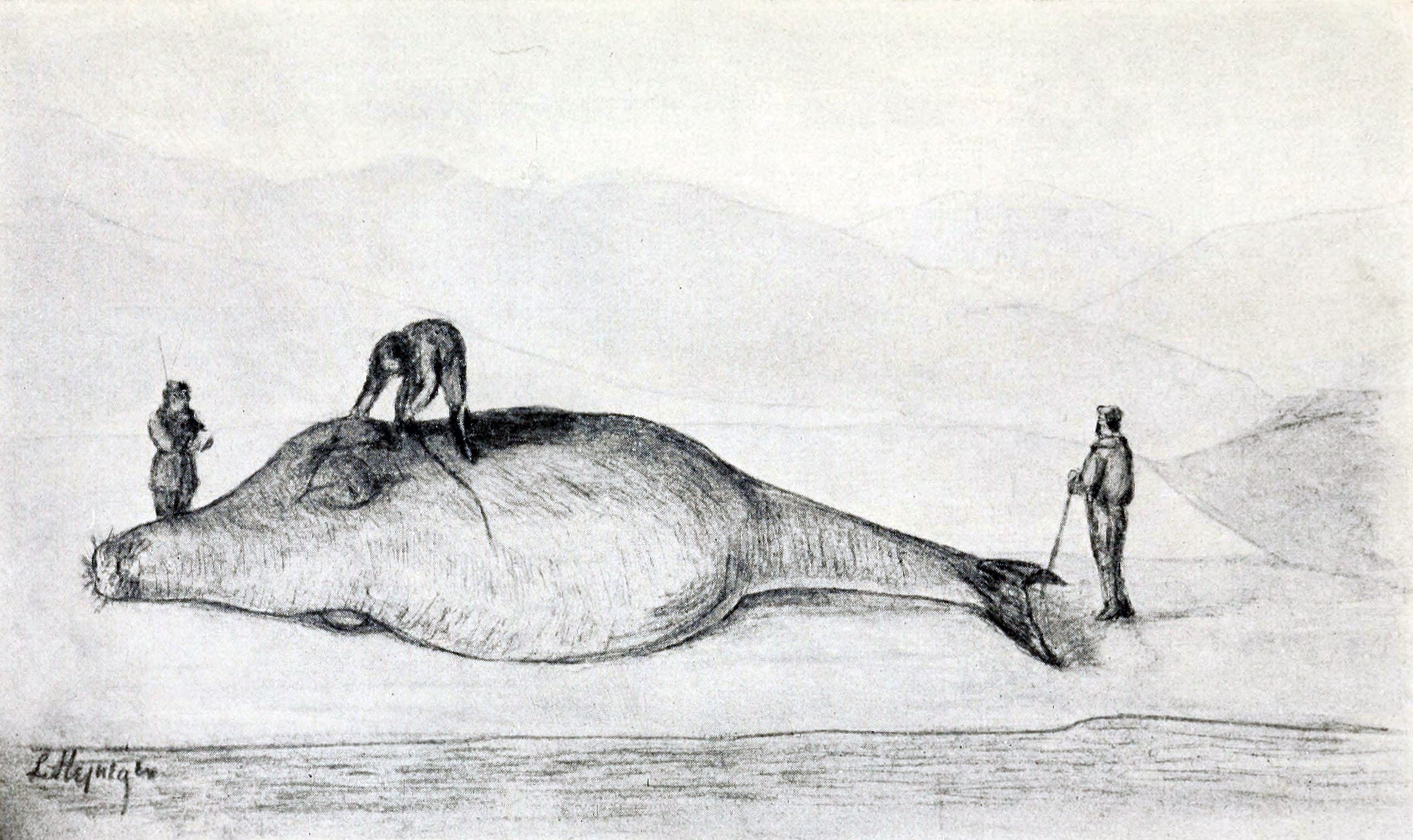Il y a des projets éditoriaux qui pourraient paraître au premier regard un peu fous ! La jeune maison Triestiana, qui ne publie que des livres venus de Trieste, pourrait s’empêtrer dans une hyper spécialisation de mauvais aloi, se restreignant à l’excès. Il n’en est rien, et on découvre dans les dix magnifiques volumes déjà publiés une aventure superbe et audacieuse. Et surtout, on entend des voix d’une grande force qui nous révèlent une littérature jusqu’ici inaccessible. Un magnifique pari réussi !
Il y a des maisons d’édition qui ouvrent des fenêtres sur le monde. Tantôt à grand angle, avec une dimension politique ou un tropisme linguistique et culturel profus – on pense, par exemple, à Chandeigne pour le monde lusophone, à La Fabrique pour l’engagement, au regretté Passage du Nord-Ouest pour des littératures exigeantes ou aux principes qui ont présidé à la création de L’Ogre ou de publie.net… D’autres fois, plus rarement, elles obéissent à un angle aigu, à un resserrement, à une spécificité qui leur donnent une identité. On s’ouvre aux diversités du monde ou on creuse avec obstination un sillon. Deux plateaux de la balance qui trouvent des équilibres empiriques et, surtout, s’attachent des lecteurs à la curiosité et à la fidélité essentielles. Bref, éditer c’est faire des choix, assumer des logiques, faire entendre des voix inévidentes, trouver et maintenir des caps.
L’étonnante Triestiana obéit d’évidence à la seconde logique, celle qui semblerait dès le départ obstruée tant elle paraît restreinte, refermée ou aigüe. Car quelle idée étrange et téméraire que de publier exclusivement de la littérature triestine, de fouiller des œuvres localisées à l’extrême, de se glisser dans un univers linguistique mineur et quasi inconnu. Car, hormis Claudio Magris, Umberto Saba, Italo Svevo, James Joyce ou, pour les plus curieux, Giani Stuparich, à qui pense-t-on vraiment lorsqu’on associe littérature et Trieste ? Qu’évoquent les noms de Claudio Grisacich, Fedoro Tizzoni, Fery Fölkel, Biagio Marin ou Gino Brazzoduro ? Pas grand-chose pour les lecteurs francophones qui, probablement, sans le travail acharné, discret et doux, pour tout dire stupéfiant, de Laurent Feneyrou et Pietro Milli, n’en auraient jamais entendu parler. Et s’il y a une sorte de beauté languide à découvrir des noms inconnus qui semblent se loger dans l’oreille, on trouve une certaine joie, fort rare avouons-le, à plonger dans des textes que l’on sait improbables, comme sortis de l’opacité d’une langue ou de dialectes mystérieux, comme les brumes stupéfiantes enveloppent Trieste et nous la dérobent toujours.
On peut parler de joie à découvrir des textes que toute logique devrait laisser dans l’ombre. C’est que les éditeurs sont souvent comme des photographes qui combinent des formules chimiques pour révéler des images ou des langages. C’est au saisissement, au partage, que cette maison invite avec une fermeté sûre qui ne cesse de nous toucher. Parce que les dix livres qu’elle a édités jusqu’à aujourd’hui nous frappent, nous font rêver, nous ouvrent des univers que l’on jouit de connaître un peu, juste un peu. On glisse dans un monde incertain, un peu flottant, dans des langages aux fluidités presque romantiques et aux raucités qui résistent obstinément, des voix qui nous saisissent et nous font entendre la complexité d’un monde qui ne se restreint pas, qui échappe encore et encore.

Au gré de recueils très élégamment édités – avec la complicité des Éditions de l’éclat –, dotés d’appareils critiques savants et accessibles, nous découvrons une poésie d’une richesse et d’une variété qui semblent infinies. On y entend l’effervescence du futurisme et le poids d’une histoire complexe, le basculement d’un monde dans la modernité et les horreurs de la guerre, l’élaboration compliquée d’une identité qui se joue de se perdre ou de se retrouver. On y perçoit des voix d’une inventivité et d’une ouverture qui contreviennent à la petitesse de l’identité ou de la restriction à soi-même. On y ressent la pluralité d’une identité qui n’existe que dans un carrefour, des rencontres et des affrontements qui traversent les vies d’écrivains qui semblent toujours chercher une beauté d’expression qui s’oppose aux duretés du monde réel, de la politique, des guerres et des pouvoirs qui pèsent sur les gens.
Triestiana – quelle beau nom, qu’on peine un peu à prononcer et dans lequel on entend presque le nom d’une aimée, ou d’une langue inconnue ou d’une île ou d’un lieu qui résiste… – nous fait entendre ces voix, nous laisse les traverser comme elles nous traversent. C’est un sacré pari, une sacrée audace ! Et cela paie assurément, car on ne peut qu’être frappé de la vivacité et de la richesse d’un corpus invisible. On ne peut qu’inviter à découvrir ces poètes d’une grande variété et de formes et de générations qui reviennent à un lieu, à l’incertitude d’une provenance, non pour restreindre leur identité mais au contraire pour en partager les possibles. On ne galvaudera pas la formule devenue célèbre de Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs. » Mais comment penser que cette conception ne s’applique pas, aujourd’hui, à cette maison discrète et audacieuse, aux textes qu’elle promeut, aux identités et aux langues qu’elle diffracte ?
On lit ces écrivains comme ceux dont on se dit qu’ils fondent des communautés sensibles. Et il y a là quelque chose qui confine à la confrérie secrète, à une sorte de passage initiatique. Chacun découvrira dans cette maison des voix, des langues, des choix esthétiques ou intellectuels, des histoires aussi, qui lui conviennent ou trouvent écho en lui. Mais, que nous lisions les poésies mitteleuropéennes de Carolus L. Cergoly, les poèmes de guerre de Giulio Camber Barni ou les très beaux textes de Gino Brazzoduro, nous touchons un inconnu familier, une sorte de voisinage qui dérange en nous quelque chose de profondément logé, éclaire un monde hostile où les poètes cherchent leur voix, et qui instille dans notre réalité un trouble qu’il nous faut, avec Triestiana et son équipe, courageusement, admettre, ressentir et partager.
Entendons ainsi deux voix qui semblent presque se répondre. Ainsi écrivait Biagio Marin, disparu en 1989, dans La guirlande de ma sœur :
Je suis tout chant, tout grande flamme,
Flamme de joie, flamme de tourment :
Mais toi tu dors, et à ton sang lent
Jamais n’arrive ma voix qui appelle.
Et, dans les année 1950, le jeune prodige Claudio Grisancich, né en 1939, écrivait le doute et le but du poète, le sens de la poésie peut-être qui l’effleurait et lui échappait, qu’il faut assurément entendre et continuer d’écouter, avec obstination :
C’est cette grande maison
et cette cour en ruines
au dedans, qui s’est effondrée,
et moi aussi, sur
ces choses, moi qui me sens né
pour les comprendre mieux
que les autres et avec des larmes
au dedans, émerveillé
de ne pas savoir les dire.