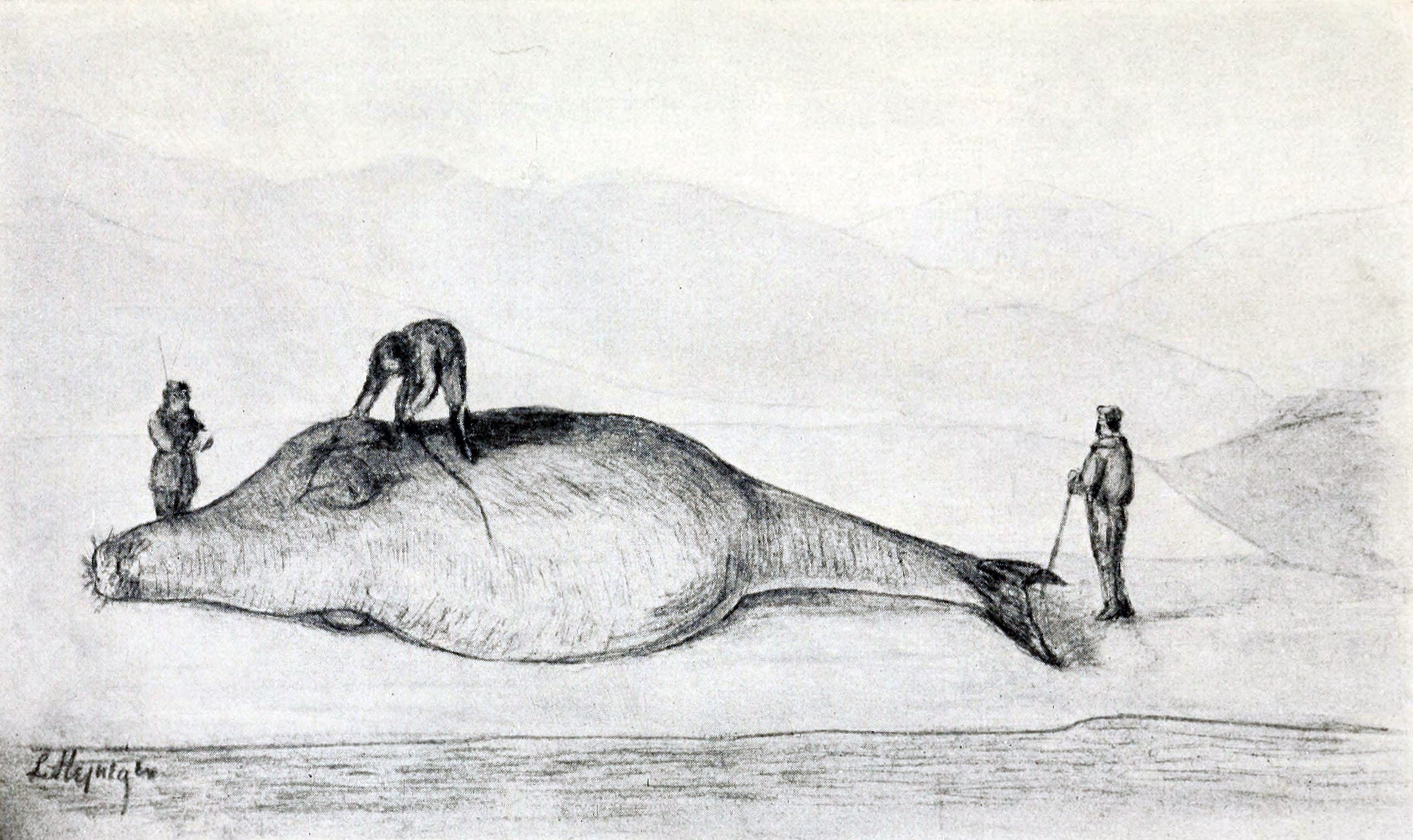En racontant, au jour le jour, le cancer qui allait l’emporter en juillet 2016, le grand écrivain hongrois Péter Esterházy dépasse le strict journal intime ou le récit de la maladie, pour penser la vie à l’aune de l’expérience de la littérature et invente une forme nouvelle d’autobiographie. Son Journal intime du pancréas s’impose comme un livre d’une grande force qui désarçonne, brouille les repères et semble se nourrir de sa propre matière.
La franchise impose de le dire d’emblée : lire l’ultime livre de Péter Esterházy constitue une épreuve. Primo, on n’aborde pas comme les autres le dernier texte d’un grand écrivain qui sait qu’il va mourir. Surtout quand son sujet s’avère être le cancer qui l’emporte. Secundo, les livres sur la souffrance, la maladie, le désarroi de la disparition, renvoient le lecteur à un inconfort existentiel qui s’apparente presque à un tabou. Sans oublier la crainte des clichés ou du larmoiement qui accompagnent souvent les entreprises de le raconter. Tertio, on peut se méfier un peu de la forme diariste, de l’annonce d’un dernier texte qui paraît en français avec dix ans de décalage, sorte de syndrome du fond de tiroir ou du texte qui clôt sans la clore une œuvre qui a souvent résisté au partage de soi-même.
Et disons-le, aussi clairement que possible : l’écrivain, malgré les aléas de la maladie, contrevient à toutes ces craintes, s’en jouant avec lucidité et distance. Son livre servant en quelque sorte à les métaboliser, à les intégrer à un système narratif qui s’emploie à décrire « la beauté de la vie », à penser sa circonstance pour la dépasser, pour comprendre quelque chose de ce qui porte la vie en en affrontant la finitude. Et c’est cela qui fait de ce livre un récit de soi, de ce qu’Esterházy appelle sa « situation », une « autobiographie » étrange et audacieuse. Un livre qui, à partir de la maladie, réfléchit l’existence, la réduction de sa perspective, mais aussi les choix que l’on fait, les gestes qui nous touchent, les livres qui reviennent à l’esprit ou qui nous aident à penser et à vivre, qui nous font résister.
C’est pourquoi sans doute l’écrivain parle ici directement de lui – il y a toujours rechigné malgré les apparences ou a parlé à partir d’autres comme dans Voyage au bout des seize mètres (Bourgois, 2008) ou de sa famille légendaire dans Harmonia Cælestis (Gallimard, 2001) –, qu’il admet le partage du rien, de l’insignifiant, du désordre fragile de sa vie. Alors il raconte, en indiquant la date, ce qui se passe, tout simplement : l’évolution de la maladie, les rendez-vous avec les médecins, les traitements, les obligations du travail, les relations familiales, les lectures qu’il fait… toute cette espèce de quotidien qui gagne un relief par la parole qui le nomme, par la cartographie sensible et hasardeuse qu’en fait l’écrivain.
C’est la première embûche de ce livre : il faut résister à la dureté de ce qui est raconté, accepter de suivre la progression du cancer, d’entendre la détresse d’un homme, ses angoisses, sa douleur, ce qu’il ne peut en communiquer à autrui, ce qui lui résiste. C’est l’une des condition des textes sur la maladie que de négocier quelque chose de l’empathie ou de l’identification. Jamais Péter Esterházy ne se plaint ou ne s’abîme dans un pathos qui exhibe un intime qu’il garde toujours à distance. Le livre pose davantage la question de sa propre possibilité, de son existence, de sa performance, qu’il ne raconte le quotidien d’un malade qui s’éprouve comme tous les autres. C’est cela qui fait la littérature, qui fait du livre autre chose qu’un journal – le titre original omet le mot « intime » – mais une autre forme, réinventée, réinvestie, d’autobiographie.

L’écrivain qui affronte sa future disparition doit se débrouiller du quotidien, de son présent, et en faire quelque chose, le déformer par l’écriture. Et le livre raconte en grande partie l’effroi auquel nous confronte la maladie et la puissance de la pulsion de l’écriture, obéissant ainsi à une double injonction. Péter Esterházy écrit ainsi, dans une prose saccadée, nominative : « Je ne sais pas comment, tout est inquiet. Il y a de l’inquiétude. C’est oppressant. Je suis oppressé. Le journal de bord d’un oppressé. » Et il ajoute, plus avant, avec cette sorte d’humour décapant qu’il injecte dans les moindres choses : « Écrire ? Ici ? Pourquoi ? Mais puis-je faire autre chose ? Je vivrai tant que j’écrirai ? Ça, c’est plutôt dans une opérette. » S’il interroge en permanence ce que la maladie fait se rejouer de l’existence et ce qu’elle implique dans le geste d’écrire, ce Journal intime du pancréas cherche à donner une forme praticable pour l’écrivain et admissible pour le lecteur, une forme qui raconte et dévoile l’intime en lui conservant son caractère et en l’intégrant au récit de quelque chose qui le dépasse, le conditionne, le restreint, lui confère une place.
Ce texte ultime d’un grand écrivain circonscrit ainsi le territoire du récit – de soi, du monde, de la politique, de la famille, des amitiés, du soin, de la souffrance, du travail de l’écriture, de la lecture, des influences… –, lui offre un cadre et une perspective. Le livre envisage toujours ensemble l’existence et sa projection dans le récit, considérant toujours la condition du langage qui les rend possibles. C’est peut-être pourquoi le livre passe sans cesse d’une tonalité à l’autre, du tragique à la farce, du sérieux de la pensée au plus prosaïque de la vie courante, touchant peut-être au nu de la vie, à une fragilité que l’on tait, à une énergie qui bouleverse le cours de l’existence. Il provoque ainsi une incertitude permanente. Impression fort peu agréable et désarçonnante qui n’est jamais vaine car elle impose une forme. La lecture est instable, parfois pénible, décousue, hétéroclite. Et cet obstacle doit être admis, car il constitue le pilier d’une construction narrative qui se réinvente sans cesse et accepte, justement, sa dimension hétérogène, parfois obscure ou déstabilisante. Et on y trouve, avec l’écrivain, dans le moment même de la lecture, une sorte de joie pleine et étrange.
Confronté à la maladie, à l’aune de sa possible disparition, l’écrivain fait face au choix d’écrire ou de se taire. Il se doit d’interroger sa propre modalité d’existence, d’éprouver sa voix en quelque sorte. Il écrit : « D’une manière ou d’une autre, il faudrait que je lâche cet accablement. Car ce n’est pas la maladie qui me pèse directement. Je ne me sens même pas malade. Je ne sens que les conséquences de la maladie. Ce sont d’elles que je suis la victime. Soi-disant. C’est le chaos – et mon chaos – qui m’accable, je crois. » Et n’est-ce pas de ce chaos, de cet indicible désordre de la perception et de l’existence, que le grand écrivain doit se débrouiller ? Et, à l’instar du superbe Au bord des fleuves qui vont d’António Lobo Antunes (Bourgois, 2015), il propose une modalité de récit qui empêche l’évidence ou le partage univoque de l’expérience, il refuse cette transmission simpliste, affichant l’injonction de la littérature à en faire autre chose, à rendre autre chose possible.
Et c’est ce qui fait des livres des grands écrivains des livres importants, qui marquent ou interloquent le lecteur, le hantent, lui font entendre le monde autrement. Voilà bien qui mérite de passer quelques obstacles, de faire l’expérience véritable et concrète d’une altérité. C’est l’un des rôles majeurs de la littérature qu’accepte l’écrivain, comme il en accepte le poids et le coût. Le livre doit faire dépasser l’expérience. Entendons ainsi la leçon de ces écrivains qui, tels Fritz Zorn, profèrent le monde et ses désordres à partir d’eux-mêmes, de leurs extrêmes limites. Pour Péter Esterházy, l’expérience de la maladie, le journal de son cancer, ne peut tenir seul. Ainsi, le récit déborde – tout en demeurant d’une sobriété d’effets et d’une concision de l’écriture très grandes – toujours, dévie, se recoupe, s’entrelace d’éléments hétérogènes. L’écrivain parle de ce qui lui occupe l’esprit, de ce qu’il doit penser dans l’urgence de l’épreuve de la maladie qui peut être (sera) fatale. Il faut dépasser sa ponctualité, ne pas s’abolir dans un sursaut égotique ou dans l’effroi de disparaître. Il faut éprouver sa vie et penser. Et penser en lisant, penser avec d’autres, vivre avec les autres, en pensant.
Péter Esterházy n’écrit jamais seul, il semble habité par d’autres langages, d’autres vies que la sienne, admettant dans cette lecture même le possible d’un autre, un sursaut de la vraie vie, celle qui nous dépasse. Il lit ainsi Sándor Márai, Gergely Gulyás, Dezső Kosztolányi, Péter Nádas ou László Krasznahorkai, des poètes et des écrivains hongrois inaccessibles (malheureusement, d’évidence) en français… Mais aussi Karen Blixen, Bohumil Hrabal et surtout Harold Brodkey qui a écrit des textes majeurs sur l’expérience qu’il traverse. Ces voix constituent des appuis et des altérités. Hors le fait qu’il donne envie de plonger dans leurs œuvres, ces auteurs se font les relais de l’expérience, de l’idée que l’on s’en fait, de ce que l’on peut en faire. Il pense ainsi, en s’y frottant, en leurs travers. Et le journal qui n’en est pas un les accueille, leur procure un logement dans le temps présent, les intègre à la propre épreuve de l’écrivain.
Le livre de Péter Esterházy figure ce qu’il est, prend en charge ses effets, sa réalité. Il nous confronte à des choses presque indicibles et pourtant banales. Il invente une modalité narrative nouvelle pour se hisser à cette hauteur minuscule. C’est une expérience difficile, parfois pénible, tantôt très sombre tantôt euphorique, toujours mise à distance par un humour ou un recul qui s’affirment comme des conditions et de l’existence et du récit. En personnifiant son cancer, en lui donnant une place féminine à l’intérieur de sa vie, de son corps, l’écrivain imagine une distance paradoxalement proche, comme il a inventé un obstacle à la lecture qui fait lire, un inconfort qui rend possible un vrai partage.
L’écrivain cherche sans fin le moyen de parler des choses, de les décrire, de les trouver et de les partager. Il ne cesse de revenir, au-dedans même du récit de la maladie qui se déplace, à ce qu’il est, à ce qu’il doit faire, écrire, toujours écrire, encore un peu, même le dernier petit rien, en faire quelque chose d’autre, de grandi, de vif, de beau. L’écriture semble un retour permanent, une correction infinie, une sorte de joie terrible à dire, à se dire. Comme il l’écrit à la toute fin du livre, alors qu’il va commencer à taper le manuscrit à l’ordinateur : « Il faut le clore quelque part, et, bien sûr, continuer à écrire. Comme dernière phrase, celle-ci serait pas mal : je corrige ‘’toujours’’ en ‘’pour l’éternité’’. »