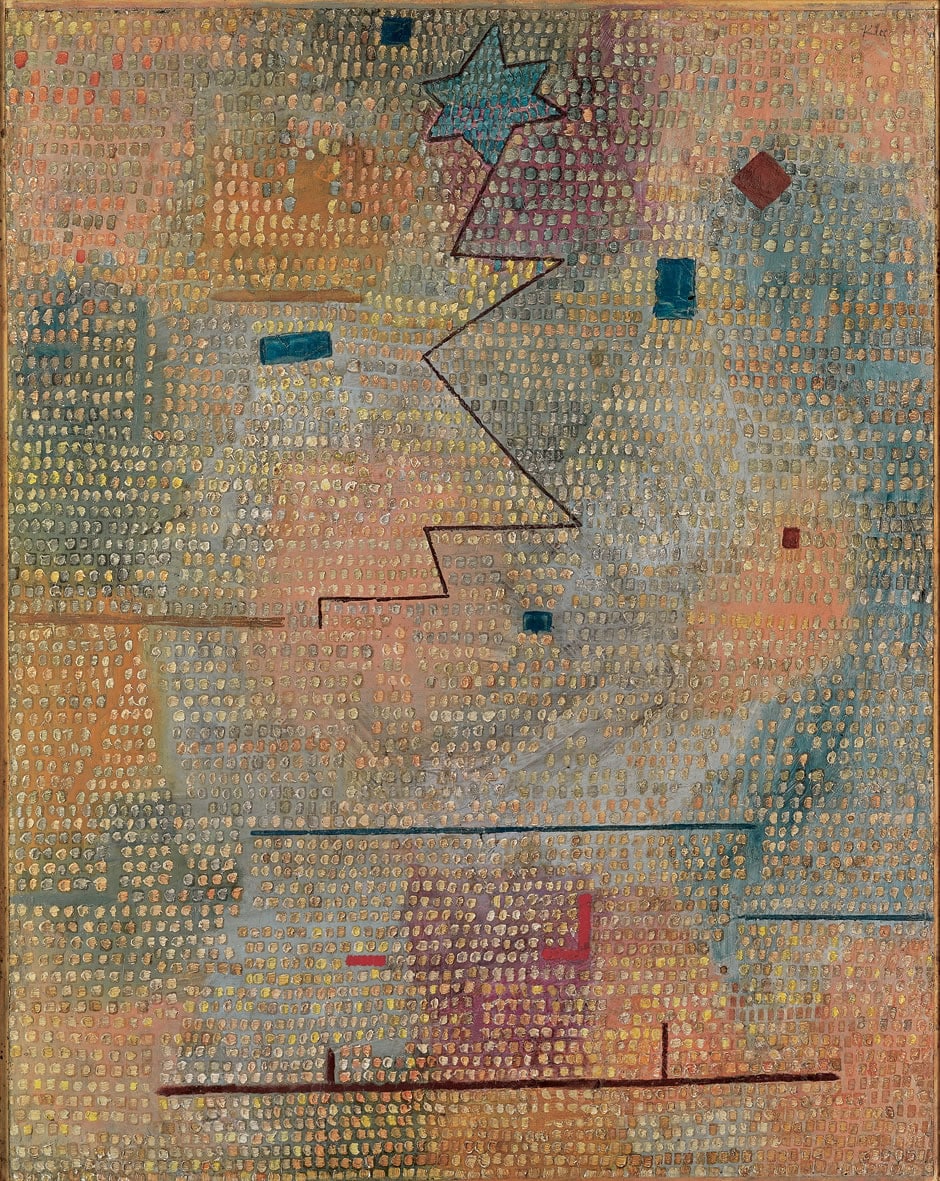Le grand écrivain Wole Soyinka signe en 2019 un poème en cinq chants pour dénoncer la violence des fanatiques, notamment ceux du groupe Boko Haram qui ont enlevé en 2014 des jeunes filles à Chibok dans le nord de son pays, le Nigeria. Traduit en français à l’initiative du Mucem, il reste largement d’actualité.
Wole Soyinka, Ode humaniste pour Chibok, pour Leah. Trad. de l’anglais (Nigeria) par Christiane Fioupou. Présence africaine, coll. « Poésie », 72 p., 10 €
« Pas Rushdie, mais les fossoyeurs, ont commis des Versets / Sataniques. Leurs manuscrits de la mer Morte transmettent / Des graffiti de haine, lancent des flammes pour flétrir des tomes / De savoir éprouvé, passé et récent. » Lire ces lignes après la récente agression dont Salman Rushdie a été victime ne fait que confirmer leur pertinence : au nom de quelle doctrine religieuse justifie-t-on des actes violents ? Des représailles contre des écrits jugés blasphématoires, contre leurs auteurs, des journalistes décapités, mais aussi une violence qui s’exerce contre n’importe qui. Des meurtres et des viols, certains hommes épousant de très jeunes filles dont le corps n’est pas prêt pour l’acte sexuel, encore moins pour la maternité. La violence faite aux plus vulnérables est particulièrement intolérable, idée omniprésente tout au long du recueil : « Il y a des actes qui méritent la déchéance / De la définition humaine. Ce sont, ma conviction le proclame, / Des crimes contre les innocents. »
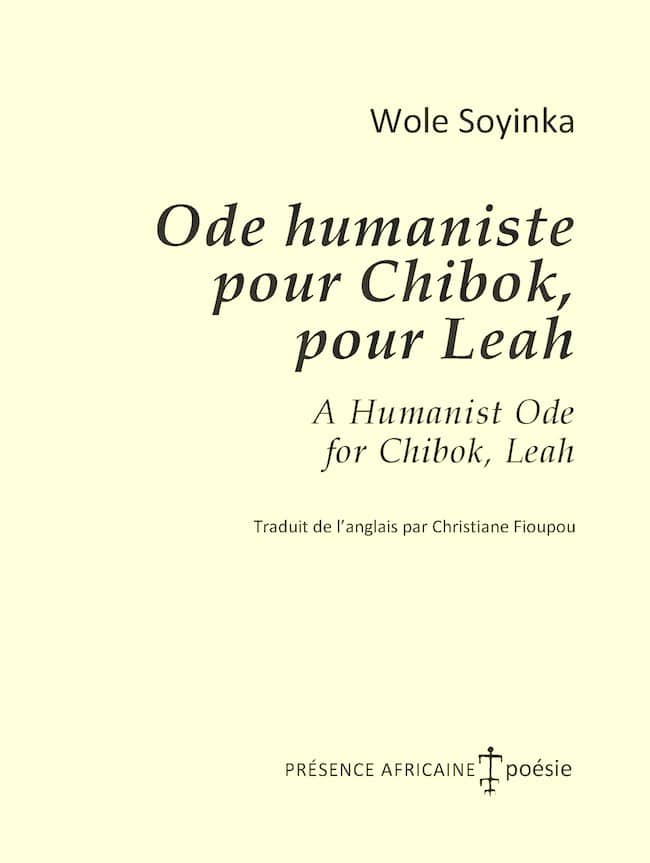
« Des choses immondes se hissent sur les ailes des liturgies / Solennelles – ces scènes deviennent banales » ; ce qui devait être un chemin vers l’élévation spirituelle se mue en festin de charognards, phénomène maintes fois répété au gré des époques et des divinités. Soyinka, dans ce texte plein de blessures et de maladies au propre et au figuré, parle aussi bien des atrocités qui touchent l’Afrique (de l’Ouest particulièrement mais pas exclusivement) depuis une vingtaine d’années que de celles que le continent a connues lors des siècles esclavagistes, de la destruction de créations jugées idolâtres (Bamiyan, Nimrod) que de crimes en contexte de guerre : « Qui se souvient encore de Beslan ? » (prise d’otages en Russie par des terroristes tchétchènes en 2004 au terme de laquelle plus de 150 enfants ont perdu la vie). Ce qui a changé est la médiatisation des actes de violence : des photos et des vidéos en ligne qui ne semblent plus guère susciter l’indignation. Le poète indique aussi, non sans ironie, que les groupes comme Boko Haram rejettent les livres de l’Occident, nient que l’homme ait jamais pu mettre le pied sur la Lune, mais n’hésitent pas à utiliser des technologies comme Internet (création américaine) pour propager leur idéologie.
Soyinka ne ménage personne : les islamistes ne sont pas les premiers à fracasser des idoles et à massacrer des infidèles, les chrétiens en prennent aussi pour leur grade. Il renvoie dos à dos Jungle Jim et Jihadi John, négriers d’hier et passeurs d’aujourd’hui. Une partie du poème est consacrée aux migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, y compris des enfants, lesquels ne survivent pas toujours, loin s’en faut.
Il rend hommage à ceux qui disent non, la jeune Leah Sharibu qui a refusé de se convertir à l’islam est comparée à Nelson Mandela ; à ce jour, selon les informations disponibles, elle est toujours captive de Boko Haram. Kidnappée à Dapchi en 2018, elle n’a pas été relâchée justement parce qu’elle ne s’est pas convertie. Soyinka exprime sa compassion mais aussi quelques réserves : Leah paye le prix fort (elle vit en esclave) pour ses principes, le monde se porterait mieux sans ce genre de martyr.
Le constat dressé par Soyinka n’est pas très différent, sur le fond, des analyses de Neil McGregor (historien de l’art britannique) dans Living with the Gods (Penguin, 2018) : « Ces dernières décennies, avec l’affaiblissement des États-nations à cause de la mondialisation économique ou, dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique, leur effondrement total, la religion est devenue un marqueur d’identité de plus en plus important. Les récits religieux et le sentiment d’appartenance qu’ils peuvent offrir sont plus séduisants, plus puissants et plus dangereux qu’il y a une génération. » Christiane Fioupou cite dans sa préface un passage de l’autobiographie de Soyinka (Aké, les années d’enfance, republié chez GF Flammarion en 2021) où il se rappelle une cohabitation heureuse entre plusieurs croyances… qui semble beaucoup moins facile aujourd’hui.

Wole Soyinka à Stockholm, (octobre 2018) © CC4.0/Frankie Fouganthin
Cette préface bien documentée aide à situer le livre dans l’œuvre de Soyinka et à comprendre les nuances de sa pensée. Citons un passage d’une conférence prononcée par Soyinka en 2014 (sous le titre « Pouvoir, liberté et terreur ») : « La nature du fanatisme religieux est de préférer mutiler ou tuer l’objet de son prosélytisme […] plutôt que de le laisser survivre pour qu’il contribue au genre humain à partir de ses limites et de ses incertitudes, à partir de ses interrogations ou de son scepticisme ; ce carcan mental, qui assimile la simple absence de ferveur exhibitionniste ou de conformisme rigide à une apostasie passible de mort ou de mutilation, n’est pas différent en réalité du caractère tyrannique d’un dictateur politique quelle que soit l’époque ».
La grande force du texte de Soyinka est la richesse de sa langue, où l’on perçoit l’influence de la Bible et de Shakespeare (qui ont, l’une et l’autre, fortement marqué la langue anglaise) mais aussi de la Grèce classique (Homère, Platon), et bien sûr de la culture nigériane : images de funestes oiseaux de proie qui rappellent La prière des oiseaux de Chigozie Obioma, références aux orishas et à l’histoire du pays. La traduction de Christiane Fioupou restitue les tonalités théâtrales (rappelons que Wole Soyinka est aussi dramaturge), les images fortes et le caractère profondément sonore de cette poésie tout en rythmes et en échos : « Les imperators vont et viennent. Nous avons survécu / Aux premiers venus de ce cirque du salut – / Les défenseurs de la Croix, du Croissant, de la Race supérieure, / Encensés dans des récits tachés de sang. Prouesses / Gagnées sur le dos et le sang d’ancêtres recrutés / Sous contrainte – Les vôtres ! Fers au cou, fouettés à / Travers les dunes du désert, serrés – cette métaphore / Tenace se tient – comme des sardines, dans la cale, / Vers des mondes impensables, inconnus, incléments, / Des siècles perdus. Devoir s’agenouiller encore / Devant les anges impériaux assermentés pour sauver ou tuer ? »
L’écriture de Soyinka, nourrie de plusieurs cultures, sert en elle-même son propos. Ainsi l’image récurrente de la fourmi, métaphore de l’homme, se décline-t-elle sur plusieurs modes : les fourmis guerrières transparaissent dans le terme « myrmidons » (ici associé à ceux qui tuent au nom de leur religion) tandis que les fourmilières espérées sur une terre nouvelle se muent en tertres funéraires pour les migrants. L’image de la fourmi traverse toutes les cultures, des mythes grecs et nigérians aux textes bibliques et coraniques, jusqu’à la sociologie contemporaine (on pense aux Fourmis d’Europe d’Alain Tarrius). On est bien peu de chose, mais avec la gangrène du fanatisme la survie est encore plus difficile. Ravager les communautés humaines, brûler les livres, priver les corps de liberté et les esprits de fenêtres ouvertes sur le monde n’est certainement pas le chemin à suivre.