Que faire face à la mort ? Continuer à partager et à transmettre, comme dans le reste de la vie. C’est ce à quoi s’emploie Boris Vildé (1908-1942), ethnologue et linguiste, fondateur du réseau résistant dit « du Musée de l’Homme », durant sept mois d’incarcération nourris de lectures et de réflexion. Réédition augmentée de son Journal de prison.
Boris Vildé, Journal et lettres de prison, 1941-1942. Préface de Dominique Veillon. Notes et postface de François Bédarida. Allia, 208 p., 12 €
Comme l’explique la postface de François Bédarida (rédigée en 1997), Vildé, né à Saint-Pétersbourg de parents russes orthodoxes, a perdu la foi dans l’enfance. Mais il croit à une sorte de « fusion dans un grand Tout, assurant la communion des âmes (apparemment pour l’éternité) », analyse l’historien. Arrêté en février 1941, Vildé est d’abord emprisonné à la Santé, mais il ne commence son journal qu’à son arrivée à Fresnes, le 6 juin. À partir de septembre, l’administration pénitentiaire lui fournit du papier, les prisonniers politiques ont droit à des colis, à de la lecture, à des visites, ce qui adoucit d’une certaine façon le froid et la faim. Même si Vildé ne reçoit pas toujours les deux livres hebdomadaires de la bibliothèque auxquels il a droit, et si l’éclairage pour lire vient souvent à manquer.
Dès le début, le 25 juin, le prisonnier note ce paragraphe programmatique : « Tant qu’on opposera la vie à la mort, on n’avancera pas. Il n’y a pas d’opposition. L’une accomplit l’autre, la prolonge, la complète. Comme il n’y a pas d’opposition entre les deux sexes. » À partir de là, ce qui ne devait être que des notes éparses vouées à la destruction (c’est du moins ce qu’il écrit à sa femme au moment de lui léguer ces « feuilles de Fresnes ») devient la réalisation proprement dite de cette transsubstantiation : la vie passera dans la mort par l’écriture et Vildé demeurera pour toujours une conscience vive de la Résistance. Dans sa dernière lettre à Irène, qu’elle reçoit le lendemain de sa mort (il lui a menti sur la date de son exécution), le programme est achevé. Parlant de la fin qui l’attend, le héros accomplit le renversement annoncé : « Ainsi j’entre dans la vie en souriant, comme dans une nouvelle aventure, avec quelque regret mais sans remords ni peur. »
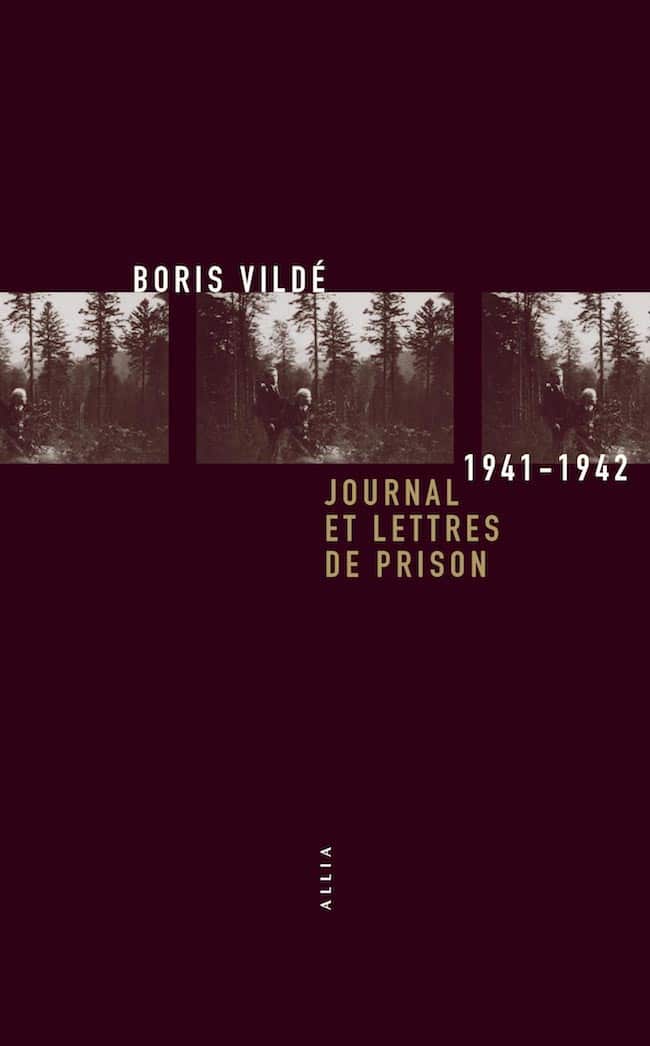
Boris Vildé est vitaliste. Tous son parcours intellectuel à Fresnes ne visera qu’à élaborer une mystique de l’aventure, transformant son arrestation et son procès en sacrifice : « La Mort est pour moi la réalisation du Grand Amour, l’entrée dans la vraie Réalité », écrit-il encore à Irène en janvier 1942. Quelques mois plus tôt, il notait dans son journal, alors que le procureur était venu lui annoncer qu’il était sûr d’obtenir sa tête : « Être fusillé, ce sera un aboutissement logique de ma vie. Finir en beauté. Chacun se suicide à sa propre façon. » Aussi bien, ce court texte ne respire d’une certaine façon que la puissance. C’est sa grandeur, et son défaut. « À chaque page, jugeait déjà Bédarida en son temps, l’on sent passer le souffle d’un personnage hors du commun. » Et de fait, malgré la vilenie qu’il y aurait à ne pas trouver sublimes les écrits d’un fusillé, le.la lecteur.rice cherchera peut-être en vain le doute, la faille humaine, le moment négatif qui lui permettrait – à elle.lui qui ne va pas mourir tout de suite – de trouver une altérité dans ce texte, une porte dérobée par où mettre ses yeux dans ceux de Vildé et son cœur dans sa poitrine de condamné. C’est peut-être parce que Vildé, en bon vitaliste, est un fabricant de certitudes, et que pour passer le temps affreux de la détention il s’exprime le plus souvent par aphorismes et par axiomes, qui font quelquefois mouche : « Le don sans génie n’est qu’un jouet bon marché. Le génie sans don est quelque chose de déplorable ». Ou, ailleurs : « Il est difficile pour un historien d’être optimiste ».
Mais, le plus souvent, il juge à l’emporte-pièce, dialectise avec platitude. On aurait mauvaise grâce, redisons-le, à le lui reprocher : le temps pour former un système de pensée qui rédime son existence et l’Histoire elle-même (il répète qu’il ne faut pas en vouloir au peuple allemand) lui est compté. « J’ai écrit ces pages uniquement pour moi-même », indique-t-il à sa femme. « Ces feuilles n’ont aucune valeur littéraire ni philosophique. » En revanche, elles sont à lire comme un chant d’amour cosmique et désespéré (car « l’espoir n’a rien à voir avec l’amour. Plutôt le désespoir ») : Vildé se passionne pour les religions orientales et cherche dans ses dernières lectures un syncrétisme déiste. L’anthropologue raconte ainsi avoir pris la décision d’écrire à la prison de la Santé : « j’y étais auxiliaire et une fois, en rangeant une cellule devenue libre, j’ai trouvé sur un papier d’emballage d’un colis cette simple et si banale phrase écrite probablement par la femme d’un détenu : je t’aime. J’ai vu alors un immense soleil de l’amour rayonner dans la prison ».

Montage de papiers d’identité de Boris Vildé par Jean-Pierre Dalbéra
Il y a une évidente force performative de l’écriture, on l’a dit : elle est vie, amour, partage – quand bien même Vildé prétend n’avoir écrit que pour lui-même. Mais il n’existe pas de lecture intransitive : tous ces auteurs (Bergson, Pascal, Nietzsche, en particulier, mais aussi des auteurs en vogue ou des commentateurs oubliés) que le résistant dévore durant ces sept mois – et relit quand il n’a plus le choix –, il les fait servir à un système singulier, il les commente, les mûrit (« je réserve mon jugement quant au fond de la pensée de Lossky ») avec en perspective un retour existentialiste à la vie réelle : « Deux grands sujets […] me préoccupent : 1) l’idée du temps ; 2) la définition d’une langue par sa tendance ». Il n’a publié qu’un ouvrage avant sa détention (La civilisation finnoise, 1940), et ce sont évidement là les linéaments de plusieurs essais qui auraient pu venir.
Du 24 octobre au 2 novembre, juste après l’annonce de sa mort prochaine par le procureur, Boris Vildé se lance dans la rédaction d’un dialogue entre « Moi 1 » et « Moi 2 », celui-ci qui veut vivre et celui-là qui peut mourir. Ce texte constitue, indique le prisonnier, « une sorte de credo et d’autobiographie spirituelle », même s’il juge dans la forme et le fond que « c’est très peu ça ». Moi 2 exprime toute la faiblesse de l’homme Vildé et c’est à peu près le seul moment où ce dernier fait preuve d’autodérision et d’humour, évoquant par exemple « une truite au bleu, à la chair tellement tendre qu’on est obligé de penser à la loi de détournement des mineures ». Mais, précisément, parce que la vie n’est pas autre chose que la mort, de la même façon, écrivait-il, qu’il n’y a pas d’opposition entre les sexes, le sacrifice auquel il s’exerce durant toute sa détention sera aussi une ascèse (il note : « aucun élément sexuel » à chaque fois ou presque qu’il rapporte des rêves de femmes) vers « l’amour parfait qui ne se trouve que dans la mort ». Et cette mort sera triomphale, précise-t-il, non parce qu’il aura atteint l’indifférence ou aura vaincu quelque chose, mais parce que le condamné se trouve au point le plus incandescent de son désir de vivre : « Eh bien c’est le meilleur moment », déclare Moi 1 à Moi 2. À se survivre, il ne pourrait plus être désormais que regret et « appauvrissement » de cette libido.












