S’il est permis de parcourir l’histoire juive avec des bottes de sept lieues, il est possible de repérer au moins trois points d’appui dans cette course, de ceux qui servent à la relancer. Le premier serait le débat avec ce que Israël à la période exilique nomme l’idolâtrie ; la construction du judaïsme face au christianisme (et vice versa) constituerait le deuxième ; le troisième, le temps de l’émancipation moderne, fait précisément l’objet de l’interrogation de Bruno Karsenti, lequel n’hésite pas à planter sa tente réflexive devant chaque grande trace de pas que laisse la course derrière elle, et ainsi poursuivre le travail entamé dans son Moïse et l’idée de peuple paru aux Éditions du Cerf en 2012.
Bruno Karsenti, La Question juive des modernes. Philosophie de l’émancipation. PUF, 371 p., 20 €
Il n’y a pas de doute que la modernité place le Juif dans une situation nouvelle. Avant l’émancipation, la question était de savoir qui représentait le « vrai Israël » du judaïsme ou du christianisme. Dieu pouvant « faire surgir comme il entend des enfants à Abraham » (Matthieu, 3, 9), l’apôtre Paul veut établir la nature théologale (la foi) du peuple élu et le libérer d’un coup du nationalisme, de l’ethnisme, et de la différence sexuelle. Dans l’histoire chrétienne, l’enseignement de l’Épître aux Romains, qui énonce à la fois le dépassement de l’ancienne loi et le maintien « sans repentance » du peuple élu comme « olivier franc » du salut sur lequel sont entés tous les païens, peuple témoin, un temps écarté du salut pour que toute la terre y fasse son entrée, et qui sera, au moment du retour du Christ en gloire, avec la Résurrection, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, cet enseignement s’est mué en opposition frontale, entraînant la naissance de stéréotypes dont l’émancipation moderne aura du mal à se dépendre.
Ce déplacement paulinien, la modernité en situe l’opération du point de vue de la raison et de la citoyenneté. La raison universelle invite à abandonner les obscurités du Talmud, la nation oblige à de nouvelles solidarités. L’émancipation s’élargit : il ne s’agit pas seulement de l’intégration dans une nouvelle société, mais d’intérioriser les catégories modernes, le nationalisme, la morale républicaine, pour tenter de déjouer un certain échec du projet émancipatoire, puisque, selon la forte formule de Rosenzweig, « le Juif est désormais partout » (il a quitté le ghetto), et l’antisémitisme s’est démocratisé. Position difficile du Juif moderne qui soit se mondanise, se « déprophétise » et disparaît (et l’on voit que cette disparition ne suffit pas à vraiment le libérer puisque l’antisémitisme demeure), soit conserve le trésor de la Torah et se condamne (ou est condamné) à retourner au ghetto.
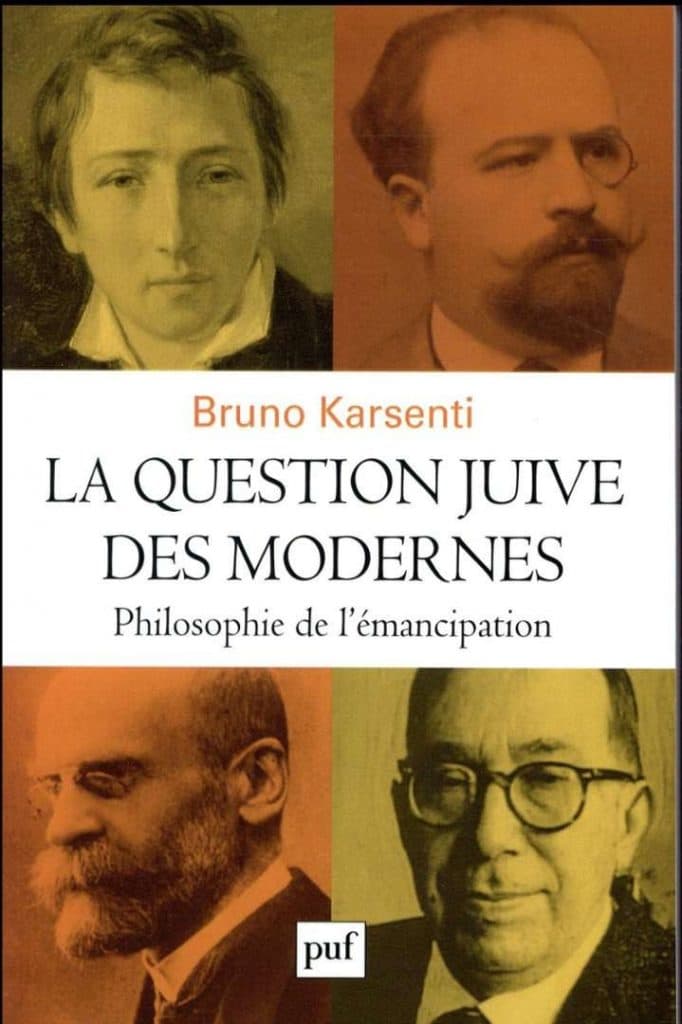 Bruno Karsenti voit la situation moderne dans une structure en chiasme dans laquelle le Juif devient une question pour lui-même en même temps qu’il pose un problème à la nouvelle société naissante, laquelle, à son tour, du fait même de l’apparition de cette « nouvelle question juive », devient une question pour elle-même. Question et problème s’entrelacent (on pense à la distinction que Gabriel Marcel établissait entre mystère et problème, ce dernier trouvant sa solution, alors que le premier ne cesse de se creuser ; Karsenti s’inspire davantage de Jean-Claude Milner qui réélabore la distinction question/problème) au point de se transformer en symptôme pour le moderne et pour le Juif. La question juive fait descendre « la lumière jusqu’au principe de la modernité européenne » : on croyait la résoudre (du moins le « problème ») par l’émancipation, c’est-à-dire la dissolution (assimilation) du Juif, mais le projet lui-même engendre un reste devant lui – le Juif est toujours là – qui en recharge le potentiel interrogateur. Le Juif, quant à lui – qu’il soit celui de la Haskala (les Lumières juives), celui de la Wissenschaft des Judentums (la science du judaïsme), celui encore du sionisme, jusqu’à celui qui dit « je suis hébreu » (et pas seulement parce que l’autre lui lance à la figure), dont parle Derrida commentant Sartre et qui n’est pas bien sûr de ce qu’il dit mais y tient sans savoir vraiment pourquoi, au-delà de toute appartenance, de toute identité – le Juif donc n’est plus sûr d’être à son aise avec la nouvelle « essence » qu’on veut lui coller, la distinction hébreu/hébraïcité de Yerushalmi (dont Freud pensait qu’un jour la science la déterminerait), ne pouvant ni porter le poids qu’il traîne, ni l’abandonner sur la route. Rosenzweig rappelait que l’émancipation avait donné naissance au « Juif isolé », lequel, parce qu’il « est devenu problématique d’être juif », doit se présenter comme « Juif justifié », dans la position même de l’apostat qui se trouve à la fois dehors et dedans, alors que le Juif vivant ne se justifie pas, il laisse ce soin à Dieu. C’était établir que l’émancipation ne consiste pas seulement dans la reconnaissance pleine des droits, mais qu’elle procède à un déplacement : émanciper le Juif à partir de la raison, c’est créer un type nouveau, et se livrer à une opération qui n’aurait sans doute pas été pensable sans celle, ancienne, du christianisme de saint Paul que j’évoquais en commençant.
Bruno Karsenti voit la situation moderne dans une structure en chiasme dans laquelle le Juif devient une question pour lui-même en même temps qu’il pose un problème à la nouvelle société naissante, laquelle, à son tour, du fait même de l’apparition de cette « nouvelle question juive », devient une question pour elle-même. Question et problème s’entrelacent (on pense à la distinction que Gabriel Marcel établissait entre mystère et problème, ce dernier trouvant sa solution, alors que le premier ne cesse de se creuser ; Karsenti s’inspire davantage de Jean-Claude Milner qui réélabore la distinction question/problème) au point de se transformer en symptôme pour le moderne et pour le Juif. La question juive fait descendre « la lumière jusqu’au principe de la modernité européenne » : on croyait la résoudre (du moins le « problème ») par l’émancipation, c’est-à-dire la dissolution (assimilation) du Juif, mais le projet lui-même engendre un reste devant lui – le Juif est toujours là – qui en recharge le potentiel interrogateur. Le Juif, quant à lui – qu’il soit celui de la Haskala (les Lumières juives), celui de la Wissenschaft des Judentums (la science du judaïsme), celui encore du sionisme, jusqu’à celui qui dit « je suis hébreu » (et pas seulement parce que l’autre lui lance à la figure), dont parle Derrida commentant Sartre et qui n’est pas bien sûr de ce qu’il dit mais y tient sans savoir vraiment pourquoi, au-delà de toute appartenance, de toute identité – le Juif donc n’est plus sûr d’être à son aise avec la nouvelle « essence » qu’on veut lui coller, la distinction hébreu/hébraïcité de Yerushalmi (dont Freud pensait qu’un jour la science la déterminerait), ne pouvant ni porter le poids qu’il traîne, ni l’abandonner sur la route. Rosenzweig rappelait que l’émancipation avait donné naissance au « Juif isolé », lequel, parce qu’il « est devenu problématique d’être juif », doit se présenter comme « Juif justifié », dans la position même de l’apostat qui se trouve à la fois dehors et dedans, alors que le Juif vivant ne se justifie pas, il laisse ce soin à Dieu. C’était établir que l’émancipation ne consiste pas seulement dans la reconnaissance pleine des droits, mais qu’elle procède à un déplacement : émanciper le Juif à partir de la raison, c’est créer un type nouveau, et se livrer à une opération qui n’aurait sans doute pas été pensable sans celle, ancienne, du christianisme de saint Paul que j’évoquais en commençant.
Depuis cette forte caractérisation, Bruno Karsenti entend reprendre la pensée de l’émancipation et il ne l’abordera pas sous l’angle de la réflexion proprement juive. Il voudrait l’appréhender sous l’angle de la philosophie politique qu’il s’efforce de réinventer en travaillant à même les matériaux fournis par les sciences sociales, lesquelles ont fortement contribué à identifier les processus de socialisation, les pratiques de conquête de leur autonomie des individus qui cherchent à se constituer comme sujet à travers tout un réseau d’institutions. Au travers ce qu’il appelle des portraits, l’oublié Joseph Salvador (1706-1786), historien autodidacte du Sud de la France qui se lança dans une polémique avec le christianisme en pleine Restauration, Bernard Lazare (le trop oublié), Durkheim, Leo Strauss (trop réduit à être le père de la révolution conservatrice) – Heine, Marx, Freud, Rosenzweig, Marc Bloch et Emile Benveniste étant aussi du voyage –, le philosophe décrit les paradoxes de la difficile condition moderne : qu’est-ce qu’être soi (c’est-à-dire dans quelle inscription sociale ?), « que suis-je ? en tant qu’individu institué », avec son histoire, son héritage, assumés ou pas, comment parvenir à ce soi avec les autres qui eux-mêmes doivent le devenir, et tout ce maelström à l’intérieur d’institutions toujours menacées d’un renversement complet du projet qui a présidé à leur création.
Tout aura été tenté : la voie de l’émancipation par l’État, création moderne s’il en est, allant jusqu’à la création d’un État Juif, émancipation ou plus exactement légitimation – cette démarche étant parallèle à celle du catholicisme libéral au XIXe siècle – par l’établissement d’une généalogie juive de la possibilité de la modernité en tant que telle par la mise en avant du thème de la loi (Salvador), l’exemplarité révolutionnaire du paria Job chez Lazare, un certain « sauvetage sociologique » du judaïsme chez Durkheim dans le cadre de son enquête sur le suicide, cette « religion inférieure » pouvant contribuer, par sa capacité à prendre en charge les moindres détails de la vie des hommes, à construire la morale républicaine. Ajoutons l’effort de réinterprétation du thème de l’élection chez Strauss comme « symbole le plus manifeste du problème humain en tant que problème social et politique », au plein cœur d’une société libérale qui croit en avoir fini avec les contradictions et la discrimination, et pouvoir s’installer tranquillement dans le polythéisme de valeurs.
Dans un contexte qui oblige à reprendre la question de l’émancipation, on peut regretter que Bruno Karsenti nous livre, en lieu et place d’un livre qui s’imposait, un recueil d’articles qui restent dans le champ de l’histoire des idées sans descendre dans le concret des procédures d’intégration ou d’assimilation et des catégories et des enjeux philosophiques qu’elles révèlent, qu’elles viennent de l’État (la confessionnalisation qui fait passer de la « nation » à la « confession », l’organisation consistoriale à l’instar du protestantisme, etc.) ou des individus et de la communauté eux-mêmes (changement de noms, mariages mixtes, pratiques associatives, adaptation de la liturgie, apparition d’un judaïsme libéral, ou bien, à l’inverse, résistance à la modernité, intégrisme liturgique, etc.). Si le cas des Juifs est exemplaire de la question de l’émancipation, suffit-il de repérer des « décalages et des frottements » dans les énoncés de penseurs juifs et modernes qui ont été capables « de se nommer comme juifs », alors même que Bruno Karsenti nous rappelle justement que la question possède deux versants d’égale importance : « s’émanciper de quoi et avec quoi » ?
Autrement dit le livre de Bruno Karsenti se termine là où il trouve son vrai commencement en posant la question, ô combien importante et actuelle, des bonnes institutions de l’émancipation qui permettent à l’individu de dire un « je » articulé à un « nous » pouvant être assumé par les « je » qui s’en revendiquent.
-
Jacques Derrida, « Abraham, l’autre », dans Judéité, Éditions Galilée, 2003.
-
Franz Rosenzweig, « L’Homme juif », dans Confluences. Politique, histoire, judaïsme, Vrin, 2003












