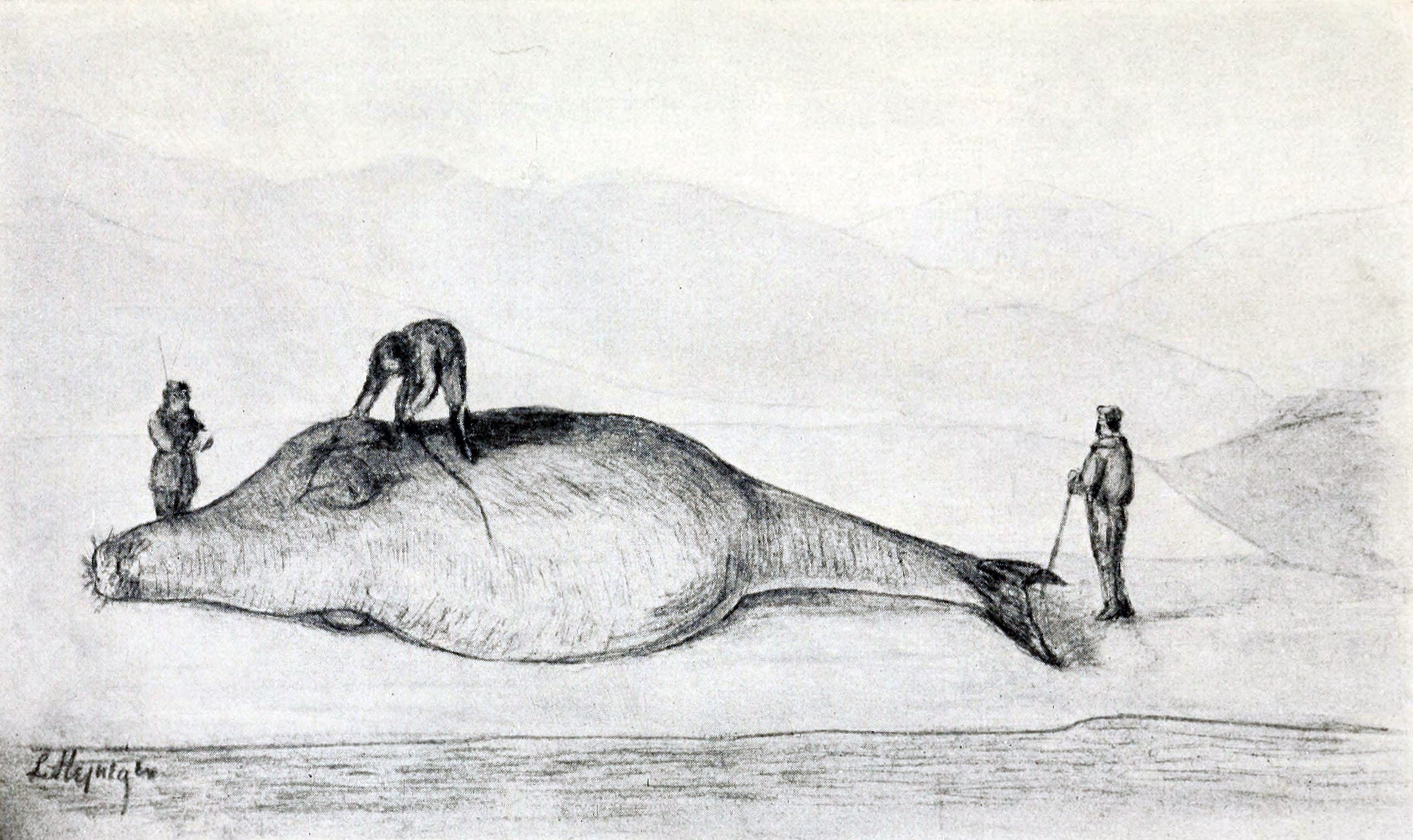Dans chacune des neuf nouvelles que réunit le recueil Je suis une idiote de t’aimer, de Camila Sosa Villada, on trouve ce tournant souligné par l’oralité du conte : une affirmation de soi malgré les assauts acharnés d’une communauté annihilant un être qui résiste simplement par son existence, sa subsistance, en un pied de nez à une société aussi minable qu’odieuse.
Camila Sosa Villada poursuit une œuvre provocatrice connue depuis le succès retentissant des Vilaines, qui narrait le quotidien d’une travestie, prostituée et étudiante installée à Córdoba, en Argentine. Cette autofiction ajoutait au souvenir d’années précaires vécues par l’autrice – de l’enfance à la toute jeune adulte qui trouve une forme de soutien dans la communauté fragile des prostituées du parc Sarmiento – une imagination débordante, où l’âge et les corps s’étirent, se déforment, où la nature s’invite dans des métamorphoses animales.
Forte d’un style qui décrit sans détours la difficulté à survivre de ces ni hommes ni femmes en proie aux insultes, à la pauvreté, à mille violences de la part de la société au dedans et en dehors de leurs foyers, Camila Sosa Villada épatait par une langue d’une poésie tranchante, dont la beauté ne venait rien opposer, enlever ni ajouter à l’implacable des faits racontés. Pas un témoignage réaliste, pas le récit d’une initiation à la transcendance littéraire de celle qu’on tente de rapprocher du « réalisme magique », Les Vilaines a posé les bases d’une écriture qui continue ici de se déployer, flamboyante, impudente et incisive, dans le format court. Objet de souvenirs ou de fantasmes, la chair y est décrite par le menu dans ses appétits (plus du ventre que du sexe, le sexe venant surtout parce qu’il faut manger), ses sucs, son dépérissement.
Çà et là, de manière plus sporadique que dans Les Vilaines, dont elle reprend certains événements, l’autrice joue avec le récit de son propre vécu. Au terme de « trans » qui médicalise, assigne à une identité, elle a, à plusieurs reprises, dit préférer celui de « travesti » (« trava » existant aussi en espagnol d’Amérique latine), qui renvoie davantage au rejet de l’identité masculine et à l’éclatement des normes féminin/masculin qu’au changement de genre. En 2022, sa préface à l’édition anglaise des Vilaines a encore plus explicitement souligné son point de vue : « Sous l’équateur, à l’autre bout du monde, nous nous sommes associées pour déterrer le mot travesti. Il avait été pompeusement enterré au profit de mots qui nous étaient complètement étrangers […] Je n’utilise pas le terme femmes trans. Je n’utilise pas un vocabulaire chirurgical, aussi froid qu’un scalpel, parce que ce vocabulaire n’exprime pas nos expériences comme travestis dans ces régions ». Si « travesti » fait écho en français à d’autres réalités, vu les positions de l’autrice, il serait plus heureux de l’utiliser, quitte à le replacer dans son histoire et son emploi dans le monde hispanophone non occidental, que celui de « trans », qu’on retrouve encore dans Je suis une idiote de t’aimer – dont la traduction, par ailleurs, transmet très bien l’oralité, l’humour toujours cinglant et surprenant de Camila Sosa Villada.

Parmi les « contes » du recueil, on plonge donc dans le quotidien réel d’un travesti, depuis l’enfance cernée par un père alcoolique et une mère absente jusqu’aux passes de l’adulte avec des clients riches, bêtes et méchants. « Gracias, Difunta Correa » raconte le pèlerinage de ses parents à l’autel d’une sainte connue pour être morte de soif dans le désert, son bébé au sein lui ayant survécu. Son agonie y est partagée à la deuxième personne : « Quand tu n’as plus d’eau et que tu marches sous un soleil qui te déteste, que tu es perdue et qu’un être pleure contre ta poitrine, tu regrettes d’avoir fui le salopard qui t’a poursuivie au point de t’obliger à te tirer comme une vermine, tu n’as plus qu’à renoncer. Insulter ton connard de mari et dire là c’est bon, j’arrête. Te réfugier dans l’abandon qui est le tien et laisser la fatigue et la soif faire leur travail. En tenant ton enfant contre ta poitrine. En délirant et en poussant tes derniers soupirs parmi les explosions de lumière dans la poussière ardente. » C’est bien l’autrice qui nous parle, rapidement dévoilée au début de l’histoire car « dans l’écriture il est inutile de cacher une première personne, autrement les textes commencent à devenir malades au bout de trois ou quatre paragraphes ». Ce style informel, direct, qui n’hésite pas à alpaguer son lectorat comme une conteuse son public, d’où jaillissent des images sans artifices et où le trivial trouve sa place dans un langage soudainement beau, Camila Sosa Villada ne l’abandonne jamais, même lorsqu’elle prête la narration à une autre voix.
Dans « Cotita de la Encarnacion », l’autrice se fond dans la mémoire de cette icône queer mexicaine, brûlée avec une cinquantaine d’autres « sodomites » en 1657. En revenant sur ses derniers jours, elle l’imagine reconnaître dans ses tortionnaires ses amants, se rappeler l’initiation charnelle qu’elle leur a donnée, partageant ses techniques liées aux fluides et aux sens, et se souvenir de sa mère dans un refrain, une « chanson d’amour » prenant la place d’une dernière confession : « Ces hommes-là, je les appelais mon âme, mon amour, bien sûr que je le faisais. J’étais issue du sentimentalisme. Ma mère indienne lavait les vêtements à la tombée de la nuit dans une auge brillante et pure. Lorsque j’étais petite et que je tombais malade, ma mère me donnait à manger des fleurs de courge. Ma mère a été la première à m’appeler Cotita, elle a renoncé à mon nom de baptême, il n’y avait plus de Juan pour personne. Moi, je leur disais mon amour et ils l’ont payé sur le bûcher. Une longue chanson d’amour mexicaine. » Prise au piège des tortures atroces de l’Inquisition, Cotita jettera l’anathème sur le lac Texcoco, définitivement asséché – maudire en dernier recours, vengeance froide récurrente chez les personnages de Camila Sosa Villada.
D’autres nouvelles cousent à partir d’un lambeau d’histoire réelle le récit chatoyant d’une rencontre avec des travestis dont les personnages ne sortent pas indemnes, comme celle qui donne au livre son titre, Je suis une idiote de t’aimer. Titre d’une chanson de Billie Holiday, celle-ci reprend l’anecdote confiée par la chanteuse dans son autobiographie d’une amitié avec deux homosexuels à qui elle prêtait des robes et qui venaient la voir en prison. La chanteuse vieillie, malade, quittée par son mari, en proie aux addictions et aux interdictions de chanter, trouve ici une amitié réconfortante en la présence de ces deux coiffeuses travestis latinas de Harlem. Et malgré ses propres malheurs, elle les rassure : « elle savait bien qu’il y avait beaucoup de choses à améliorer dans ce monde, qu’il y avait beaucoup à faire, beaucoup de choses à changer. Que ce n’était pas simple. Mais elle mentait pour nous faire plaisir et ça, c’était mieux que l’amour ». Rattrapée par sa tragédie, Billie Holiday, dans le réel comme dans le livre, meurt, seule et internée, un rouleau de vingt dollars dans une chaussette : une histoire dont Camila Sosa Villada avait déjà repéré le potentiel littéraire en lui consacrant un spectacle de théâtre en 2009.

La mort est présente partout dans les nouvelles de Je suis une idiote de t’aimer, non comme une menace mais comme quelque chose de tangible et de central, dont la réalité frappe de manière froide lorsqu’une grand-mère et sa fille prennent leurs fusils après avoir discuté pendant leur goûter du racisme qui les vise, ou lorsque, dans des nouvelles comme « Le foyer de la compassion » ou « Six mamelles », l’horreur prend des atours fantastiques et apocalyptiques. Camila Sosa Villada récuse l’appellation de « réalisme magique » pour son œuvre, et, dans un entretien, elle a lancé, amusée, celle de « science-fiction pauvre » : il n’y a pas d’enchantement de la nature dans un quotidien connu mais un monde qui broie et tue, de petites communautés qui résistent sous la forme d’un couvent ou d’une tribu recluse dans la jungle où brillent de nouvelles figures d’autorité plus humaines, des animaux effrayants ou avec lesquels on s’accouple par résistance. Les espèces s’hybrident sans gore ni romantisme, la survie implique des mutations, appétits sexuels et reproductifs inclus. « Six mamelles » relate plus particulièrement les massacres de trans dans une société où elles étaient assimilées et qui les oblige à s’exiler au fond d’une forêt sans foi ni loi, récit d’anticipation où le fascisme éclate au grand jour. Et dès lors que se nourrir, s’abriter, se reproduire, prennent des formes différentes, les animaux et les personnages gagnent une dimension mythique déjà amorcée dans Les Vilaines, mais les symboles ici se répandent dans tout le quotidien.
Qu’elle plonge dans la vie d’une travestie immolée au XVIIe siècle, d’une sainte païenne argentine du XIXe, d’une chanteuse afro-américaine dans le New York des années 1950, dans le quotidien d’enfants ou de prostituées plus contemporaines… Camila Sosa Villada amorce des filiations historiques et inventées, continue de raconter l’expérience des travesties mais en ramifie les lieux et les époques, déployant fertilement son imagination pour mieux souligner l’inassimilable de cette expérience par la réalité sociale et culturelle que l’on connaît.
Cet article a été publié sur le site de notre partenaire Mediapart.