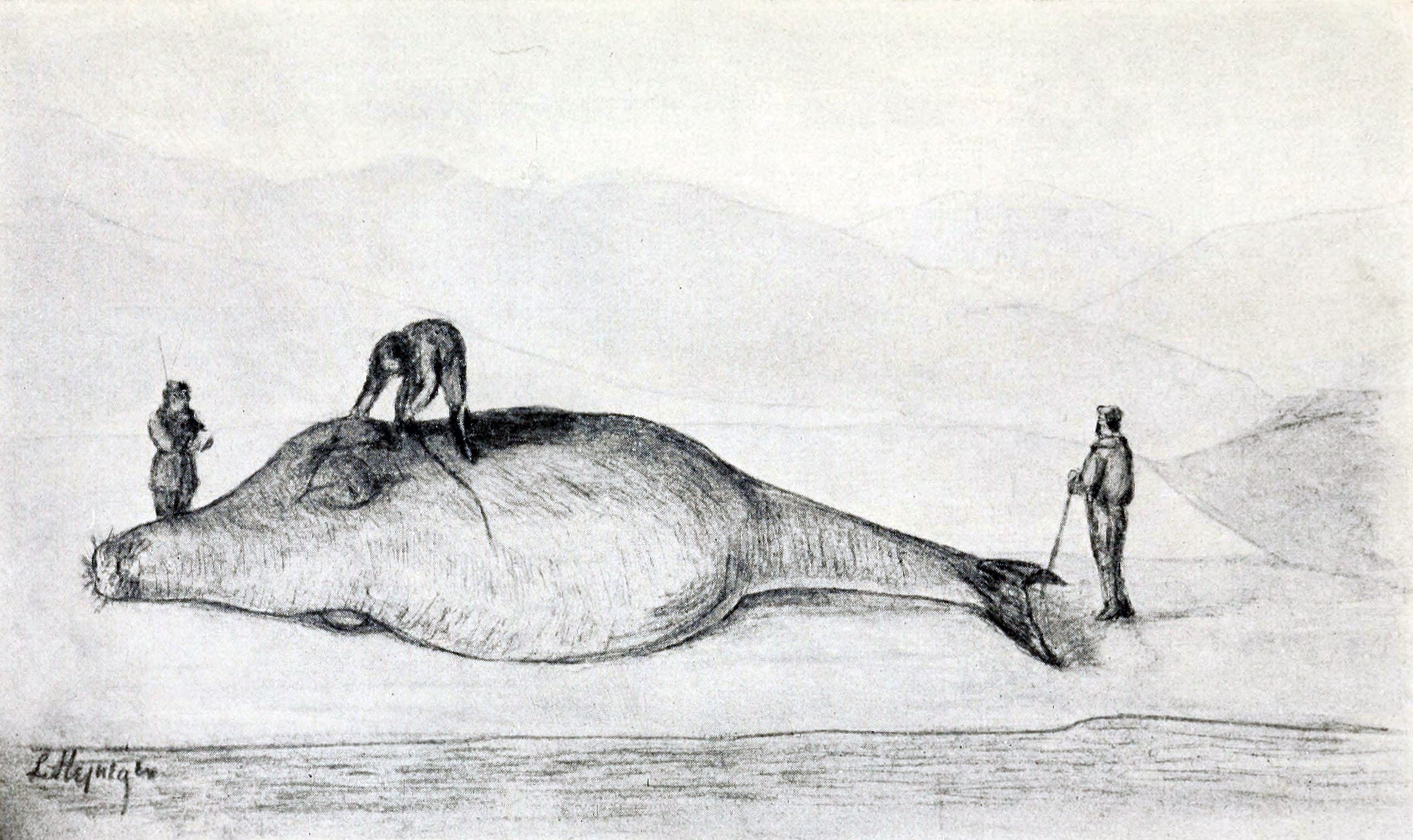Entremêlant la chronique et l’autobiographie au roman, l’écrivain cubain Leonardo Padura réussit dans Aller à La Havane une biographie nostalgique et passionnée de sa ville. On y éprouve La Havane dans tous ses états.
Leonardo Padura n’en fait pas mystère. Il est attaché à La Havane par toutes les fibres de son être : celles de l’écrivain et de l’habitant, du lecteur et du citoyen, du flâneur et du chroniqueur qu’il est tout à la fois. Il n’a jamais quitté sa ville, à la différence de bien d’autres écrivains havanais de sa génération, des précédentes et des suivantes, exilés lors des crises économiques et politiques successives qui ont affecté la vie à Cuba depuis la révolution de 1959 – et tout au long du XIXe et du XXe siècle. Lorsque, de l’étranger, tel ou tel journaliste s’en étonne benoîtement et lui en demande la raison, il répond avec une clarté méridienne : « je suis ici parce que j’appartiens à ce lieu, parce qu’ici est ma raison d’être qui fait que je veux et que j’ai besoin d’écrire, ici vivent les gens dont je veux exprimer les doutes, les espoirs, les frustrations, les peurs. Parce qu’ici est ma langue, cette langue havanaise dans laquelle je parle et j’écris ». Et plus encore, car il se voue à la quête d’une vérité à fixer par l’écriture, dans un geste de rectification ou de réfutation citoyenne des discours officiels du régime.
Vie, ville et écriture ne sauraient donc être dissociées aux yeux de l’écrivain. Aller à La Havane en est l’éclatante preuve, qui mêle la biographie de la capitale cubaine à l’autobiographie de l’auteur en une entreprise mémorielle où l’essai le dispute au roman, l’affect à la lucidité critique, le sentiment d’« étrangéïté » à la certitude de l’appartenance. Le sens de ce néologisme s’éclaire sans peine au souvenir des fameux vers du « Cygne » de Baudelaire : « la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel ».
Car durant les soixante-dix années de sa vie que se remémore Leonardo Padura, qui en 1959 fêtait à peine ses quatre ans, les mutations de La Havane dont il précise les traits se sont succédé à un rythme peu commun. Non pas sous les coups de boutoir de la modernisation urbaine et de la mondialisation, comme celles de toute grande ville pendant la même période, mais, révolution et crises obligent, de manière singulière voire paradoxale. Ainsi, tel un corps en mue, la « ville socialiste » tarde quelques années à apparaître après 1959, se logeant dans la ville républicaine suite à la totale étatisation de l’économie, à la réaffectation de bâtiments et à la réattribution des logements privés des exilés.
Quant à la trépidante et incomparable vie nocturne de La Havane, qui palpitait encore dans les innombrables cabarets, bars, restaurants et salles de cinéma des années 1960, elle reçoit un coup mortel lors de la mise au pas morale et culturelle de la population après 1968. Baptisé « Offensive révolutionnaire », cet ensemble de mesures appelle à la création de « l’Homme Nouveau », dévoué corps et âme à la patrie socialiste. Dans les années 1990, après la dislocation de l’URSS et le retrait du soutien économique russe au régime cubain, les pénuries de la « Période spéciale en temps de paix » alias la « Crise » ont parachevé le lent mais sûr délabrement des constructions, des infrastructures et des voies publiques. Certes, l’extraordinaire ingéniosité du désespoir des Havanais a tant bien que mal pallié la décadence des logements, tout en l’aggravant par le manque de civisme né des extrêmes difficultés de la période.

Enfin, le relâchement ultérieur du contrôle de l’économie par un État désormais démuni, l’essor par à-coups du tourisme international, brutalement suspendu durant la pandémie de covid, ont suscité de criantes inégalités socio-économiques et de très visibles et hauts contrastes au sein du tissu urbain. N’a pas manqué de les accentuer, après l’embellie économique de 2015-2016 grâce au rétablissement par Barack Obama des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, l’implacable accroissement des mesures de restriction du blocus américain lors du premier mandat présidentiel de Donald Trump, sans parler de l’actuel. Rien d’étonnant, donc, à ce que le texte qui clôt la première partie autobiographique et biographique d’Aller à La Havane s’intitule « Apocalypse Now », ni à ce que le recueil de chroniques urbaines de la seconde partie s’achève sur « La Havane pleure », élégiaque et passionné envoi de l’écrivain à sa ville.
Désenchanté, échaudé, profondément chagriné, le Havanais Leonardo Padura ? Certes, mais aussi étonné, séduit, enflammé par la Havane qui, rescapée de tant de désastres, brave les vicissitudes et les destructions pour, sinon renaître dans toute sa splendeur passée, sans cesse se survivre. Pour ce livre qui, explique l’auteur, souhaitait advenir, son éditeur espagnol chez Tusquets a eu l’idée inspirée de l’inciter à mêler aux essais et aux chroniques qu’il a écrits ex professo des passages de ses romans, que sa complice, la scénariste Lucía López Coll, a choisis et disposés avec talent. L’effet de vases communicants entre fictions et réflexions de l’écrivain achève de donner un tour affectif et romanesque à la biographie de La Havane ou à l’autobiographie avec ville qui fait la première partie de l’ouvrage : « Comment je suis arrivé de Mantilla à La Havane ».
Havanais dans l’âme, Leonardo Padura et les personnages de ses romans – son fameux détective Mario Conde, le poète José María Heredia, les exilés dispersés de Poussière dans le vent (2021), les Juifs cubains d’Hérétiques (2014) – portent tous sur leur ville un regard aussi amoureux qu’irrémédiablement nostalgique. C’est de l’idyllique lieu de l’enfance, le quartier périphérique de Mantilla, que le gamin Padura, juché sur le toit d’une demeure patricienne inhabitée, découvre, émerveillé, le panorama de La Havane bordé de la mer Caraïbe. La Havane, c’est la « Vieille Havane » coloniale et les rues du centre commerçant d’avant la révolution, où il se rend de loin en loin avec ses parents, car, à Mantilla, n’est-ce pas, on trouve de tout. Lieu fondé par un bisaïeul, ce dont la famille Padura ne tire pas peu fierté, Mantilla ne ressent guère, tout d’abord, les effets de la révolution, continuant de vivre sa vie de bon voisinage et de modestes joies quotidiennes. Les garçonnets y jouent dans la rue Libertad au base-ball, cette absolue passion nationale ; les adultes y discutent combats de coqs et s’y réunissent en « Frères », blancs et noirs, dans leur loge maçonnique.
C’est là que se forme moralement le futur écrivain, entre esprit de fraternité maçonnique et vertus catholiques de charité et de solidarité. C’est là que vit le désabusé Mario Conde, qui s’y réchauffe le cœur et l’estomac en compagnie de ses fidèles amis. Et c’est là que vit toujours Leonardo Padura, accroché à sa maison familiale et à son quartier « comme l’huître à son rocher ». C’est de Mantilla qu’il est parti à la conquête de La Havane, l’explorant et se l’appropriant au fil des années. En vingt chroniques avec lesquelles se fondent des extraits de romans, « Comment je suis arrivé de Mantilla à La Havane » retrace cette conquête, croisant la découverte d’espaces et de quartiers de la ville avec les travaux et les heures de l’écrivain et journaliste.
Et toujours, le regard rétrospectif de l’auteur s’accorde à celui de ses personnages pour raconter ce qu’il est – tristement, le plus souvent – advenu de ces lieux aimés. Voici donc La Víbora de son adolescence, dont les parcs ont abrité ses premiers flirts ; le Vedado de sa jeunesse, dont la glorieuse Rampa des années 1960, bordée de cabarets, de cinémas et de lieux culturels, a été progressivement défigurée par la répression morale de l’« Offensive révolutionnaire » ; les 138 salles de cinéma des années 1950, pour la plupart disparues ; les quartiers de l’ancienne vie nocturne, avec leurs musiciens prodiges ; la « Vieille Havane », qui fait exception car la ville coloniale a été restaurée, tel un parc d’attractions, pour le bien du tourisme ; les calmes quartiers sis de l’autre côté de la baie : Regla, Casablanca, où mènent des vedettes. On les prend, en compagnie du chroniqueur Padura, dans la seconde partie d’Aller à La Havane : « Mémoire de quelques quartiers et de quelques personnages ».
Les chroniques et les reportages qui y sont rassemblés, écrits entre 1984 et 2015, illustrent à la perfection comment y ont germé les univers, les lieux, les atmosphères et les personnages des romans, policiers ou historiques, de l’auteur ; comment, déjà, l’art de la narration y tendait vers le romanesque. L’attrait pour les lieux emblématiques de l’histoire de la ville ou de sa vie présente, la contagieuse fascination du journaliste Padura pour de mythiques figures havanaises, ses études sur le vif des mémoires de certaines communautés immigrées – les puissants et industrieux Catalans, les coolies chinois aux espoirs déçus –, préfigurent nombre de ses fictions. Fièrement havanais, Leonardo Padura est tout aussi fièrement journaliste, voyant dans l’exercice initial de cette écriture pour la presse l’école même qui l’a formé à l’écriture littéraire. On ne saurait le contredire. D’autres célèbres polygraphes latino-américains, tel Gabriel García Márquez, ont su moduler et accorder leurs écritures pour la chronique ou pour le roman. Enfin, fidèle en amitié, l’auteur ménage, à côté des textes d’Aller à La Havane, une place aux photographies de son complice Carlos T. Cairo. On les feuillette au début et à la fin du livre, qui pourrait bien instiller en nous l’incurable nostalgie de La Havane dans tous ses états.