Avec son nouveau roman, Insula, Théo Casciani livre un récit ô combien réussi qui se propose d’investir, peut-être, autrement, les enjeux d’un genre devenu aussi balisé, pour ne pas dire attendu : la dystopie. Une lecture frappante.
Avant de commencer, il faut parler du genre dystopique, important sinon central dans le corpus de la science-fiction et jalonné de ses monuments en tête desquels les œuvres d’Orwell, de Huxley ou de Bradbury. Il faudrait encore citer le grand genre du cyberpunk, populaire tant en littérature qu’au cinéma et qui a connu récemment une forme de renouveau. Dans ces œuvres, ou en tout cas dans leur version connue du grand public et souvent la plus représentée, l’histoire se passe dans un avenir proche, dominé au choix par un régime fasciste ou un capitalisme de grandes corporations qui se substitue aux États pour dominer le monde. Dans les deux cas, il s’agit d’un système que l’on pourrait qualifier de totalitaire, dont l’incarnation prototypique serait l’Océania orwellienne.
Seulement, la surreprésentation de ce genre dans la culture populaire pose un sérieux problème : l’imaginaire totalitaire dans lequel puisent ces œuvres est largement remis en cause ainsi que le concept même de totalitarisme par plusieurs historiens, parmi lesquels on citera Ian Kershaw ou Johann Chapoutot. Sans entrer dans le débat, le problème le plus immédiatement intelligible du concept est qu’il sert à amalgamer plusieurs régimes de nature différente comme l’Allemagne nazie, l’URSS, soit stalinienne soit pour les plus anticommunistes dès 1917, la Chine maoïste ou plus récemment l’État islamique. Sans théoriser ni même employer ce concept, l’esthétique de la dystopie emprunte bien souvent à cet imaginaire avec la même approximation. Comme son pendant mélioratif, l’utopie, la dystopie finit souvent par être un non-lieu, qui s’inspire de tel ou tel régime historique de manière souvent superficielle, sans jamais parvenir à entrer dans une préhension concrète, loin d’une certaine mécompréhension qui voudrait que la science-fiction soit mieux à même de cerner le contemporain et ses lignes de fuite. Ainsi, les dystopies se trouvent bien souvent dépassées au moment même de leur création, comme le roman d’Orwell qui dès 1949 semble désespérément tourné vers l’arrière, celui de la guerre ou de la Grande Terreur des années 1930.
Mais un autre courant traverse l’écriture dystopique et en saisit les codes pour aussitôt les détourner. L’uchronique Maître du Haut Château de Philip K. Dick, qui décrit un monde où le Japon et les nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale et se partageraient l’Amérique du Nord, joue en réalité sur le monde « de pacotille » qu’il dépeint, au sein duquel se situent d’autres univers alternatifs : un roman qui décrit une Terre où l’Angleterre a changé le monde en Commonwealth intégral, une téléportation vers un univers parallèle qui n’est autre que notre réalité, pour finalement retourner complètement le dispositif : en plein maccarthysme où a été écrit le roman, semble nous dire Dick, et à regarder l’actualité depuis la seconde élection de Donald Trump, il est difficile de lui donner tort, il importe peu de regarder en arrière, de craindre le nazisme, le stalinisme, ou au contraire de se réjouir de la reddition du Reich, alors que l’Amérique est fasciste et que c’est précisément cette Amérique qui a gagné la guerre. Bien plus, l’écrivain, tout au long de son œuvre, que l’on cite l’exemplaire Temps désarticulé ou Ubik, où la réalité se fracture sans cesse, semble nous dire que c’est de la dystopie qu’il faut détourner le regard pour enfin voir.
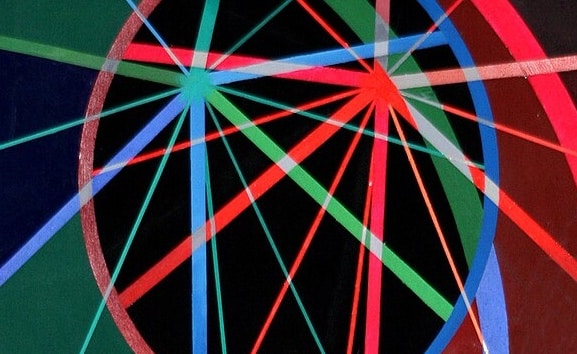
C’est à cette invitation que répond Insula de Théo Casciani. Le terme latin d’insula peut avoir deux significations : celui d’une île et celui d’un îlot urbain qui ira jusqu’à désigner de manière plus précise, à l’époque impériale, un immeuble divisé en appartements pouvant atteindre, nous dit Pline l’Ancien, sept étages. Le roman se situe entre ces deux espaces, celui de l’isolement hors du monde tout autant que de l’intégration en plein cœur du tissu urbain le plus dense (que l’on pense encore à Martial qui décrivait dans ses Épigrammes la surpopulation de ces insulae). Dès lors, le roman oscille entre les deux sens suggérés par son titre, aspiration à un dehors ou une forme de désertion et prise au sein du contemporain. L’auteur semble alors écrire une non-dystopie, ou plutôt une dystopie qui ne fait que s’annuler à mesure qu’elle s’écrit. « Vous lisez les mots de quelqu’un qui tâche de passer d’un espace à l’autre en essayant de ne pas se cogner. » De manière explicite, le secret du roman est énoncé dès la page 24 : « un roman que je voulais inaugurer avec le mot “bien” et conclure par le mot “mal” pour explorer ce qu’il y a entre les deux ».
Le roman raconte un futur proche où l’on peut accéder à un monde virtuel via un psychotrope rendu illégal et activement recherché par les autorités. Le narrateur, qui évolue entre Londres et Paris où il est contraint de revenir pour accompagner son père mourant, se voit accuser du meurtre d’un garçon mort dans ce jeu clandestin. Le récit est par ailleurs très explicite sur le monde qu’il décrit, la France et plus largement l’Europe contemporaine. Sur ce point, Théo Casciani peut parfois agacer par une trop grande explicitation et la trop grande référentialité de son narrateur. Deux exemples : le personnage croise dans le train Jordan Bardella et se fend d’une réflexion sur la dimension exceptionnelle de cette rencontre tant la faible fréquentation du Parlement européen par le député est notoire, ou encore ce même narrateur aime à employer régulièrement des aphorismes ou des généralités dont on sent bien qu’ils ou elles sont imputables à l’auteur et qui frisent parfois la banalité, comme lorsqu’il écrit : « tout le monde devient son propre média », ou encore : « l’algorithme polarise, déshumanise ».
Cette tendance discursive mise à part, il faut bien reconnaître l’ambition d’Insula autant que son envie de se placer à contretemps de toute attente. L’écrivain nous livre ainsi de très belles pages, émaillées de trouvailles fortuites, comme lorsque le narrateur survole en avion l’Europe secouée par un séisme : « Les secousses continuent et nous restons suspendu-e-s en attendant que le monde se calme ». De manière générale, il n’est jamais clairement établi que la dystopie, d’une part se situe dans un moment précisément défini, d’autre part soit même l’objet premier du récit tant les strates de réalité, notre monde, celui de l’écrivain qui écrit et du lecteur qui lit, et le futur de la dystopie, se mêlent et s’entrecroisent, d’une manière qui parfois confine à l’incohérence.
Mais c’est là qu’il faut être attentif (et bien entendre que ce dernier point n’est absolument pas à prendre en mauvaise part) : le texte de Théo Casciani, dans le geste même où il construit la dystopie vers laquelle le lecteur tend les yeux – avide d’ailleurs et de divertissement –, annule cette construction, saisit son lecteur et l’empêche précisément de détourner le regard. Le seul monde qui vaille, qu’il soit perçu comme dystopique ou non, c’est le monde présent et, en ce sens, l’intrigue du roman forme un matériau tout à fait réaliste : la prise du narrateur dans les rouages d’un autoritarisme policier qui prend prétexte de la lutte contre les stupéfiants et l’expérience du deuil d’un parent. Comme Dick, Théo Casciani se refuse à investir un autre monde, bien trop occupé qu’il est à habiter l’équivoque intrinsèque du nôtre. En ce sens, le point culminant du roman est sa fin, qui se fait réellement – au sens étymologique – apocalypse, c’est-à-dire révélation, et ce n’est pas la page finale, celle des remerciements, avec laquelle joue l’écrivain en en faisant une indigeste litanie de noms digne des généalogies de l’Ancien Testament ou du Catalogue des vaisseaux de l’Iliade, qui désamorcera la puissance d’un récit assurément en prise avec le contemporain et ses enjeux politiques autant qu’esthétiques. En lisant Insula, nous nous retrouvons ainsi, non pas sur un unique espace isolé – et pour cause, tant la tentation de robinsonnade induite par le titre peut caractériser un nombre important de personnages du roman –, mais plutôt au sein de plusieurs strates de réalités comme de virtualités.












