Philip K. Dick dans la collection « Quarto », aux côtés de Melville ou de Dickens, c’est à coup sûr une reconnaissance pour celui qui, de son vivant, fut l’archétype de l’écrivain marginal, confiné à un sous-genre alimentaire. Une consécration aussi pour la science-fiction, par conséquent, reconnue comme littérature à part entière. Lire ces Nouvelles complètes dans leur continuité permet de vérifier l’importance de l’œuvre de Dick, tout en mesurant combien les moyens littéraires mobilisés, dans leurs limites apparentes, sont en adéquation avec un réalisme perverti. Déformé jusqu’au vertige pour rendre compte de l’emprise humaine sur la planète – ce qu’on appelle aujourd’hui l’Anthropocène.
Philip K. Dick, Nouvelles complètes I (1947-1953) et II (1954-1981). Trad. de l’anglais (États-Unis) par Guy Abadia, Marcel Battin, Pierre Billon, Hélène Collon, Michel Demuth, Michel Deutsch, Alain Dorémieux, Pierre-Paul Durastanti, Daphné Halin, Denise Hersant, Emmanuel Jouanne, Bruno Martin, Jacques Parsons, Jean-Pierre Pugi, Bernard Raison, Christine Renard, Pierre K. Rey, Suzanne Rondard, Mary Rosenthal, Marcel Thaon, France-Marie Watkins, Ben et Christine Zimet. Trad. révisées et harmonisées par Hélène Collon. Gallimard, coll. « Quarto », 2 vol., 1 280 p. et 1 184 p., 28 € et 27 €
Philip K. Dick voulait vivre de sa plume, ce qui justifie le déséquilibre chronologique : quatre-vingts nouvelles entre 1951 et 1955, jusqu’au déclin des magazines pulp auxquels il vendait ses histoires ; une petite quarantaine ensuite, à partir de sa bifurcation vers le roman. Certaines nouvelles apparaissent d’ailleurs comme des matrices des histoires longues à venir : la manipulation de l’information en temps de guerre dans « Les défenseurs » (1952) annonce La vérité avant-dernière (1964), la « semi-vie » de « Ce que disent les morts » (1963) sera développée dans Ubik (1969).

Philip K. Dick © The Estate of Philip K. Dick
Comme la nouvelle l’a conduit au roman, la science-fiction devait mener Dick à la littérature générale. Seulement, la porte est restée fermée : à l’exception des Confessions d’un barjo (1975), ses neuf romans mainstream ont tous été refusés jusqu’à sa mort, en 1982. À l’instar de ses personnages, Philip K. Dick pouvait se sentir coincé, avoir l’impression que le monde – littéraire – où il vivait n’était pas le vrai. Les apparences factices, le simulacre, sont l’idée-phare de son œuvre, aussi bien que de sa vision du monde, comme il l’exprime dans l’Exégèse, essai-journal mystique de huit mille pages, ou dans son fameux discours à la convention de science-fiction de Metz en 1977.
Le faux-semblant est déjà au cœur de la première nouvelle qu’il vend, « Roug », où un chien semble le seul à percevoir le secret inquiétant dissimulé derrière le ramassage des poubelles. La plupart des textes des années 1950 s’insèrent dans deux cadres : la banale vie des banlieues américaines et, dans un avenir proche, une société dévastée par la guerre totale. Les deux univers ne sont pas très différents : le conflit a réduit la Terre à un monde de cendres grisâtres et uniformes dont l’image revient obsessionnellement de nouvelle en nouvelle, concrétisant l’angoisse de la guerre nucléaire ; les banlieues dickiennes, peuplées de personnages middle class interchangeables, sous leur semblant de prospérité n’ont pas plus de singularité. « Petit déjeuner au crépuscule » relie les deux. Les allers-retours dans le temps de la maison des McLean montrent que la société d’abondance, sept ans plus tard, produira la ruine complète de la planète. D’autant qu’à l’époque de prospérité où commence la nouvelle, si elle n’est pas encore totale, la guerre « était déjà là ». Quand Philip K. Dick écrit ce texte, début 1953, la guerre de Corée n’est pas terminée.
La force de ces nouvelles tient à leur cohérence. Tout fait système, confirmant ce que l’intrigue dit explicitement. Les descriptions d’une Terre post-apocalyptique sont peu impressionnantes, à l’instar de l’écriture : rapides, efficaces, neutres, mornes. Mais c’est justement le propos. Les humains ont anéanti leur cadre de vie, en le rasant ils en ont éliminé toute aspérité. L’existence se réduit au combat, à la survie, à la production. « Tout est devenu si sérieux, si maussade. La vie n’a plus aucune couleur », constate, comme beaucoup d’autres, le protagoniste de « L’imposteur ». Oui, et c’est terrible, Philip K. Dick lui aussi est « sérieux ». Il expose le cul-de-sac de la société capitaliste – il s’affirmait marxiste – et plus profondément de l’humanité, grâce à un style utilitaire, behavioriste, sans fioritures.
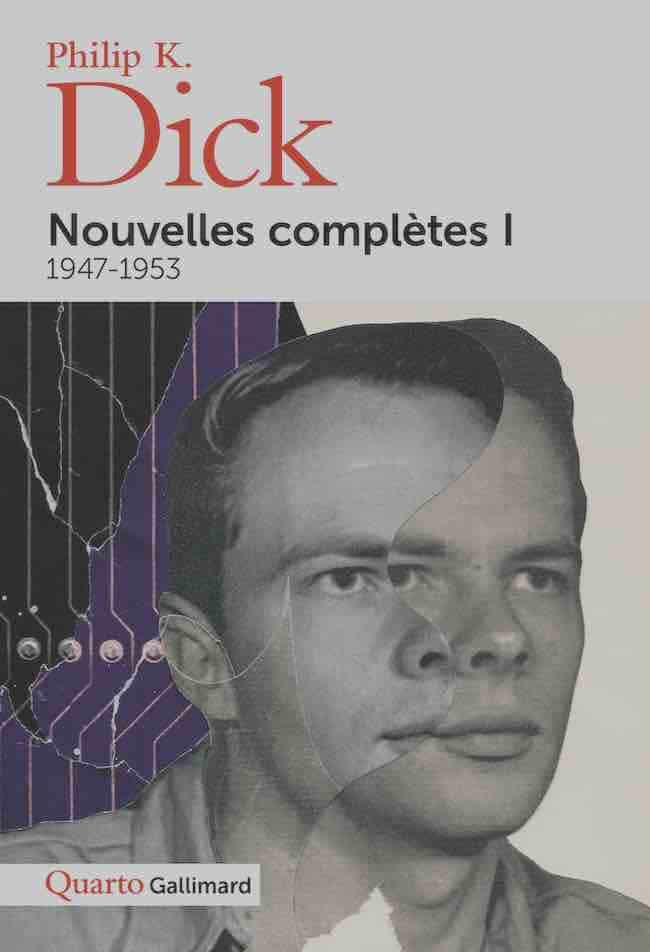
« Rajustement » montre que l’uniformité, l’absence de couleurs et de profondeur, est la vraie nature du monde. Parce qu’un « Appelant » – encore un chien qui n’est pas ce qu’il paraît, comme dans « Roug » – s’est rendormi, un employé d’agence immobilière en a un aperçu : tout ce qu’il touche, escalier, objets, êtres, s’effrite « dans un nuage de poussière grise ». Les personnages de Philip K. Dick manquent de consistance car leur apparence est de toute façon mensongère. Pour diverses raisons, les enveloppes humaines du « Père truqué », de « L’imposteur », de « Nouveau modèle », du « Retour des explorateurs » et du « Banlieusard » se révèlent n’être que des simulacres. L’anormalité ne tient pas au cadavre pendu en pleine ville de « L’inconnu du réverbère », mais à tous les autres personnages, qui défilent à ses pieds, indifférents. La seule vérité réside dans leurs doutes, leur sentiment d’échec, leur désarroi absolu.
« Le constructeur » ne comprend aucun élément de science-fiction, prouvant bien que la fausseté s’étend à tout le quotidien. Soumis aux récriminations de sa femme, aux critiques de son fils aîné, aux moqueries de ses voisins, isolé parmi des collègues vulgaires et racistes, E. J. Elwood construit un grand bateau intransportable, dépourvu de mât et de moteur, sans trop savoir pourquoi. « Ce fut seulement lorsque les premières grosses gouttes de pluie noires commencèrent à s’écraser autour de lui qu’il comprit. » Cette nouvelle remarquable exprime nûment une angoisse latente, sans cause identifiée. Elle se retrouve dans la libre adaptation, non moins réussie, de Jeff Nichols, Take Shelter (2011).
Si elles ont des points communs, chacune des nouvelles repose sur une idée particulière ; certaines de ces idées sont à proprement parler géniales. Le plaisir de lecture réside là, dans la manière dont la réalité de carton-pâte craque sous la poussée obstinée de personnages armés de leur seule conviction intime : quand peu à peu, inexorablement, vacille notre sentiment de familiarité. La destruction de la chronologie est souvent le moyen utilisé pour remettre en cause la réalité. Un temps fluctuant étend la relativité et le doute à toutes les dimensions du monde. L’écriture, en apparence simple et neutre, sape d’autant plus la logique, et le langage qui la fonde. Jusqu’à l’égarement. Ainsi du cochon extraterrestre de « L’heure du wub », des conséquences de la grossesse d’un jouet dans « Au temps de poupée Pat », ou de l’existence – ou non – de « swibbles » dans « Visite d’entretien », et de « swabbles » dans « Rendez-vous hier matin ». Loin d’être absent, le sense of wonder chez Philip K. Dick se déploie souterrainement, en basse définition, jusqu’à ce que le lecteur déboussolé en vienne à se demander ce qu’il est vraiment en train de lire.
Un autre thème majeur est la surconsommation, explicitement liée à la guerre. Dans l’émouvante « Foster, vous êtes mort ! », un jeune garçon souffre d’exclusion sociale parce que son père n’a pas les moyens d’acheter un abri anti-atomique. Dans « Autofab », les humains rescapés n’arrivent pas à communiquer avec les usines automatisées qui les fournissent, épuisant les ressources de la planète par leur surproduction. Comme souvent, c’est l’absurde qui permet d’agir sur une réalité qui, au fond, l’est aussi : pour provoquer une réaction des machines, les hommes commencent par détruire leurs produits, puis inventent un mot : « – Et j’y note quoi ? – Ceci : le produit est complètement pizellé. – Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Perine, tout déconcerté. – Écris ! » Si l’absurde est un puissant levier comique, il signe en même temps le tragique : les humains n’y arriveront pas. À réparer leurs erreurs, à maîtriser leurs créations, à rattraper leurs gaspillages.

Profusion et prolifération tournent à la catastrophe, conséquence de la médiocrité de l’humanité. Les colons martiens de « Qui perd gagne » désirent tellement rouler des extraterrestres plus rusés qu’eux qu’ils se retrouvent dans un engrenage fatal, superlativement victimes de la société de consommation, obligés d’acheter pour survivre. Pourtant, Philip K. Dick arrive à rendre vraiment émouvante la déprime du chef de la colonie, Hoagland Rae. Ce spleen, ce sentiment d’échec frappe également d’autres personnages plus intenses que la moyenne : les vieilles femmes au seuil de la mort de « La planète impossible » et de « La dame aux biscuits », ou les deux solitaires de « Chaînes d’air, réseau d’éther », confrontés à la maladie, aux coûts et bénéfices de l’empathie.
Les textes tardifs explorent davantage les préoccupations spirituelles de plus en plus fortes de Philip K. Dick. Dans « La petite boîte noire », les adeptes d’un messie christique, Wilbur Mercer – qu’on retrouve dans le roman Blade Runner –, luttent contre le FBI. Dans « La foi de nos pères », au contraire, un « Bienfaiteur suprême » à la Big Brother se révèle être une entité terrifiante, un dieu mauvais, même l’oppression peut être fallacieuse. Quant au « Cas Rautavaara », il donne avec humour un point de vue extraterrestre sur la rédemption.
Si l’on peut estimer que la déstabilisation de la réalité va plus loin dans ses romans, que son classicisme apparent s’y révèle plus profondément baroque, cette nouvelle édition des nouvelles permet de mesurer combien la surface dickienne cache souvent une profondeur glaçante. De plus, bien que très marqués par leur époque, ces textes résonnent curieusement avec la nôtre. Le sentiment de n’avoir aucune influence sur la société, les oppressions « molles », l’injonction à consommer, le pouvoir d’une caste économique, les contraintes imposées au nom d’une situation exceptionnelle, la destruction annoncée de la nature, mettent à la bouche du lecteur de 2020 un goût de cendres. Le XXe siècle de Philip K. Dick – ses nouvelles se déroulent en général quelques décennies dans l’avenir – nous a faits. L’intuition de se débattre dans un monde creux, où les mauvais démiurges commandent, où on fait du surplace tout en fonçant vers la catastrophe annoncée, caractérise ses personnages. Et nous-mêmes ?












