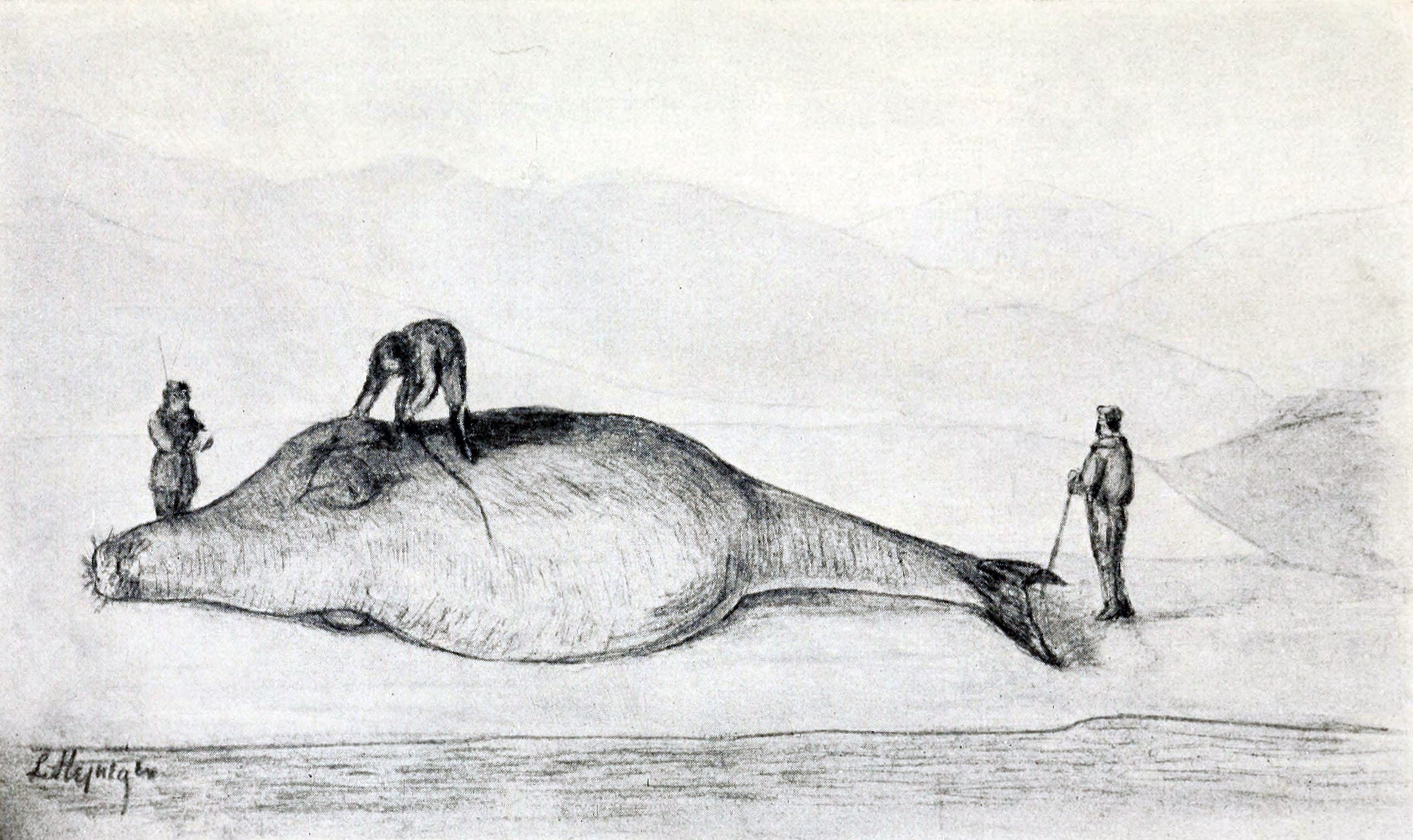Conjuguant Plutarque et Deux ans de vacances, La guerre des boutons et Cormac McCarthy, Matara, du Finlandais Matias Riikonen, s’impose immédiatement comme une forme de classique, à la fois intemporel et très actuel. Abreuvée à plusieurs sources troubles, la fiction y galvanise la force de la nostalgie, l’incertain passage de l’enfance à l’adolescence, le bonheur offert par la nature, ainsi qu’une réflexion sur la violence et la création collectives, laissant la lectrice et le lecteur libres de les étendre au monde contemporain.
Les cinq parties du roman commencent ainsi : « Le pas s’enfonça dans le sol, l’extérieur de l’avant-pied en premier, puis l’intérieur et le talon […] et le pas s’éleva. Il fit une courbe surpassant [un élément de la nature] ». Deux frères « furtivent » dans la forêt. Ils sont éclaireurs. De pessière en boulaie, ils suivent des sentes cachées, remontent un ruisseau dans un tunnel d’aulnes, marchent sur des pieux dissimulés à la surface d’un étang, se tapissent au milieu des épines, écoutent les pouillots fitis ou les troglodytes mignons. La nature envahit complètement le lecteur grâce à la précision de l’écriture, justifiée par l’extrême attention des frères. Car la forêt recèle du danger. Des Germains redoutés. On y risque la mort. Pire, la torture.
Pendant un long été d’une époque indéterminée, les garçons d’un centre de vacances, livrés à eux-mêmes toute la journée, inventent une cité dans la forêt. D’année en année, Matara se transmet. Les plus jeunes l’intègrent à mesure que les plus âgés, à quinze ans révolus, disparaissent. La ville est constituée de cabanes accrochées à une falaise, que surmontent un théâtre, un forum, un terrain d’exercices, d’autres cabanes. À ses pieds, des thermes, une scierie, des temples. Deux consuls dirigent la cité, un sénat les surveille et fait les lois ; un Augure en conserve la mémoire. Tout se vend et s’achète en deniers de plastique. Celui qui n’a pas de quoi régler ses impôts va aux travaux forcés.
Un jeu ? Pas vraiment, tant les garçons le prennent au sérieux. La mort est crainte pour de bon, car ceux qui sont tués ne peuvent participer pour la durée de l’été. Ils devront attendre l’année suivante pour rejoindre un autre peuple. Chacun a son territoire, connu ou inconnu ; et tous respectent les règles. Les Gaulois réduits en esclavage reviennent jour après jour couper des arbres sous les verges ; celui dont on a cassé bras et jambes reste immobile.
La lectrice découvre tout cela peu à peu, en suivant le Grand Frère et le Petit Frère. D’abord dans la chaleur de la forêt, puis le soir au sein de la cité constellée de feux et de lanternes. On comprend qu’il y a une part de jeu, mais pas tout de suite sa proportion ni qui en sont exactement les acteurs. On est constamment dans un entre-deux, où la séparation entre fiction et réalité perd son sens. Tout en ayant conscience que c’est une fiction, le lecteur, par le talent de Matias Riikonen, se retrouve lui aussi plongé dans Matara. Pour les garçons, la cité est bien plus réelle que le reste du monde, à peine évoqué : « Certains garçons se trouvaient eux-mêmes seulement une fois ici, et il arrivait, au fil des étés, que leur être se change en l’opposé de ce qu’il était à leur arrivée ». Comme le dit Kaius, consul : « C’est notre seul vrai pays, et quand on nous renverra d’ici un jour, notre cœur y restera. Nos noms sur l’arbre sec. Nous n’avons rien à attendre du monde à venir, on n’a pas le droit d’en parler, mais vous savez bien qu’après tous ces étés, en comparaison, ce monde-là ne vaudra rien ».

Et ce cadre mi-onirique, mi-terriblement réel, tant le romancier arrive à exprimer la tension dramatique qui habite les garçons, entre peur d’un danger qui surgirait des arbres et intrigues de pouvoir dans la cité, ce cadre a quelque chose d’enchanté. Qui a joué aux gendarmes et aux voleurs ou combattu des démons dans une forêt, qui a vraiment été un enfant – avant la lobotomisation numérique de masse – ou a joué des rôles, comprendra pourquoi ce que réussit Matias Riikonen est précieux.
Mais Matara a d’autres dimensions. La tension sexuelle qui habite des adolescents de quatorze ou quinze ans n’est jamais explicite, mais s’inscrit comme une toile de fond. Elle se manifeste notamment à travers les « poupées » qu’ils s’échangent. C’est par ce genre d’éléments, à l’intersection de l’enfance et du sexe, que Matias Riikonen fait passer d’étranges évocations, d’autant plus fortes qu’elles ne sont qu’à moitié formulées.
Le jeu en groupe pris au sérieux révèle des rapports de pouvoir, de brutalité et d’oppression. Bien que Matara interdise la guerre d’agression, Kaius emmène ses soldats attaquer des Gaulois plutôt pacifiques. En les ramenant prisonniers à la cité, il instaure l’esclavage, bouscule les équilibres, libère les instincts. Ce que le Grand Frère voit dans le camp des Germains, qui provoque les hurlements d’« une voix douloureuse et angoissée », il refuse de le dire au Petit Frère. Le rythme et l’ampleur de la violence accélèrent, « comme si l’envie de meurtre était une maladie qui, à la faveur du sang versé, aurait infecté jusqu’à l’Augure », le plus gentil des garçons.
L’été qui avance aura forcément une fin. Ce terme douloureux, puisqu’il signifie la perte de Matara, au moins pour un hiver, mime la sortie de l’enfance. Kaius, charismatique et bizarre, à la fois le plus attaché à Matara et le plus désireux de la déséquilibrer, incarne ces questionnements, ces bouillonnements adolescents. « De nobis fabula narratur » : l’histoire du roman en raconte bien d’autres.
Le camp des Germains suscite un peu la même terreur que la maison des cannibales dans La route, le Petit Frère racontant son histoire à un Parthe dans la solitude du bord de mer fait penser à de nombreux récits de Cormac McCarthy. Dans les pérégrinations dans la nature, dans l’acuité de l’expression de la peur accompagnant les déplacements, on retrouve quelque chose de son écriture : la coïncidence d’une très forte présence du monde et de la conscience de sa perte inexorable, un monde d’autant plus regrettable qu’il est extrêmement là. C’est un peu atténué dans Matara, puisqu’il ne s’agit tout de même que d’un jeu, mais, alors qu’en général dans la littérature l’intensité du présent et sa nostalgie se succèdent, McCarthy et Riikonen arrivent à les faire coexister.
À un autre niveau, l’histoire d’un dictateur qui entraîne avec lui sa civilisation vers son déclin, les arbres coupés pour de grands travaux dont la principale fonction est d’enrichir le « propriétaire » des arbres, peuvent nous rappeler quelques éléments du réel.
Dernier décalage, dernier brouillage qui inscrit Matara dans l’esprit de la lectrice comme on grave la pierre, on comprend progressivement que l’intrigue répète une trame préexistante, mais on ne sait jamais si les garçons le font à dessein, ou même s’ils en sont conscients. On a plutôt l’impression que l’histoire se répète comme une fatalité, retour de ce qui forcément doit se défaire. Si tout finit et passe à autre chose, alors, il est d’autant plus essentiel de pouvoir « conter son histoire telle qu’elle avait vraiment été », ce que fait avec une justesse et une intensité rares Matias Riikonen, superbement traduit par Claire Saint-Germain.