À près de quatre-vingt-dix ans, seize ans après son dernier livre, Cormac McCarthy publie deux romans liés, Le passager et Stella Maris (disponible en France le 5 mai 2023). Composé surtout de discussions dans les bars et restaurants de La Nouvelle-Orléans, suivant des fils narratifs qui restent parfois sans résolution, Le passager peut surprendre. Mais c’est un roman incroyablement riche, ample, qui inscrit dans le quotidien les grands fantômes américains – la bombe atomique, la guerre du Vietnam, l’assassinat de Kennedy, le complot, le rapport à l’errance… – pour exprimer le tragique et la mélancolie de la condition humaine. L’œuvre d’un des plus grands écrivains contemporains, alliant hauteur de vue et faculté de toucher au cœur.
Cormac McCarthy, Le passager. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Serge Chauvin. L’Olivier, 544 p., 24,50 €
Bobby Western a eu plusieurs vies et métiers. Physicien doué, il n’a jamais achevé ses études. Il a fait de la course automobile en Europe, puis, quand le roman commence, il est plongeur de récupération en Louisiane. Comme d’autres héros mccarthyens, Bobby flotte, trimbalant une tristesse qui l’empêche d’être véritablement présent à son existence. Au fil du roman, il interroge les causes profondes de cette mélancolie. Ou peut-être qu’il s’applique à éviter de les regarder en face. Le génie elliptique de McCarthy laisse coexister les deux possibilités.
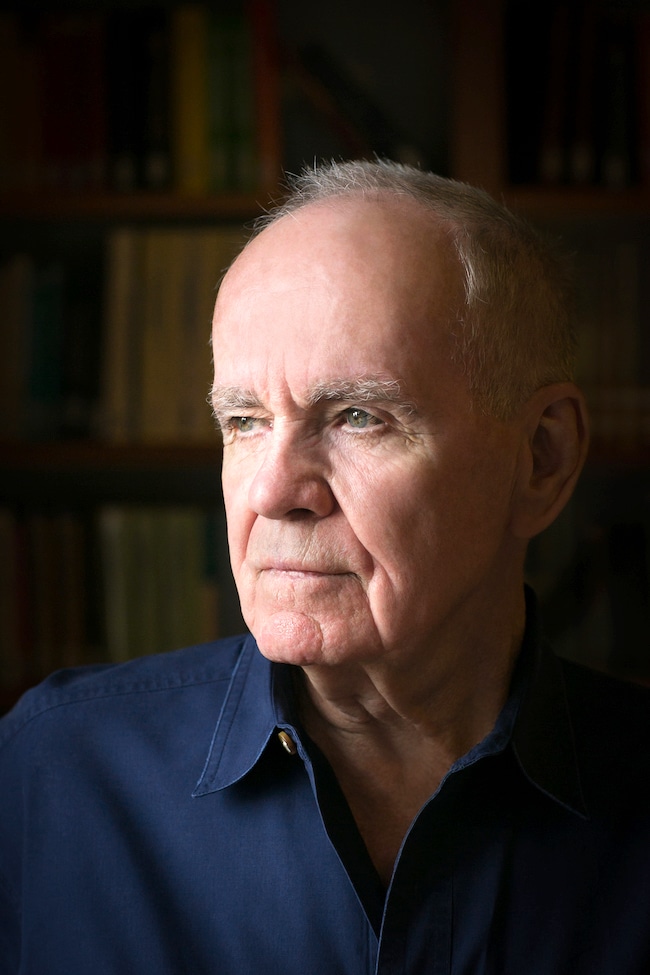
Cormac McCarthy © Beowulf Sheehan
Son ami l’arnaqueur John Sheddan ou le détective Kline, ancien diseur de bonne aventure, essaient de cerner son problème lors de déjeuners aussi gastronomiques que maïeutiques. Arnaud’s ou Mosca’s, propriété du parrain mafieux Carlos Marcello, réputé être l’instigateur de l’attentat contre Kennedy, deviennent presque des personnages du roman, tant ils prennent de densité. Non par les descriptions des lieux, très allusives, mais par les dialogues qui y prennent place, évocateurs, laconiques, jubilatoires par l’art de la parole qu’ils mettent en scène.
Ce qui ne va pas chez Bobby Western est apparemment très clair : « Il est amoureux de sa sœur et elle est morte ». Chaque chapitre s’ouvre sur un passage dans lequel Alicia dialogue avec ses hallucinations, en particulier le Thalimonide Kid, du nom d’un médicament responsable de malformations dans les années 1960. Schizophrène paranoïde, Alicia finit par se faire interner dans l’hôpital psychiatrique de Stella Maris où elle met fin à ses jours. Le roman s’ouvre sur la vision de son corps dans la forêt du Wisconsin. Depuis, Bobby est en deuil, et plus que ça. « Il y a quelque chose dans la vie que tu as abjuré, Messire », lui dit John Sheddan. Inutile de sortir les parapluies politiquement corrects : cet amour incestueux entre deux adultes était réciproque, platonique et Le passager n’est pas un roman réaliste.
Les précédents livres de McCarthy s’inscrivaient dans les genres pour les dépasser par une métaphysique très personnelle, une écriture à la fois concise et baroque et une représentation mythique de la nature et des êtres. Sans appartenir à un genre précis, Le passager puise dans les fictions américaines, y compris dans celles de l’auteur. Bobby se trouve passer sur une route qui a subi un incendie. Dans une scène saisissante, il y dépèce et mange une biche brûlée. La cendre, la situation de survie d’un personnage errant, font évidemment écho à La route.
Mais c’est à Suttree, le plus autobiographique et peut-être le meilleur roman de McCarthy, que fait le plus penser Le passager. Comme leur auteur, Bobby Western et Cornelius Suttree sont originaires de Knoxville, où Western retourne voir sa grand-mère. Ils partagent la même dépression taciturne et existentielle, qui paraît plus liée à un héritage civilisationnel qu’à leurs personnes. Suttree se révoltait contre le catholicisme et la figure de son père. Celui de Bobby est maudit, car il a travaillé sur la bombe atomique. Comme il a rencontré sa femme à l’usine de séparation de l’uranium d’Oak Ridge, à côté de Knoxville. Bobby et Alicia sont d’une certaine manière des enfants de l’atome. La bombe les hante tous les deux.
Oak Ridge concentre de nombreux péchés de l’Amérique : l’arme nucléaire et la dissimulation, le mensonge, puisque, en 1943, l’usine et une ville de 75 000 habitants furent construites secrètement au milieu des bois. Elles attentèrent à l’environnement et aux hommes puisque l’édification d’Oak Ridge engloutit au fond d’un lac la maison bâtie de leurs mains par le trisaïeul et l’arrière-grand-oncle du héros. S’y ajoute le crime social puisque McCarthy rappelle que dans cette usine les ouvrières n’avaient pas le droit de parler. À plusieurs reprises, il est discrètement souligné que la société dans laquelle évolue le protagoniste malmène les travailleurs et les bêtes. La mélancolie de Bobby « Western », c’est celle de l’homme occidental, née d’« Auschwitz et d’Hiroshima, les deux catastrophes jumelles qui avaient scellé à jamais le destin de l’Occident ». Si la guerre du Vietnam est évoquée, comme l’assassinat de Kennedy, c’est qu’il s’agit d’autres désastres de l’Amérique, cet hyper-Occident.

La Nouvelle-Orléans (2011) © Jean-Luc Bertini
La malédiction du secret court tout le long du Passager. Au début du roman, Bobby explore un avion englouti contenant neuf cadavres. Il manque la boîte noire et un passager. Des policiers lui rendent visite, mais les médias ne parlent pas de l’accident. Sa chambre est fouillée à plusieurs reprises. Le fisc saisit son compte en banque et sa Maserati, son seul bien de valeur. Son collègue Oiler meurt au Venezuela. Bobby fuit.
La Nouvelle-Orléans, dans les fictions américaines, n’est pas un centre mais un lieu subtilement décalé où on peut souffler ou s’agiter, retarder l’échéance en attendant de repartir se perdre ailleurs. Bobby bouge, mais il ne fait que tourner en rond dans l’Amérique intérieure, entre la Louisiane, Knoxville, l’Idaho et le Wisconsin de Stella Maris. McCarthy raconte comme personne la solitude, le vagabondage, l’enfouissement en soi-même d’un personnage blessé, que ce soit dans une ferme de l’Idaho par – 30° C, dans une cabane du golfe du Mexique ou un moulin à Formentera.
Cependant, le héros lui-même n’est pas innocent. Il n’a rien dit à personne des traces d’un plongeur ayant quitté l’avion. Enfant, lorsqu’il avait trouvé l’épave d’un autre avion dans la forêt, le pilote mort aux commandes, il avait déjà gardé le silence. L’argent de la Maserati provient d’un trésor enterré dont l’origine reste inconnue. Ces énigmes ne seront pas élucidées, pas plus qu’un cambriolage qui a fait disparaître les papiers personnels du père des héros. L’opacité est la nature du monde. Plus que l’inceste, plus que la folie, c’est bien ce qui semble motiver le désespoir d’Alicia, et par contrecoup la tristesse de Bobby. Mathématicienne, encore plus brillante que son frère, qui n’a choisi la physique que, parce qu’en parlant avec sa sœur, « il avait entraperçu le cœur profond du nombre et il savait que ce monde lui resterait à jamais fermé », Alicia ne va pas à l’université, n’écrit rien : elle n’en a pas besoin pour faire des mathématiques.
Le passager offre des pages passionnantes sur les tâtonnements de la physique quantique, sur la différence entre mathématiques et physique, sur ce qui fait un chercheur vraiment fort : « Il faut avoir les couilles d’oser démanteler la structure existante ». Mais ces discussions se justifient surtout par l’obsession de savoir si la science peut expliquer le monde. Et la réponse est qu’elle ne peut en donner qu’« une image ». Alicia explique au Thalidomide Kid : « Une fois qu’une hypothèse mathématique est formalisée en une théorie, elle a peut-être un certain panache mais à de rares exceptions près on ne peut plus nourrir l’illusion qu’elle offre un réel aperçu du cœur de la réalité. À vrai dire, elle n’apparaît plus que comme un outil ». « L’idée lutte toujours contre sa concrétisation », pense-t-elle. Une fois formulée, elle est perdue. « Toute réalité est perte et toute perte est éternelle », conclut John Sheddan dans une magnifique lettre testamentaire. Ainsi, le monde reste aussi obscur que le Mississippi au fond duquel plonge Bobby, où même les lampes ne servent à rien.

Dans le Tennessee (2011) © Jean-Luc Bertini
On est tenté de penser que Cormac McCarthy étend le jugement sur la science à la littérature. Plusieurs passages précis et techniques concernent la plongée, le renflouement d’épaves, les dragsters, la façon de remettre en marche une voiture qui ne roule pas souvent, mais ils décrivent. Ils n’expliquent pas. D’où le tragique. Doux-amer ici, car Le passager est plus apaisé que les autres livres de McCarthy, et tempéré par un humour pince-sans-rire : « Je pensais que ça serait marrant de voir un mec se renseigner sur la santé mentale de sa sœur auprès d’une hallucination de ladite sœur ». Même si sa douleur d’avoir perdu Alicia imprègne tout le livre, Bobby finit par conquérir une forme de sérénité. À l’instar de Cornelius Suttree, il s’arrache à l’espace de son aliénation, Knoxville dans Suttree, l’Amérique dans Le passager.
Mais la condition humaine reste tragique, comme le proclame la plus belle image du roman : Alicia interprétant pour son frère seul le rôle de Médée dans le théâtre naturel d’une carrière, éclairée parmi les arbres par « des boîtes de conserve bourrées de chiffons imprégnés d’essence ». Comme Bobby, on reste hanté par cette vision et par bien d’autres, comme Alicia s’excusant auprès des « hortes » – les membres de sa co-horte d’hallucinations – « cautérisés dans leurs haillons noircis et calcinés », furieux, après une séance d’électrochocs, tel le héros ne sachant pas comment aider un mulet attaqué par des guêpes, ou protégeant des passereaux trop épuisés par leur migration pour bouger : « Toute la nuit il arpentait la plage avec sa lampe torche pour repousser les prédateurs et à l’approche de l’aube il s’endormait dans le sable avec les oiseaux. Afin que nul ne trouble ces passagers ».
Le passager devrait être désespéré. Cependant, comme les autres livres de McCarthy, il procure une sérénité et une joie mystérieuses. C’est le roman d’une humanité sans dieux ni direction, et pourtant capable de lucidité et d’amour.












