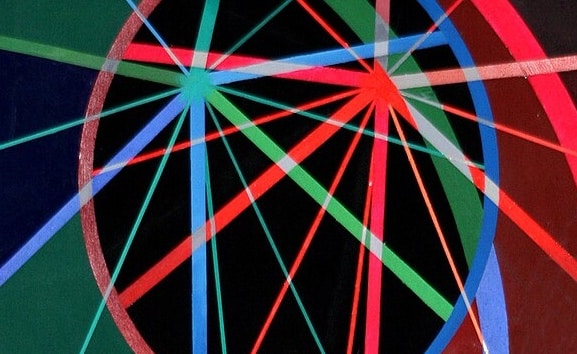On retrouve dans Il n’y a pas de place pour la mort la plupart des thèmes habituels de Pascal Quignard, on pourrait même dire ses obsessions, ses dérives d’écriture autant que ses ruptures, ses formules comme des jets de lumière, ses affinités littéraires, ses amitiés ou ses amours, mais resserrés et fracturés, ce qui en quelque sorte les réactive, s’il en était besoin, ou en tout cas les pare d’un éclat, d’une force nouvelle.
Avec le narrateur, ou plutôt à la suite d’un de ceux ou de celles qui disent « je », on s’introduit dans le couloir d’une maison, et on arrive à une vieille dame qui est en train d’écrire. Si ce tout premier texte nous surprend, c’est qu’il est rédigé avec une précision dans le détail qui nous fait presque croire qu’on est chez un auteur comme Nathalie Sarraute ou Alain Robbe-Grillet ! Et puis Pascal Quignard paraît tourner casaque et nous voilà tombés dans un rêve ou un conte fantastique, dans lequel le conteur est à la fois un enfant et un adulte, la femme une étrangère, une amante et une mère.
Le lecteur néanmoins continue son chemin, vaille que vaille, il finira bien par découvrir le sens de cette histoire ; or elle demeure obscure, l’homme-enfant s’est enfui de la drôle de maison, comme autrefois de celle de ses parents, comme, par la suite, de celle d’une amoureuse, pour enfin échouer dans un square, sur un banc où son nom est inscrit. Mais alors, se déclare à lui-même le lecteur, ce qui m’apparaissait de prime abord sans relation était en fait très orchestré. Puis il s’apercevra que c’est aussi le cas de l’ensemble du livre. Il fallait, pour cela, pour comprendre le tout, passer par une porte étroite, celle de la subversion ou du renversement, comme de la destruction ou de la séduction, qui en latin peut signifier aussi la « ruine des âmes » – un des motifs du livre.
Si l’on prend pour exemple un chapitre du livre, disons le quatrième, dans la deuxième partie, on constate qu’en effet la construction en est précise, mais plutôt à l’instar du nuage qui passe tout en se transformant dans l’immobilité (ce qui, curieusement n’est pas le cas du titre, très ou trop explicite). C’est que cette précision n’est pas à ras du sol, elle provient davantage des glissements, correspondances, entre les mots et les idées que de l’enchaînement des causes et des effets. Jugeons-en. Le narrateur est dans un train. Il écoute les propos des autres voyageurs. Aux questions qu’ils se posent, il répond pour lui-même et en vient à l’image de la toile d’araignée. Qui le mène aux filets qu’on posait autrefois au travers de la Seine pour arrêter les suicidés qui s’en allaient au fil de l’eau. Lui vient le souvenir d’un dragon de vingt ans ramené mort sur la berge. De deux adolescents qui se touchent longuement sur la colline de Gravelines et face à l’océan – le sexe, chez Quignard, étant proche de la mort. Du cahier neuf que l’écolier doit entamer avec son nom, avec le chiffre de sa classe. De la grosse tache d’encre qui clôt le rituel.
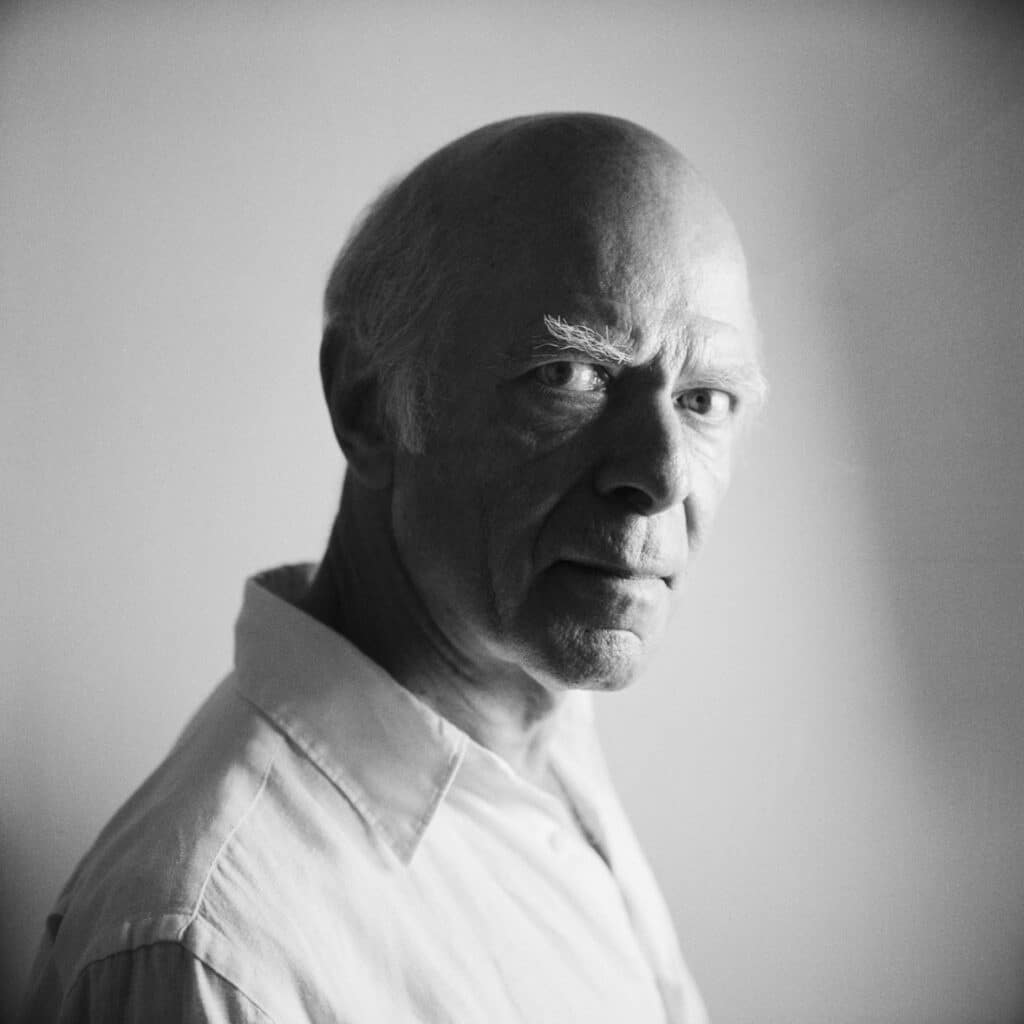
Au chapitre suivant, l’attraction par les mots se poursuit. La goutte d’encre induit la pluie, qu’on nomme aussi virga quand elle ne parvient pas au sol, qu’elle hésite au-dessus des tombeaux, comme la larme sombre a hésité en bout de plume ; des grands cyprès des cimetières ; du mausolée où l’on s’assoit pour approcher la mort ; de la petite chambre, pareille à une crypte, où ses parents s’unirent, sur le bord de la Loire, afin qu’il vînt au monde.
« Comment reconnaît-on les fantômes ? Ce n’est pas difficile, ils chancellent. »
À trop les espérer, on finit par s’y perdre et par les imiter. Le narrateur, comme eux, s’emploie à disparaître, comme eux, s’évanouit. Il s’absente à lui-même, n’abandonnant aux autres qu’un corps sans connaissance. « Quelque chose s’effondre dans le corps sans prévenir dans l’enfance, dans la surprise, dans les larmes – comme l’éjaculation des années plus tard au moment où elle ouvre à ce surprenant état qu’on nomme la volupté. »
Extase décrite par sainte Thérèse d’Avila, « qui arrache au présent et à l’histoire et qui exige à la fois et du corps et de la conscience, et même du désir, un total abandon », celui du moine Bashô au bord du Pacifique, connaissant « le bonheur de l’adieu, marchant dans la nature, longeant la si faible faille, entrant dans l’origine ». Ici, la construction du roman épouse le récit : la faille dans laquelle s’introduit la mort correspond à la rupture, rencontrée dans les premières pages. Le narrateur devient la narratrice d’un épisode qui s’interrompt :
« Elle s’avança.
Elle prit le colis sur le buffet.
Elle le posa sur la table de la ferme.
Elle l’ouvrit : c’était sublime. »
Quoi ? L’auteur ne le révèle pas. Et le lecteur demeure, les yeux écarquillés, essayant de percer le mystère du colis apporté par une femme en tracteur et de l’identité de celle qui le reçoit. Nous savons seulement qu’elle garde le souvenir du personnage de Catherine, qui, dans Les Hauts de Hurlevent, « arrachait les plumes de son oreiller en nommant les oiseaux », juste avant de mourir d’amour.
Le roman est construit en miroir. Aux quelques dernières pages, le narrateur retrouve, par un autre chemin, la dame âgée des premières pages : « Elle était assise sur une des chaises à haut dossier en train d’écrire. » Cette dame a un secret, celui de son amour qu’elle veut garder en elle pour qu’il demeure entier. « Tels sont les livres. Elle voulait profiter de tout ce qui se poursuivrait en elle du résidu de son chagrin. Elle vénérait jusqu’au détritus de son chagrin sur la page. » On peut le constater, la construction du livre (qu’une table des matières aurait permis de suivre plus facilement) est très élaborée. Même si, comme c’est possible, elle est aisée et spontanée.
Qui sont donc ceux ou celles qui s’expriment ici, par la parole ou par l’écrit ? Des hommes ? des femmes ? des êtres fictifs ? des morts célèbres ? « Il n’y a pas de sens à nos vies tant elles tournent sur elles-mêmes. » Vers la fin du livre, Pascal Quignard nous donne à voir un spectacle émouvant qui fait figure de métaphore : celui d’un chien fidèle, posté devant la porte de sa maîtresse absente, à jamais disparue, pour attendre le rien qui n’arrivera pas.