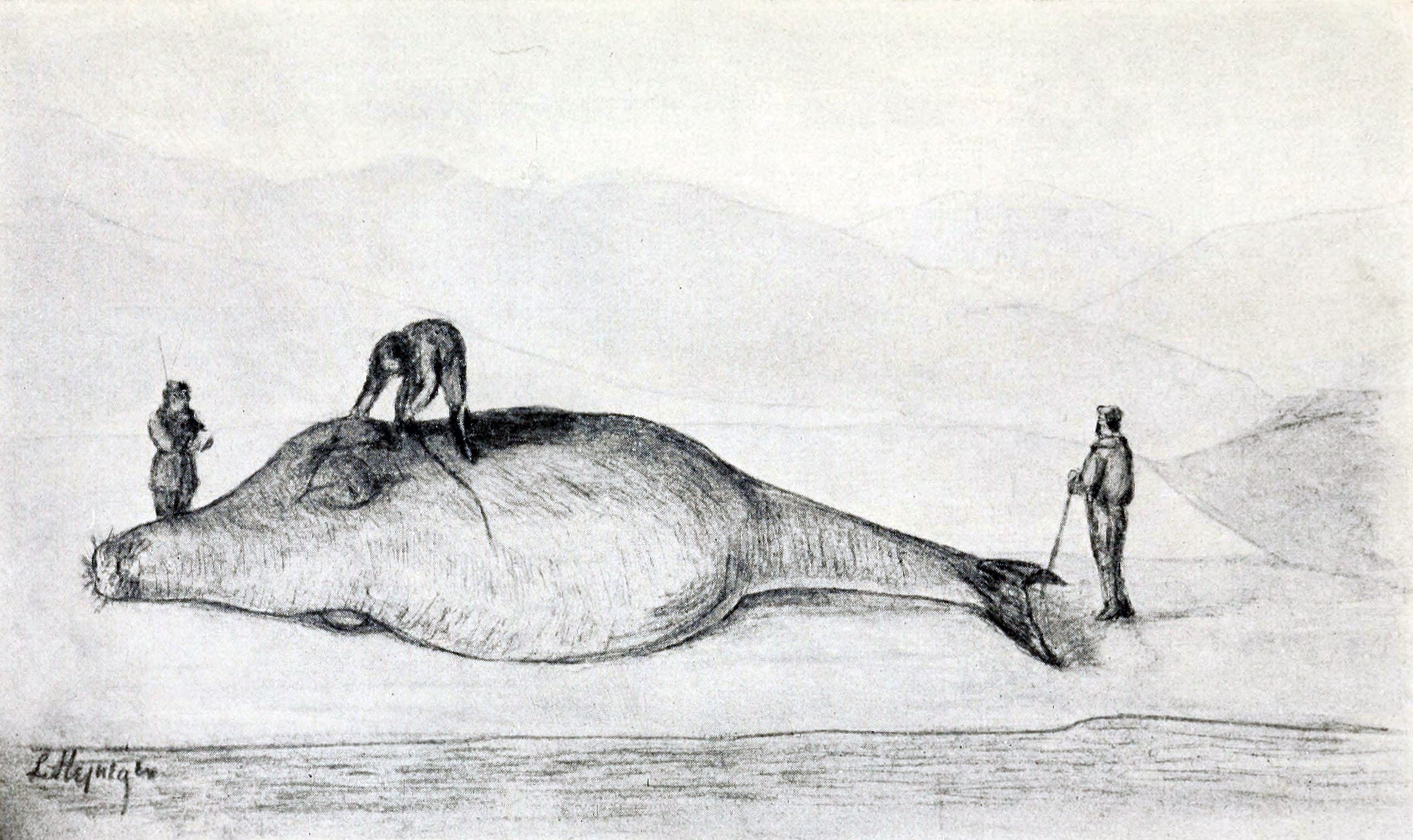S’écartant de tout pathétique de mauvais aloi, Le petit de l’Espagnol Fernando Aramburu va droit au cœur d’une catastrophe survenue au Pays basque pour en tirer une bouleversante histoire intime de deuil et de résilience.
D’une catastrophe locale, de celles que les gros titres des quotidiens s’empressent de nommer « tragédies », leur ôtant par là même leur essence tragique, Le petit, bref roman du Basque Fernando Aramburu, tire une histoire aussi exemplaire qu’universelle. Par la grâce de sa pudique approche de l’intime, par le subtil agencement de son récit, il restitue son sens et son pouvoir au seul usage du pathétique – le plus discret qui soit – que supporte la tragédie.
Le jeudi 23 octobre 1980, une explosion de gaz détruisait une école primaire d’Ortuella, dans la province de Biscaye, causant la mort de trois adultes et de cinquante enfants de cinq à six ans. Plus de quarante ans se sont écoulés avant que Fernando Aramburu ne prenne en charge, car telle est l’expression qui s’impose, le traumatisme de cet accident, en faisant de littérature mémoire. Dans l’œuvre de l’auteur du volumineux et magistral Patria (Actes Sud, 2018) qui rouvre et panse les blessures du Pays basque après la fin de de la lutte armée de l’ETA, Le petit est le quatrième titre d’une série plus modeste de romans et de recueils de nouvelles intitulée Gentes vascas (« Gens du Pays basque »).
Y sont retracées, écartant tout nationalisme avec une ferme douceur, les vies minuscules d’habitants de la région – et non pas de seuls Basques d’origine. Le petit honore à souhait ces principes éthiques : ses héros, le grand-père et les parents du petit Nuco, mort dans l’explosion de l’école, appartiennent à deux familles de travailleurs immigrés, l’une venant d’Estrémadure, l’autre de Galice et de Castille-et-León. De la langue basque, ils ne manient que les mots les plus affectifs, ceux, aussi, qui les ancrent le plus dans cette culture : José Miguel, le père de Nuco, appelle tendrement Maitia (bien-aimée) sa femme, Mariaje, et se dit fièrement l’Aita (papa) du petit. Les hommes appartiennent très physiquement à leur terre d’accueil par leur travail d’ouvriers des mines ou de la métallurgie.
C’est avec d’infinies précautions, de respectueux ménagements envers ses personnages qu’entre faits et habile fiction, censément fondée sur le témoignage de Mariaje, le récit narre l’expérience subjective de la catastrophe elle-même et trouve une juste expression à la terrible douleur des endeuillés. Non content de se distancier ainsi du traitement médiatique qu’avaient naguère reçu les faits, il pousse le scrupule et l’ingéniosité jusqu’à recourir à l’insertion de passages en italique où, par un tour métalittéraire, le texte prend la parole. Il s’y commente lui-même et adresse au passage quelques remarques, souvent critiques, plus rarement élogieuses, à son auteur, selon les choix que celui-ci aurait faits pour éviter l’indécence du mélodrame ou de la complaisance compassionnelle. Il apporte quelques subreptices compléments d’informations à l’intrigue et se soucie encore, non sans cocasserie, de sa future réception, formulant l’humble vœu « d’avoir du sens », de « laisser une égratignure dans une conscience ». Que lui répondre, si ce n’est qu’il en laisse à coup sûr plus d’une, et que parler d’« égratignure », c’est tomber dans la fausse modestie ? Enfin, on ne saurait être toujours parfait.

À l’orée du récit, voici donc – à tout seigneur, tout honneur – le grand-père, Nicasio, gravissant, essoufflé, les rues pentues d’Ortuella vers le cimetière pour rendre visite à Nuco, enfermé dans une niche du columbarium aux côtés des autres « petits anges » victimes de l’explosion. Leur muette présence gêne pourtant le vieil homme, qui entend parler au petit dans la plus grande intimité, les lèvres collées à la vitre qui protège la dalle funéraire verticale. Sans parler de ces importuns que sont leurs parents endeuillés, tout à leurs propos sur la pluie et le beau temps pour conjurer leur douleur. Nicasio les évite. Lui, il camperait le long du mur d’enceinte si sa fille Mariaje le laissait faire. Et, soudain, dans le fragment suivant, l’extraordinaire fécondité de son imagination souffle à Nicasio une version édulcorée de la situation des défunts, qu’il prête à des badauds : passagers d’un avion piloté par une institutrice tandis que la cuisinière de l’école joue les hôtesses de l’air, les enfants morts se perdent dans les nuages. Ah, mais, Nuco, lui, n’est pas monté dans cet avion, s’avise-t-il. Et d’exiger de Mariaje qu’elle n’ajoute pas foi aux racontars de leurs voisins.
Plus encore que son indulgente fille, le récit entre dans la surenchère de ressources créatives, en pensées, en paroles et en actes, qui étayent le déni du vieil homme. Car la perception qu’a Nicasio de la réalité se ramifie : tantôt il se rend au cimetière auprès du petit, tantôt il croit accompagner Nuco chaque matin à l’école d’une localité proche et fait de longues et fort bavardes promenades avec lui dans les rues d’Ortuella, le tenant fermement par la main. Quelques mois plus tard, José Miguel et Mariaje ayant décidé de se défaire des affaires du petit, il reconstituera la chambre de Nuco dans son propre domicile, tel un sanctuaire où vivre en paix avec lui. Tous le croient fou, bien entendu, à l’exception de Mariaje, qui se juge elle-même pleine de bon sens, voire terre à terre.
Plus drolatiquement poignant, on trouverait difficilement. Le roman trouve, dans les petits et les grands arrangements de ses personnages avec la mort, un registre métaphysique indissociable de l’expérience fort concrète de l’absence d’un vivant, qui plus est de celle d’un « petit », voué à grandir.
Les confidences faites à l’auteur par Mariaje, intercédant auprès de ce dernier pour qu’il ne ridiculise pas son père ni ne se montre condescendant envers José Miguel, son brave homme de mari, apportent un contrepoint aux doux délires de Nicasio. Elles ouvrent aussi furtivement, tel un deuxième abîme sous les pieds des personnages, une nouvelle ligne d’intrigue romanesque. L’alliance du comique et du tragique n’y manque pas, qui montre Mariaje en proie à un chagrin qu’elle tait et aux prises avec Dieu, ou plutôt avec un crucifix en bois d’olivier qui lui vient de sa défunte et pieuse mère, malgré ses continuelles protestations de rationalité. Donnant tantôt la parole à Mariaje, tantôt la mettant en scène dans ses allées et venues ou ses prostrations, le récit touche juste à chacune des occasions, réussissant ce que l’on appelle un « magnifique portrait de femme ». Sa pudeur instinctive, son invincible désir d’enfant qui l’aura conduite à faire certaines entorses à sa morale, sa foi dans « cette putain de vie », sa tâtonnante mais sûre lucidité, son triomphant sens de la dérision, font de Mariaje un inoubliable modèle de sagesse stoïque. Trop humaine, elle a néanmoins et fort heureusement, de même que son père, quelques replis de malice, se moquant gentiment de son José Miguel qui, lui, en manque par trop à son goût.
Faisant pendant au portrait de Mariaje, celui de José Miguel – dit-on un « portrait d’homme » ? eh bien voilà, c’est fait – est tout aussi exemplaire. Cet homme de bonne volonté, tout de pudeur et de silence, vit non seulement le deuil de son fils mais un drame de la masculinité.
Aux lectrices et aux lecteurs de jouer avec les dits et les non-dits que Fernando Aramburu dispose savamment dans son roman sans trop vouloir les égarer. Le jeu de cache-cache auquel il nous convie n’est autre que celui de la pudeur romanesque, dont il observe absolument les règles. Élémentaire question de tact, direz-vous. Élémentaire ?