Milan Kundera, né à Brno le 1er avril 1929, est mort à Paris le 11 juillet 2023. Romancier complexe, entre les langues, entre les histoires aussi, théoricien majeur de la littérature, il a porté un certain art du refus à son paroxysme. Radical et lucide, il n’a jamais cédé aux sirènes de la gloire et de la notoriété. Norbert Czarny, son ancien étudiant, nous invite à une traversée sensible et personnelle de son œuvre.

Peu après la parution de L’insoutenable légèreté de l’être, j’ai fait remarquer à Milan Kundera que la notice biographique, en quatrième de couverture, indiquait qu’il était né à Prague. « Vous êtes de Brno, pourtant ? » Il m’a regardé en souriant, et, avec son accent trainant, roulant les r, il m’a dit : « ce n’est pas grave, pas important. »
Ce qui touchait à sa biographie l’indifférait. Il n’a pas voulu que la Pléiade contienne la moindre indication sur sa vie. Une biographie de l’œuvre suffisait. Et ceci, que l’on peut lire dans L’art du roman : « Romancier (et sa vie). « L’artiste doit faire croire à la postérité qu’il n’a pas vécu », dit Flaubert. Maupassant empêche que son portrait paraisse dans une série consacrée à des écrivains célèbres : « La vie privée d’un homme et sa figure n’appartiennent pas au public. » Hermann Broch sur lui, sur Musil, sur Kafka : « Nous n’avons tous les trois pas de biographie véritable. » Ce qui ne veut pas dire que leur vie était pauvre en événements, mais qu’elle n’était pas destinée à être distinguée, à être publique, à devenir biographie. On demande à Karel Čapek pourquoi il n’écrit pas de poésie. Sa réponse :
« Parce que je déteste parler de moi-même. » Le trait distinctif du vrai romancier : il n’aime pas parler de lui-même ».
Peu après notre échange sur la capitale de la Bohême et celle de la Moravie, je ne l’ai plus vu ni entendu. Pas seulement moi : quiconque voulait l’interviewer, en savoir plus sur lui et sur ce qu’il pensait, se voyait opposer une fin de non-recevoir. Citons-le : « Interview. 1) L’intervieweur vous pose des questions intéressantes pour lui, sans intérêt pour vous ; 2) de vos réponses, il n’utilise que celles qui lui conviennent ; 3) il les traduit dans son vocabulaire, dans sa façon de penser. À l’imitation du journalisme américain, il ne daignera même pas vous faire approuver ce qu’il vous a fait dire. L’interview paraît. Vous vous consolez : on l’oubliera vite ! Pas du tout : on la citera ! »
Il ne voulait pas exister comme personne publique, risquer de devenir « people ». Des livres ont paru, et paraitront, qui mettront l’homme en lumière, contenant des anecdotes, des instants, des mots d’esprit. Contentons-nous, avant qu’ils n’arrivent sur les tables, de ne rappeler que le passeur qu’il a été. Arrivé à Rennes où il enseigne la littérature comparée, introduit à la faculté par Dominique Fernandez et Albert Bensoussan, il devient ensuite professeur à l’EHESS alors dirigée par François Furet, qui tenait à ce qu’il y enseigne. Parmi les romanciers que Kundera fait intervenir dans son séminaire : Danilo Kiš, Tadeusz Konwicki, Kazimier Brandys. Petr Kral vient parler du surréalisme tchèque. La scénariste et réalisatrice Agnieszka Holland présente Danton, écrit avec Andrzej Wajda. Le mur de Berlin n’était pas tombé, les débats sur la révolution restent vifs.
Mais Kundera lui-même n’avait-il pas été connu et reconnu par un autre passeur ? Dès 1972, Philip Roth avait rencontré les écrivains d’Europe centrale, puis créé une collection chez Penguin afin de les faire connaître dans le monde anglo-saxon. L’amitié entre les deux romanciers ne s’est jamais interrompue et, dans un entretien avec Jean-Pierre Salgas, Philip Roth fait une promesse post mortem à l’auteur de La plaisanterie.
Kundera ne supportait pas les projecteurs des plateaux de télévision et moins encore les « débats d’idées ». Le temps lui a donné raison puisque ces « plateaux », à de rares exceptions près, sont devenus débats d’ego, d’émotions, ou de réactions. Ou monologues parallèles. Il l’avait vu venir.
Il faut cependant mettre Kundera à la bonne place, et pour commencer lui attribuer l’identité qu’il a toujours revendiquée : celle de romancier.
J’ai eu la chance d’avoir Milan Kundera pour professeur à l’EHESS. Pendant cinq années, j’ai suivi ses cours, appris, et ce que je lui dois me marque encore quarante ans après. De l’homme que j’ai côtoyé, je ne veux ni ne peux rien dire : il était courtois, pudique, drôle, d’une intelligence et d’une rigueur impressionnantes. De sa drôlerie, un mot. Il avait cet humour d’Europe centrale que nous partagions, naturellement, ou presque. Il était originaire d’une petite nation prise en étau entre des puissances prédatrices, et, sans abuser de l’adjectif, impérialistes. Pour un pays aussi fragile, la menace était constante et, en ce début des années quatre-vingt, la Tchécoslovaquie vivait sous le joug soviétique.
Cette Bohême, comme il l’appelait, bien qu’il fût morave, avait toujours été un terreau fécond ; et, du formalisme de Jakobson à Kafka, Hasek ou Hrabal, en passant par Janáček (natif de Brno lui aussi) ou le philosophe Jan Patocka, on ne compte plus les intellectuels et artistes qui ont donné son rang à ce pays. Ajoutons ces noms de cinéastes, parmi d’autres, à cette liste : Milos Forman, Ivan Passer, et Agnieszka Holland. Kundera a été leur professeur de scénario à la FAMU (équivalent de notre FEMIS) à Prague. Le conseil qu’il leur donne est paradoxal : écrivez des histoires qu’on ne peut pas filmer. Cela donnera des instants merveilleux et bizarres dans Les amours d’une blonde ou Éclairage intime.

Il faut cependant mettre Kundera à la bonne place, et pour commencer lui attribuer l’identité qu’il a toujours revendiquée : celle de romancier. Ce terme revient avec insistance dans la plupart de ses essais, et dans les entretiens qu’il a accordés. Le romancier n’est pas « l’écrivain de prose » qu’évoque Sartre. La différence est d’importance et il la signifie dans L’art du roman : « L’écrivain a des idées originales et une voix inimitable. Il peut se servir de n’importe quelle forme (roman compris) et tout ce qu’il écrit, étant marqué par sa pensée, porté par sa voix, fait partie de son œuvre. Rousseau, Goethe, Chateaubriand, Gide, Camus, Malraux.
Le romancier ne fait pas grand cas de ses idées. Il est un découvreur qui, en tâtonnant, s’efforce de dévoiler un aspect inconnu de l’existence. Il n’est pas fasciné par sa voix mais par une forme qu’il poursuit, et seules les formes qui répondent aux exigences de son rêve font partie de son œuvre. Fielding, Sterne, Flaubert, Proust, Faulkner, Céline.
L’écrivain s’inscrit sur la carte spirituelle de son temps, de sa nation, sur celle de l’histoire des idées.
Le seul contexte où l’on peut saisir la valeur d’un roman est celui de l’histoire du roman. Le romancier n’a de comptes à rendre à personne, sauf à Cervantès ».
Les mêmes noms reviennent, qui ont marqué la jeunesse de Kundera : Rabelais, Cervantès, Diderot et Sterne. Ils incarnent ce qu’il appelle « la première mi-temps du roman ». Dans cette première mi-temps, l’écrivain joue encore avec les formes. La vraisemblance n’est pas un critère absolu : Sancho Pança peut perdre cent trois dents et le narrateur de Jacques le Fataliste oublier de nommer la bataille lors de laquelle Jacques fut blessé au genou. Une telle désinvolture est inimaginable chez Balzac ou Zola. Entretemps, les canons du genre romanesque ont changé, et l’époque avec eux. Cervantès et Diderot jouissaient d’une grande liberté ; ils ne se sentaient pas tenus de tout raconter, notamment ce qui leur semblait fastidieux. Le roman post-balzacien ne sait ou ne peut éviter ces « informations ; descriptions ; attention inutile pour les moments nuls de l’existence ; la psychologie qui rend toutes les réactions des personnages connues d’avance ; bref […] le manque fatal de poésie ».
Poésie, fantaisie, inventivité, jeu, liberté, ironie. Ce sont quelques-uns des termes qui reviennent dans les textes « théoriques » de notre écrivain. Je mets des guillemets à théoriques. Alors que nous nous noyions, étudiants en littérature, dans les textes abscons, remplis de termes empruntés à la science, Kundera écrivait une langue limpide, structurée, qu’un lycéen pouvait aisément comprendre. « Plus c’est savant, plus c’est bête », disait son cher Gombrowicz. Cela valait pour l’une de ses cibles favorites, les « kafkologues », du moins certains d’entre eux comme Deleuze et Guattari.
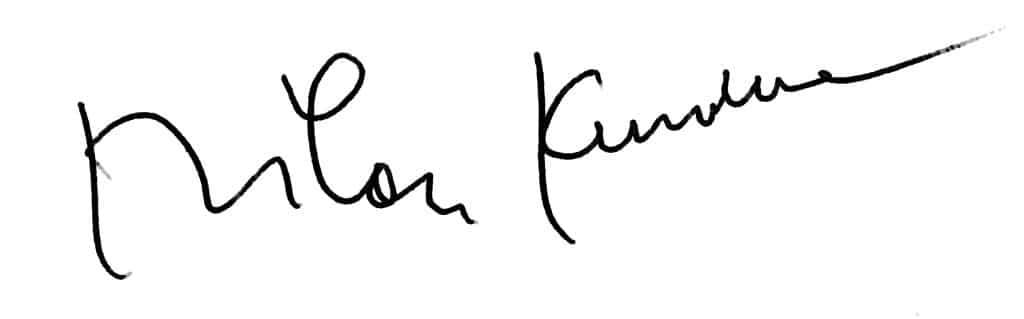
Les romanciers qu’il aimait incarnent « la sagesse de l’incertitude », propre aux Temps modernes, quand l’emprise du dogme est mise à mal : « Comprendre avec Cervantès le monde comme ambiguïté, avoir à affronter, au lieu d’une seule vérité absolue, un tas de vérités relatives qui se contredisent (vérités incorporées dans des ego imaginaires appelés personnages), posséder donc comme seule certitude la sagesse de l’incertitude, cela exige une force non moins grande ». Cette force est aussi un combat contre ceux que Rabelais appelle les « agélastes », ceux qui ne rient pas, qui n’ont pas le sens de l’humour. Dans son article « ironie », Kundera cite Conrad : « Souvenez-vous, Razumov, que les femmes, les enfants et les révolutionnaires exècrent l’ironie, négation de tous les instincts généreux, de toute foi, de tout dévouement, de toute action ! » Nous en sommes plus que jamais là, de quelque côté que nous nous tournions. (Mais épargnons les femmes et les enfants.)
Les agélastes et les révolutionnaires, Kundera les évoque à sa manière dans La plaisanterie, son premier roman traduit. Ils lisent la carte postale envoyée par Ludvik à celle qu’il aime. Ils la lisent parce qu’elle la leur a donnée. La suite, dans cette Tchécoslovaquie des années cinquante, on la connaît. Le héros est banni, puni.
Enfin, la poésie. Le terme suppose des développements, des explications. Kundera a rompu bien des lances, suscité bien des polémiques autour du mot lyrisme. Disons pour faire d’abord simple qu’il n’aimait guère qu’on se paie de mots, qu’il ne se sentait aucun lien ni intérêt pour la poésie française romantique. À quoi on pourra lui rétorquer qu’un Ponge, un Michaux ou un Tardieu sont loin de ces excès du cœur. Mais rangeons les lances et reprenons ses propos précis en 1984 dans La Quinzaine littéraire : « Je pense qu’un romancier naît toujours sur la maison démolie de son lyrisme. Alors, j’ai démoli mon lyrisme ! J’avais un peu plus de 25 ans. Cette période est le mi-temps de ma vie, sa césure. Tout ce qui s’est passé avant est pour moi une préhistoire, qui n’a d’intérêt que pour la connaissance que je peux avoir de moi-même ».
De cette méfiance l’égard de la poésie, dans ses excès, La vie est ailleurs est le meilleur exemple. Jaromil est élevé comme un futur Rimbaud ; il devient délateur, se met au service du régime et trahit tout ce que la poésie peut avoir de subversif. Ce lyrisme-là, il le dénigre par des expressions comme « avoir du cœur », « souffrir pour les autres ». Mais un passage de La vie est ailleurs est plus éloquent encore : « Le mur, derrière lequel des hommes et des femmes étaient emprisonnés, était entièrement tapissé de vers et, devant ce mur, on dansait. Ah non, pas une danse macabre. Ici l’innocence dansait ! L’innocence avec son sourire sanglant. » L’image de la ronde revient dans Le livre du rire et de l’oubli ; elle est sinistre.
C’est pourquoi Kundera peut être considéré comme un moderne antimoderne.
Cela étant, outre qu’il avait publié de la poésie, dans un ouvrage qu’il considérait comme inabouti et qu’il n’avait jamais réédité, Kundera aimait une certaine poésie. Notamment celle d’Apollinaire, qu’il avait traduite, et celles de Holan et de Skacel. Rien de bien étonnant à cela. Il a toujours défendu un certain art moderne, inventif, ouvert sur le nouveau sans renier ou détruire le classique : « Dès ma première jeunesse, j’ai été amoureux de l’art moderne, de sa peinture, de sa musique, de sa poésie. Mais l’art moderne était marqué par son « esprit lyrique », par ses illusions de progrès, par son idéologie de la double révolution, esthétique et politique, et tout cela, peu à peu, je le pris en grippe. Mon scepticisme à l’égard de l’esprit d’avant-garde ne pouvait pourtant rien changer à mon amour pour les œuvres d’art moderne. »
C’est pourquoi Kundera peut être considéré comme un moderne antimoderne. Il n’a pas le culte de la modernité tel que l’Occident le vit. Il ne partage pas les élans des surréalistes, par exemple, et, contrairement à eux, il lit et apprécie Anatole France. Il relit donc Les dieux ont soif à l’aune de son expérience tchécoslovaque, lorsqu’il était un jeune militant communiste. Il se sent proche de Brotteaux, l’homme « qui refuse de croire ». Et il est fasciné par la position du romancier : « Non, le romancier n’a pas écrit son roman pour condamner la Révolution mais pour examiner le mystère de ses acteurs, et avec lui d’autres mystères, le mystère du comique qui s’est faufilé dans les horreurs, le mystère de l’ennui qui accompagne les drames, le mystère du cœur qui se réjouit des têtes coupées, le mystère de l’humour en tant que dernier refuge de l’humain… » Il fait le lien entre France et Diderot ou Voltaire, chose peu surprenante mais souvent considérée comme un reproche, comme une incapacité de France de se situer dans son temps, à le prendre à bras-le-corps, alors qu’au fond, pour Kundera, il est l’un de ceux qui y parviennent le mieux.

Cette relecture, dans Les testaments trahis, offre un autre regard sur ce que nous croyons, pensons et lisons de ce côté-ci de l’Europe. Kundera romancier a une vision sur le genre qui rappelle celle d’Hermann Broch, l’un de ses maitres. L’auteur des Somnambules ne voulait pas rester enfermé dans le contexte de la Mitteleuropa, être comparé à Zweig et à Schnitzler. Ses égaux ou modèles, c’étaient Gide et Joyce. Dans Les testaments trahis, Kundera raconte la visite à Prague de Garcia Márquez, Fuentes et Cortazar. Une mystérieuse alchimie rapproche son Europe centrale de l’Amérique latine. Le baroque, arrivé chez eux comme art du conquérant et en Europe centrale avec la répression de la Contre-Réforme, les unit, et une belle formule résume cette rencontre : « J’ai vu deux parties du monde initiées à la mystérieuse alliance du mal et de la beauté. »
Rien d’étonnant à ce qu’il ait reconnu l’importance de l’œuvre de Patrick Chamoiseau, dont il parle dans Une rencontre, à ce qu’il ait soutenu Rushdie dès la publication des Versets sataniques, rien d’étonnant non plus, si l’on considère tout ce qui précède à ce qu’il ait défendu Hrabal quand celui-ci publiait des livres sous le régime communiste : « Un seul livre de Hrabal rend un plus grand service aux gens, à leur liberté d’esprit, que nous tous avec nos gestes et nos proclamations protestataires », écrit Kundera. L’apolitisme de Hrabal devient une arme. Mais surtout son humour et son imagination, contre l’idéologie qui nivelle et prend tout au premier degré. C’était déjà la réponse du Švejk, de Jaroslav Hašek à ses maîtres et chefs.
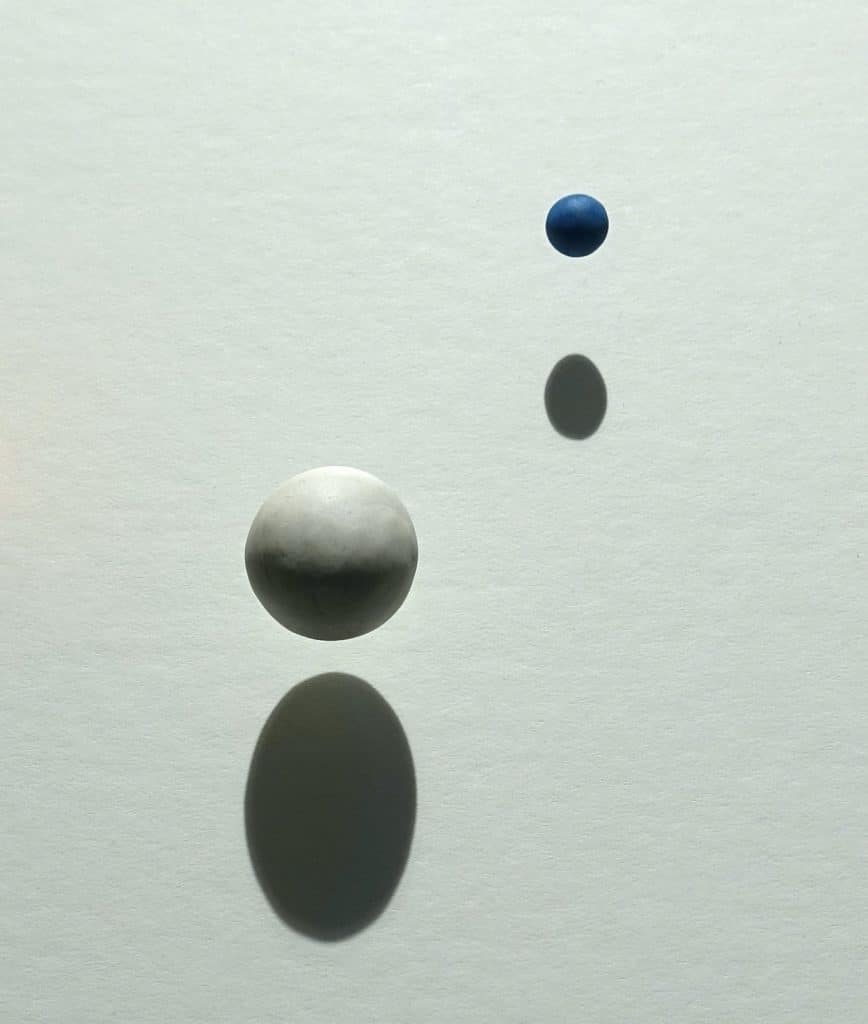
Cet hommage a quelque chose de paradoxal. L’adjectif que j’emploie était un des mots favoris de notre romancier. Il y est peu question de son œuvre romanesque, de sa façon d’y combiner l’intrigue et la méditation, la poésie et la prose parfois la plus triviale, héritage de Rabelais et de Gombrowicz, l’Histoire et le rêve. On parle conception de la littérature, refus de la politisation et de la « peopolisation » et on clôt sur la traduction. Kundera a écrit ses derniers romans en français. Ils n’ont pas l’envergure de ses grands romans jusqu’à L’immortalité et on peut même s’interroger sur La fête de l’insignifiance. Son attachement à la langue qui, autant que le pays, l’avait accueilli était très puissant. Au point que, dans les années du séminaire, il a choisi de revoir toutes les traductions de ses romans. Il avait commencé avec La plaisanterie et le récit qu’il fait de sa découverte de son texte est amusant : « En France, le traducteur a récrit le roman en ornementant mon style. En Angleterre, l’éditeur a coupé tous les passages réflexifs, éliminé les chapitres musicologiques, changé l’ordre des parties, recomposé mon roman. Un autre pays. Je rencontre mon traducteur : il ne connaît pas un seul mot de tchèque. « Comment avez-vous traduit ? » Il répond : « Avec mon cœur », et me montre ma photo qu’il sort de son portefeuille ». La suite figure dans Les testaments trahis.
Kundera ne voulait pas que des commentaires ou notes figurent dans l’édition de la Pléiade. Ce qu’il avait écrit suffisait, et les échos que l’on trouve dans ses essais étaient pour lui le meilleur des commentaires de ses romans puisqu’ils étaient une réflexion sur ce genre tant aimé, tant pratiqué. Les raisons de relire Kundera ne manquent pas, avec ou sans commentaire.
Lui, il est maintenant « domu », à la maison en tchèque. Il a retrouvé la langue de son enfance, de ses bonheurs de jeunesse et il écoute dans les cieux Sur un sentier broussailleux, de son cher Janáček.
Cet article a été publié sur Mediapart.












