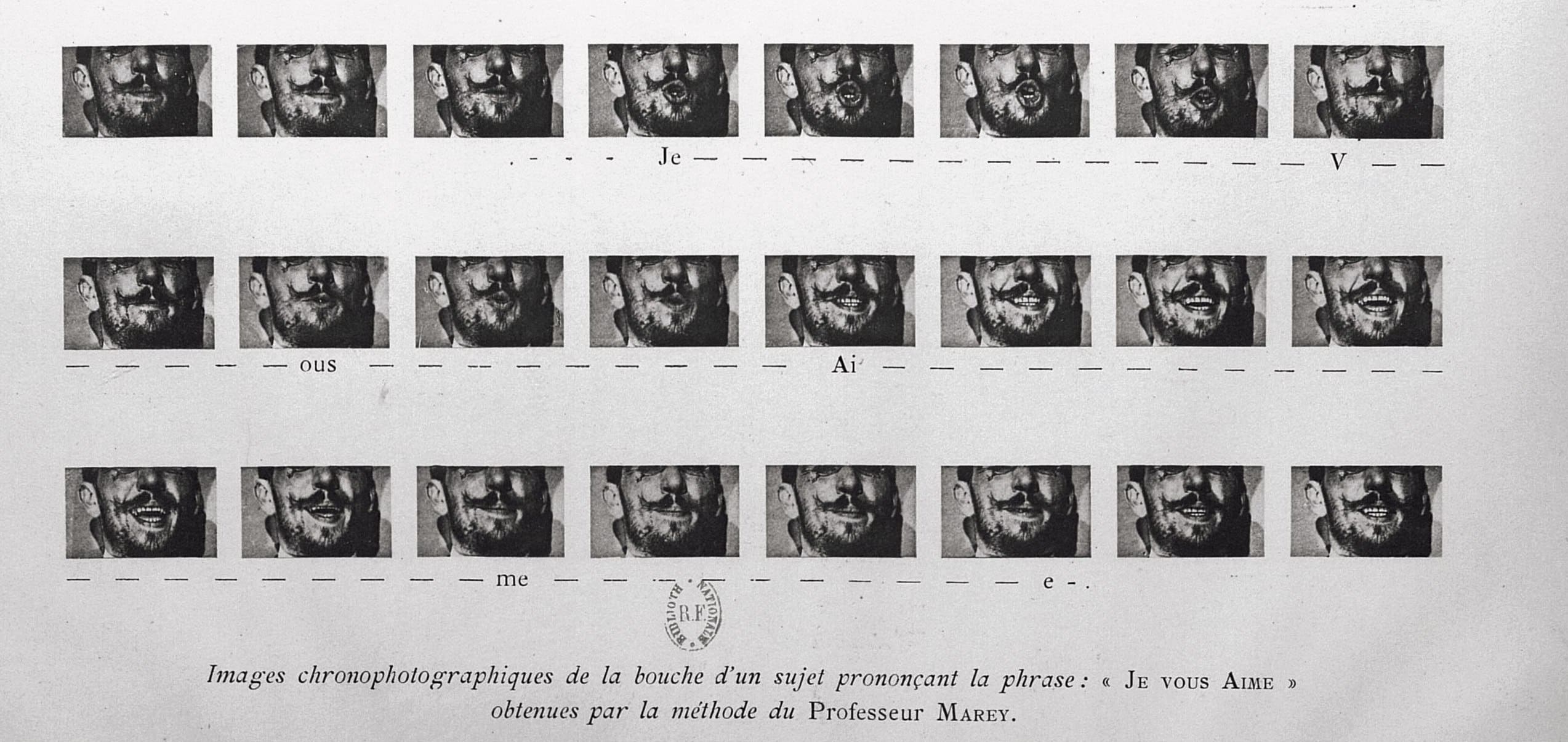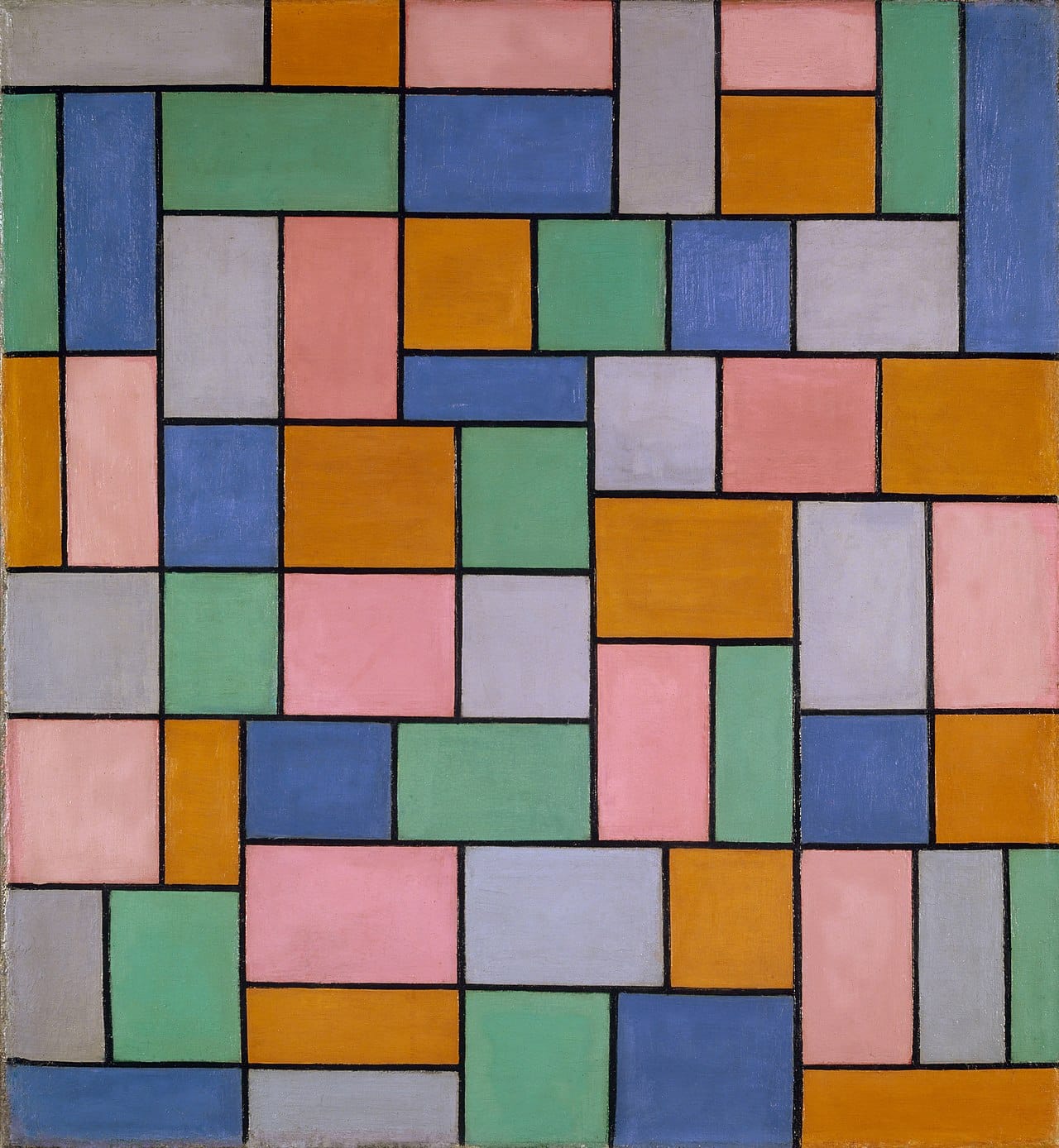Lorsque, à vingt-cinq ans, Shulamith Firestone publia La dialectique du sexe (1970), elle avait déjà commencé à s’éloigner des mouvements féministes radicaux qu’elle avait contribué à créer à Chicago et à New York. L’extraordinaire succès de son livre et la postérité de son action militante n’empêchèrent pas le reste de son existence de n’être qu’une suite d’effondrements psychiques et de difficultés financières. Elle mourut seule chez elle, probablement de faim, en 2012. Hormis Zones mortes, paru en anglais en 1998 et en français aujourd’hui, un petit recueil autobiographique que des amis l’avaient poussée à écrire, elle n’avait rien publié depuis 1970. Ce fut d’ailleurs son dernier ouvrage.
Shulamith Firestone, Zones mortes. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Émilie Notéris. Brook, 155 p., 18 €
Ce petit livre, écrit longtemps après que Shulamith Firestone eut disparu de la scène publique, offre de très courts textes, allant de quelques pages à un paragraphe, racontant des vies détruites par la folie ou la pauvreté, ou des épisodes particuliers de celles-ci. Il tire presque tout son matériau de rencontres et d’expériences que l’auteure a faites après ses années d’activisme. Elle-même y figure comme témoin ou protagoniste (à la première ou troisième personne), mais moins au début que dans les pages finales.
Dans le dernier texte, « Danny », troublante évocation d’un frère suicidé, Firestone laisse percevoir plus d’émotion personnelle et rappelle les souvenirs d’une enfance passée au sein d’une famille juive orthodoxe, soumise à de sévères prescriptions religieuses. C’est d’ailleurs le seul moment du recueil où l’auteure choisit de donner une origine aux troubles mentaux qui l’accablèrent ensuite, les mystères entourant la mort de ce frère, dit-elle dans l’ultime phrase de ce petit récit autobiographique, ayant « contribué à nourrir sa folie » et conduit à ses premières hospitalisations.

Mais dans Zones mortes les causes des souffrances intéressent moins Firestone que l’expérience de ceux qui se débattent avec elles, et les textes des cinq différentes sections du livre (« Hôpital », « Post-hôpital », « Losers », « Nécrologies », « Suicides que j’ai connus ») sont souvent proches d’esquisses comportementales. Y sont dessinées les stratégies diverses de personnes essayant, à l’intérieur ou à l’extérieur des institutions psychiatriques, de lutter contre la folie qui les engloutit, souvent en opposition aux protocoles de soins choisis pour eux par la médecine officielle et différents schémas sociaux. Y sont aussi dessinés les mécanismes de la cruauté administrative ordinaire qui relèguent et paupérisent.
Parmi les figures auxquelles l’auteure accorde son attention apparaissent quelques personnages célèbres, comme Valerie Solanas, auteur du manifeste SCUM (Society for Cutting up Men), qui avait tenté d’assassiner Andy Warhol en 1968. Firestone raconte la visite peu satisfaisante qu’elle lui fit vers l970, « parce qu’elle voulait la voir de ses propres yeux et qu’elle était téméraire », puis ses rencontres successives, au hasard des rues, avec une Solanas de plus en plus incohérente et menaçante, mendiant à demi-nue dans le Village à New York.
Quant à l’état de vide et de dépersonnalisation dont souffre Firestone elle-même, elle en décrit les facettes dans un texte frappant, « Paralysie émotionnelle », où, parmi toutes les pertes dont elle fait l’inventaire, elle mentionne avec acuité celle des activités et des sentiments qui constituaient son existence avant la maladie. Dans son catalogue de l’impuissance, elle dit ainsi, parlant d’elle-même à la troisième personne : « Elle ne pouvait pas lire. Elle ne pouvait pas écrire. Avant sa première hospitalisation, elle lisait L’Enfer de Dante, mais à sa sortie elle ne parvenait même pas à comprendre un article de magazine de mode. Les mots ricochaient sur son front comme sur du métal… Elle pouvait à peine allumer la radio et mettre en route le magnétoscope. // Un immense vide s’ouvrait dans l’emploi du temps de journées autrefois occupées par la lecture, l’écriture et le cinéma. Elle ne pouvait pas non plus sortir… et elle n’avait de toute façon pas d’argent… Elle reconnaissait parfois dans le visage des autres la joie, l’ambition, ou d’autres émotions qu’elle se souvenait avoir un jour éprouvées, autrefois, longtemps auparavant. Mais sa vie était en miettes et elle n’avait aucun plan de sauvetage. »

Zones mortes est donc un témoignage sur la déroute mentale et la manière dont l’individu et les institutions tentent d’y faire face. C’est aussi un texte new-yorkais sur la façon dont le système de soins et d’aide traitait vers la fin du XXe siècle ces populations « fragiles » qui ont pour partie disparu d’un Manhattan aujourd’hui immensément riche. Mais, replacé à l’intérieur de la pensée de Firestone, Zones mortes est aussi l’autre versant de La dialectique du sexe. Non parce qu’il donnerait une explication « psychiatrique » a posteriori du livre de 1970, permettant de le dépolitiser et d’assigner une origine psychique aux perspectives radicales célèbres de l’activiste, mais parce qu’il fournit une sorte d’état des lieux d’un monde irrespirable (son titre original est Airless Spaces) auquel Firestone, en être de courage, opposa des utopies de secours. Pour cela, Zones mortes possède une qualité d’urgence, de tragique, qui dépasse sa force prenante de documentaire ; ses historiettes, précises, non dénuées d’ironie, virent systématiquement et discrètement en allégories de la monstruosité moderne et de l’existence de Firestone.
Hélas, nous parlons ici d’un Airless Spaces auquel le lecteur français n’a pas accès, les éditions Brook livrant une traduction française encore plus mauvaise que celles dont ce dernier a depuis un certain temps pris l’habitude. La langue de Zones mortes est, en effet, soit déplorable soit incompréhensible, une vraie zone morte, somme toute.
Cet article a été publié sur Mediapart.