Il est deux façons de lire le dernier récit de Rumiz : d’une traite, parce qu’on est aussitôt embarqué, pris par la richesse du livre ; lentement, « par hoquets », ce qui correspond davantage à son art de voyager. La légende des montagnes qui naviguent est un périple à travers les Alpes et les Appenins dans les années 2003 à 2006. Huit mille kilomètres accomplis à vélo, en train, ou en « Topolino », une Fiat de 1953 que son propriétaire a appelée « Nerina ». Elle sera parfois la patronne.
Paolo Rumiz, La légende des montagnes qui naviguent. Trad. de l’italien par Béatrice Vierne. Arthaud, 464 p., 22,50 €
Paolo Rumiz est un reporter et écrivain. On hésite à parler d’écrivain voyageur, expression souvent galvaudée qui rend mal compte de ce qu’elle recouvre. Des écrivains voyagent, parce que le monde est vaste, mystérieux, et riche. Rumiz est né entre mer et montagne, à Trieste. Il a grandi devant des cartes, les a apprises par cœur, connaît bien des noms de lieux. Ses quelques livres traduits en français témoignent de ce goût de l’ailleurs, qui est parfois le très proche. Il a ainsi descendu le Pô, relatant ce périple dans Pô, le roman d’un fleuve ; il a écrit sur les phares, relaté le voyage d’Hannibal dans L’ombre d’Hannibal. Mais qui veut entrer dans l’œuvre de Rumiz la plus forte, la plus belle, lira Aux frontières de l’Europe, qui le voit descendre du nord du continent, à la frontière entre la Finlande et la Russie, jusqu’à la mer Noire.
Mettons-nous maintenant en route dans la montagne. Rumiz s’impose une contrainte : ne jamais prendre la ligne droite. La seule exception à la règle est brève : entre la Campanie et la Calabre, il emprunte un bout d’autoroute dans le Cilento. Cela ne dure pas et il retourne bien vite dans les Appennins. Ses étapes, parfois solitaires parfois accompagné d’un fils ou d’un ami, le mènent d’un lieu quasi désert à l’autre, dans des villages ou des hameaux presque abandonnés, comme Masone, village qui subit le plus de pluies en Italie. Si l’auteur rend la beauté des lieux, ou leur étrangeté, s’il célèbre les êtres qui y vivent ou y survivent, sa colère et parfois sa rage se perçoivent. L’ouverture du livre en témoigne qui dénonce « la guerre systématique que le pouvoir livre aux régions les plus vitales, celles qui sont capables de maintenir en vie le territoire et d’empêcher sa dévastation finale ». L’urgence climatique traverse ce récit. La désertification est souvent plus affaire de pluies diluviennes et de sols abimés par le béton ou la déforestation que l’arrivée des sécheresses venues du Sahara. Ce, même si la Calabre, et sa côte ionienne en particulier, connaît des invasions de locustes, ces sauterelles qui dévastent les champs.
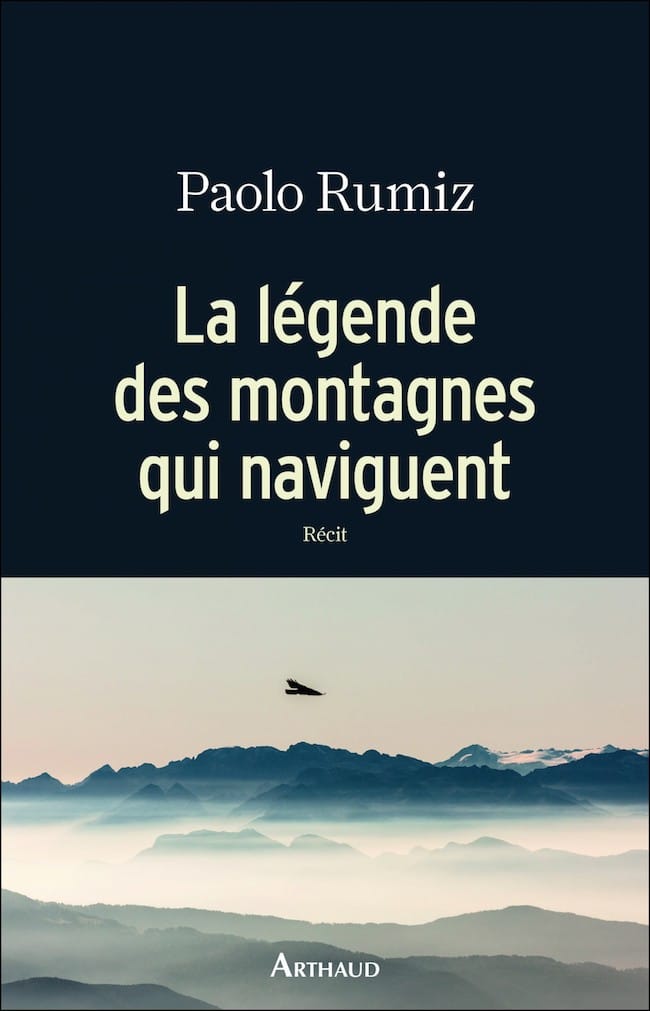
La rage, il l’éprouve aussi à l’égard de ses compatriotes, incapables de considérer les lieux qui leur appartiennent : « Je ne connais pas d’autre nation qui assiste aussi passivement à la mort des lieux. On le voit déjà à la signalétique, à la manière dont les panneaux des villages s’entremêlent à ceux des hypermarchés. Les hameaux, les collines, les ruisseaux perdent leur nom, dernier bastion de l’identité. L’économie a remplacé la topographie, les pages jaunes la carte géographique. » Et l’une de ses phrases résonne comme une sentence : « un peuple qui n’a pas le sens de la géographie est destiné à sortir de l’histoire ».
Les motifs de colère ne manquent pas. Il en est qu’il partage avec Erri De Luca et les défenseurs du Val de Suse : la construction d’une ligne entre Lyon et Turin qui risque d’anéantir une région. S’il se montre plus naïf dans un reportage qu’il consacre à la ligne de TGV entre Bologne et Florence, les lecteurs de La Repubblica se chargent de lui répondre et de l’éclairer. Cette ligne a pollué des rivières, des nappes phréatiques, mis en danger l’équilibre écologique de la région. Le mal vient de plus loin, a-t-on envie de dire : l’État, les grands groupes industriels, les syndicats agricoles, ont laissé la montagne se dépeupler. Dans le sud, du côté de la Molise et des Abruzzes, régions dont on ne parle qu’exceptionnellement à la télévision, l’entreprise a été radicale : les gouvernements ont obligé les paysans à quitter leur terre en provoquant des baisses de prix sur tous les produits agricoles dont ils vivaient. Ce qui vaut pour le sud vaut aussi pour le Piémont et on lira l’histoire édifiante de la « Malga » Busetto, une coopérative qui avait le tort de déplaire au clergé comme au pouvoir, étroitement liés pour faire obstacle à cette entreprise qui fonctionnait bien. Cela revient de lieu en lieu, Paolo Rumiz écoute, transcrit, relate. Un désastre soigneusement programmé. Encore que l’ignorance de la nature, du passé, la bêtise et la cupidité sont indispensables pour raisonner à court terme, et c’est ce qui s’est passé.
Les dangers ne tiennent pas seulement à cette destruction. Rumiz se rend dans le canton de Schwyz, rencontre un dirigeant de l’UDC. À côté d’eux, Jörg Haider semble bonasse. Il a perdu le pouvoir, son parti s’écroule et il accepte ce sort. Dans la « Padanie », en Savoie, et dans d’autres régions au nord de l’Italie, on est moins amène. Jusqu’à l’absurde : le conflit entre le Tyrol autrichien et le sud Tyrol italien a quelque chose de grotesque.
Est-ce à dire que le repli est général, l’hostilité systématique ? L’auteur montre combien l’Italie est diverse, peuplée en son centre, en ses montagnes, de gens divers. Des Ukrainiennes ou Roumaines, assistantes de vie qui font marcher les maisons de repos pour personnes âgées en Émilie, aux Yougoslaves, Albanais et autres peuples des Balkans, qui repeuplent la Molise ou ses terres voisines, on voit que le peuple italien est une sorte de fiction. Sans parler des innombrables morts étrangers qui remplissent les fosses communes ou les cimetières, comme ces Cosaques venus en famille et à qui Hitler avait promis le Frioul, de ces soldats brésiliens appuyant les troupes alliées en 1943. Le présent est moins certain : Rumiz a écrit en 2006, avant que les réfugiés n’arrivent en masse dans le pays. On se crispera ici, voire pire ; on intégrera là, parce que les besoins existent et que la tradition humaniste ou chrétienne existe.

Paolo Rumiz © Jean-Luc Bertini
Lors de son « Topolinéide », fait de haltes nombreuses pour des raisons très variées comme les intempéries, la fatigue de la petite voiture ou autres, Paolo Rumiz fait des rencontres. Elles ont des points communs : ses interlocuteurs sont des solitaires ou des reclus, des femmes et des hommes qui ont quitté la plaine quand ils n’ont pas toujours choisi la montagne. La figure de Mario Rigoni Stern s’impose. Ce qu’il dit à Rumiz a une résonance singulière. On ne retiendra, pour le plaisir, que ses propos sur les saisons en relation avec son vieillissement qui le rend moins sensible à certains sons : « Alors je comprends mes limites. Pour tout homme, il est fondamental de les connaître. Et les limites se manifestent toujours au printemps. Il a une odeur bien précise, définie, humide, fraîche, vitale. Un parfum qui te promet que la vie continue, même si tu t’en vas. Et ça c’est merveilleux. » Et puis, comme un leitmotiv, Rumiz dit le choix du silence. Il consacre de nombreux passages, tous plus riches, plus évocateurs les uns que les autres, à cette « révolte », qui l’anime, comme elle anime d’obscurs prêtres, des vieillards ancrés dans leur terre, des intellectuels et des paysans.
D’autres figures traversent le livre : Kapuscinski, qui se calfeutre à Varsovie pour écrire, en se servant seulement de sa mémoire ; Vinicio Capossela, chanteur qui semble le barde de ces montagnes, Walter Bonatti, le grand alpiniste, ou Patrizia, l’une des éleveuses de Formentara, femme qui avec d’autres a relancé l’élevage de l’agneau non loin de la plaine de Lucques. On pourrait là aussi multiplier les exemples, autant de témoignages sur un monde qui se refuse à disparaître, et lutte, sans violence.
On se laisse prendre à ce « narrabond », comme l’appelle l’auteur : narration et vagabondage qui accepte le détour, le contretemps, la halte imprévue, « bénédiction du voyageur ». Rumiz parle de l’incertitude comme d’un luxe. Et ce malgré les cartes du TCI, le Touring club italien qui a dressé selon lui les meilleurs d’Europe, voilà déjà longtemps. « Tant qu’il y aura les noms, il y aura les lieux. » La légende des montagnes qui naviguent est une ode aux noms de lieux. L’auteur les savoure : ceux bourrés de consonnes de sa région natale et de la Dalmatie toute proche, ceux qui rappellent un passé antique, ceux qui sont gorgés de lumière et d’odeur. Il énumère, au fur et à mesure, ces noms de lieux qu’il ne faut pas perdre. Un voyage s’entend autant qu’il se fait avec les yeux ou le nez.
Difficile de savoir s’il vaut mieux adopter le rythme de la Topolino ou s’il faut ne pas faire de halte. Si l’on choisit la deuxième solution, les chemins de fer italiens laissent le temps de lire d’un trait ces pages.












