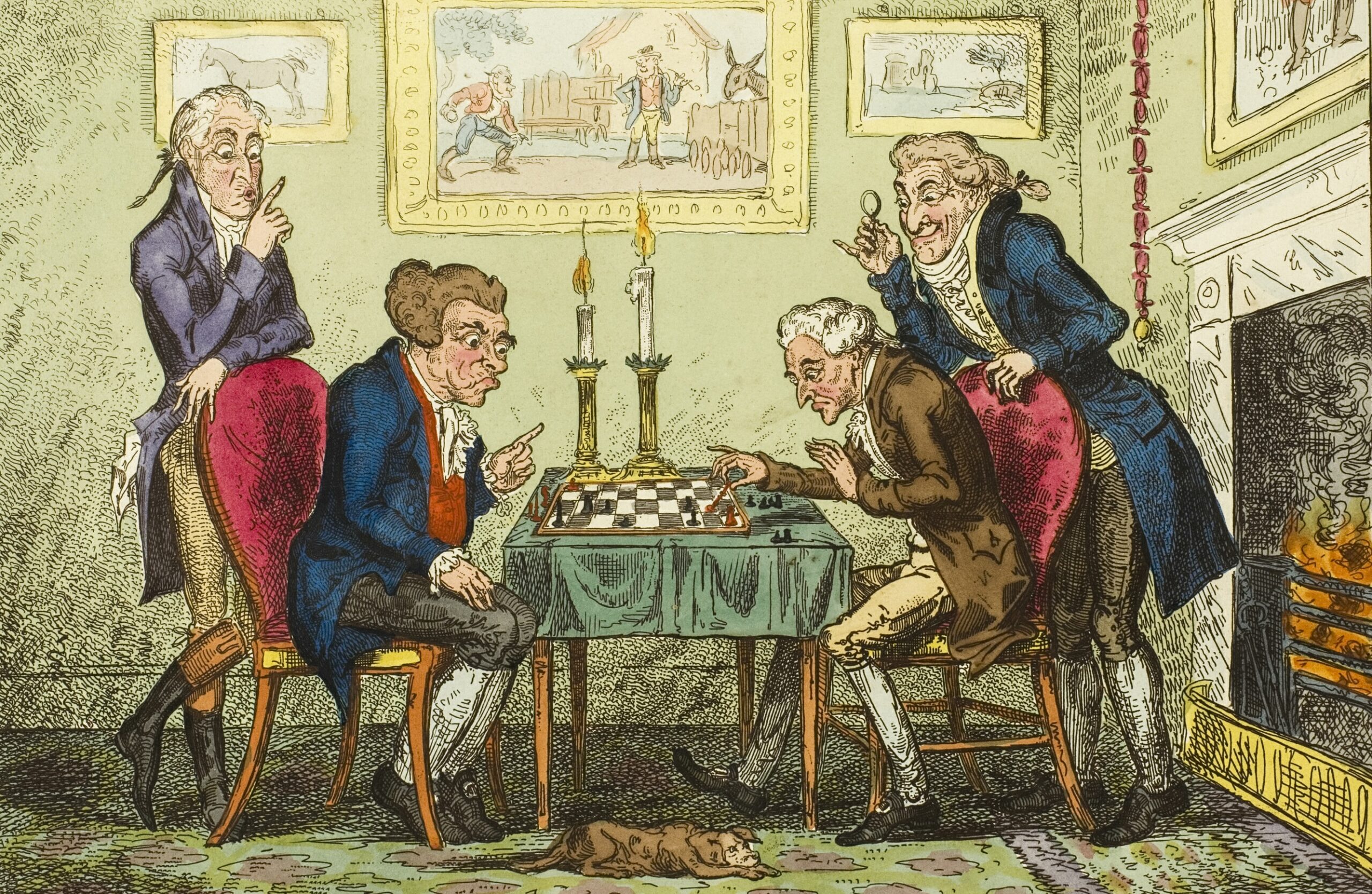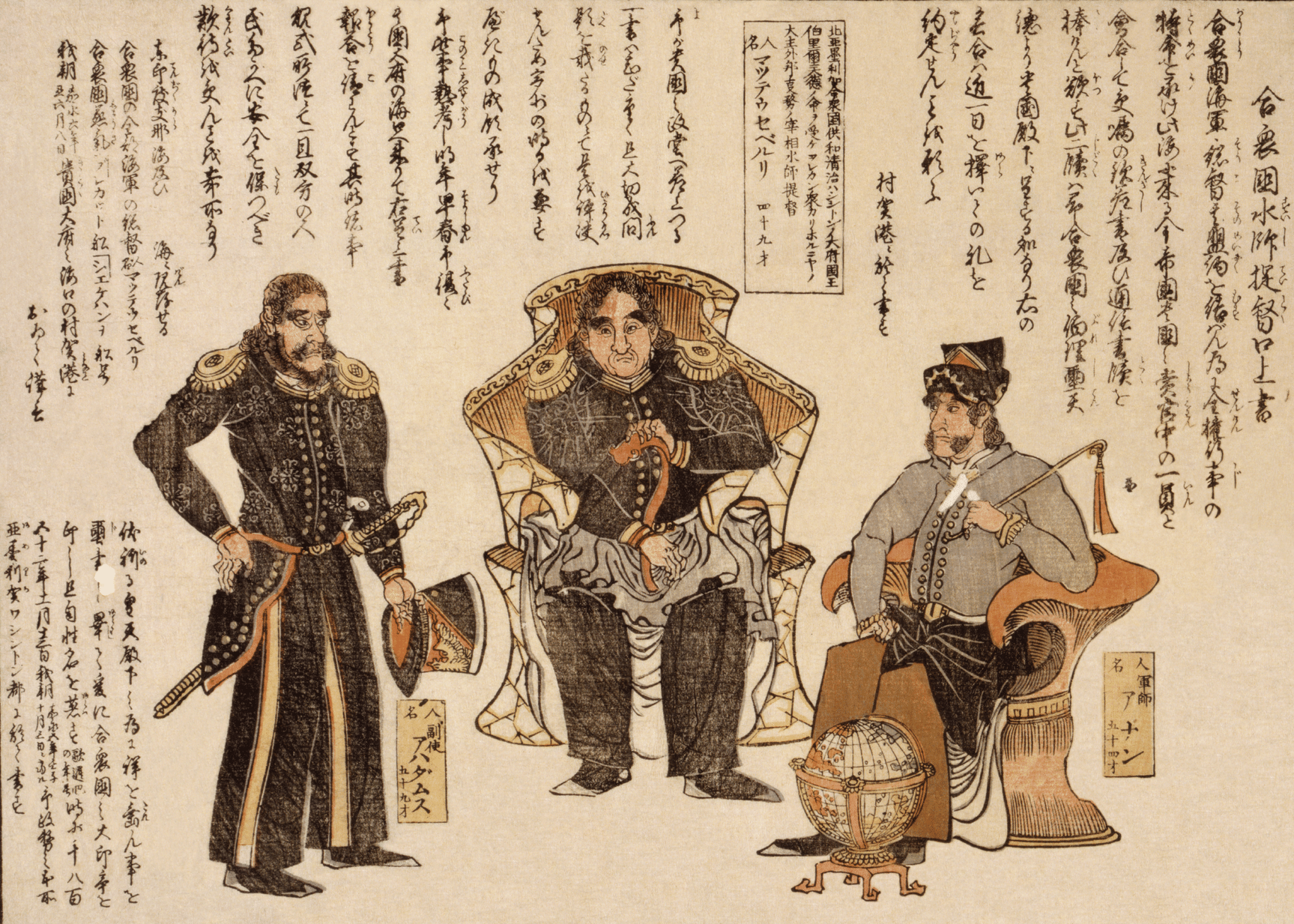La philosophie pessimiste de Schopenhauer ne rencontra pas ses lecteurs du vivant de l’auteur. La parution dans la Pléiade de son chef-d’œuvre, Le monde comme volonté et représentation, vient consacrer son adoption par la France.
« Schopenhauer est chez lui en France », écrivit un jour Nietzsche, qui feignait de trouver la deuxième traduction du Monde comme volonté et comme représentation tellement réussie qu’il préférait lire l’ouvrage en français. L’éditeur de ce qui en fut longtemps la seule version disponible dans le commerce, Richard Roos, a montré que la traduction d’Auguste Burdeau était pourtant loin d’être irréprochable (on sourit à telle « barbe crépue » censée ouvrir une serrure, en fait un panneton). Elle avait certes été amendée de façon au moins à ne pas trahir la pensée du philosophe, et avait même reparu il y a une décennie, dévêtue de son cuir rouge et rhabillée d’une préface de Clément Rosset. Mais il manquait une retraduction exhaustive, conforme aux exigences actuelles d’exactitude et de précision. La voici désormais sertie d’un magnifique apparat critique dans la Bibliothèque de la Pléiade.
Schopenhauer insista à de multiples reprises sur ce que Le monde comme volonté et représentation était le développement d’« une seule et unique pensée ». Le jeune Arthur (il avait moins de trente ans au moment de la première édition) écrivit dans une note : « Toute ma philosophie peut être résumée dans cette seule expression : le monde est l’auto-connaissance de la volonté. » Les quatre livres du Monde, assortis de leurs appendice et compléments, ne font, d’une certaine manière, que déployer cette pensée. Le développement quadripartite de l’ouvrage est structuré en une architectonique massive, respectivement une philosophie de la connaissance, une métaphysique de la nature, une esthétique et une éthique. Le tome de compléments, que Schopenhauer mature désignait comme « Le commentaire », fut ajouté à l’ensemble vingt-cinq ans plus tard.
Le monde est processus d’auto-connaissance de la volonté de vivre : telle est l’unique pensée du pessimiste de Francfort. S’il apparaît au sujet connaissant comme de l’ordre de la représentation, le monde considéré en soi-même est pure volonté. Le titre du livre ne fait que poser cette alternance du monde entre phénoménalité et chose-en-soi. L’essence du réel, non seulement dans les êtres vivants, mais aussi dans la matière aveugle, est de vouloir. À ce titre, la volonté ne veut que s’objectiver, c’est-à-dire s’actualiser dans les choses et les êtres. L’homme est l’ultime étape de cette objectivation, qui permet à la volonté de se connaître elle-même. Ainsi, « le monde comme représentation est un miroir pour la volonté dans lequel elle se connaît elle-même, selon des degrés augmentant en évidence et en complétude, et dont le plus élevé est l’homme ». La volonté finit par emprunter nos yeux pour se connaître elle-même.

« Volonté de vivre » est un pléonasme : la volonté ne veut jamais que la vie, car la vie est précisément l’objectivation de ce vouloir, sa présentation dans la représentation. Inconsciente et aveugle, la volonté a besoin de l’homme pour s’affirmer, mais aussi, lueur d’espoir, pour se nier et disparaître. Car cette objectivation de la volonté dans le monde de la représentation ne produit que souffrance. La volonté « se dévore d’elle-même » : de son combat féroce résulte un carnage affreux qui, reflété dans notre intellect, porte la douleur au plus haut degré. Chez Schopenhauer, la métaphysique ne demande pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, mais déplore plutôt qu’il y ait autre chose que ce rien qui mettrait fin à nos souffrances. Il faut considérer l’existence « comme un égarement, la délivrance consistant à en revenir ».
Dans ce plus mauvais des mondes possibles qu’est le nôtre, la négation de la volonté offre le seul salut possible. Certes, l’expérience de la contemplation esthétique peut prodiguer un calmant provisoire en déliant de la volonté l’objet de la contemplation. L’art nous conduit à « l’Idée » dans le « silence total de la volonté ». Encore n’est-il qu’une première étape sur la voie de la délivrance finale, dont rapprochent le rejet de l’égoïsme et l’ascétisme. L’expérience de la compassion fournit la preuve de l’unité cosmologique de tous les êtres : la volonté fragmentée se rassemble et dissout la limite entre moi et non-moi. Le point culminant du parcours sotériologique est l’état mystique de l’ascèse, mortification volontaire du vouloir en vue d’une sérénité synonyme d’extinction de l’individu.
Quoiqu’il ait lui-même finement discuté ses prédécesseurs, et Kant plus que tout autre – « J’ai simplement continué son œuvre », disait-il –, Schopenhauer n’est pas vraiment de ces philosophes avec lesquels on argumente : on l’accepte ou on le rejette. Les nombreux commentaires et notes de Christian Sommer, qui a présidé à l’édition du texte, aident par leur richesse et leur vigueur à l’accepter. Ils révèlent une philosophie tragique, vibrante, « nourrie au suc et au sang de l’expérience ». Christian Sommer montre comment, baigné de sagesse hindoue et de baroque européen, Schopenhauer vit dans le monde un songe vaporeux, dont la chose-en-soi est une insatiable volonté. « Battu par les flots de l’insuccès », il ne doutait pourtant guère d’avoir apporté par cette découverte la réponse à des siècles de questionnement philosophique : « Mais qui suis-je alors ? Je suis celui qui a écrit Le Monde comme volonté et comme représentation et a donné une solution au grand problème de l’existence, laquelle rendra peut-être obsolètes les solutions précédentes et occupera certainement les penseurs des siècles à venir. » En cette dernière intuition au moins il ne se trompait pas.
Ce Kant bouddhiste, lecteur de Platon et du Veda (plus précisément des Upanishad, textes fondamentaux de l’hindouisme), bouleversa Wagner, Nietzsche et Thomas Mann. Un véritable « effet Schopenhauer » s’abattit sur l’Europe après sa mort en 1860. Kafka, Tolstoï, Beckett, Borges et tant d’autres s’enthousiasmèrent pour sa métaphysique. La mode pessimiste contaminait la littérature et les arts. On sait moins que Théodule Ribot fit œuvre de précurseur en consacrant sa première étude à la philosophie d’un Schopenhauer alors tout juste traduit. Depuis cette époque, le maître de Nietzsche est chez lui en France. Et si Richard Roos pouvait déplorer en 1966 que les portes du monde académique lui fussent obstinément fermées, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En témoignent notamment un Cambridge Critical Guide consacré au Monde comme volonté et comme représentation paru il y a trois ans, et le tout récent The Schopenhauerian Mind édité par David Bather Woods et Timothy Stoll (Routledge, 2025). Il n’existe pas d’édition complète des œuvres de Schopenhauer en français, mais ses textes deviennent toujours plus accessibles : les Pareraga et paralipomena ont paru en 2020 aux éditions Bouquins, et Christophe Bouriau publiait en 2023 le Cours exhaustif sur la philosophie (première partie) aux éditions Classiques Garnier.
La traduction du Monde comme volonté et représentation avait été fournie par Christian Sommer, Vincent Stanek et Marianne Dautrey aux éditions Gallimard il y a seize ans. Ici reprise, elle confirme ses avantages : une lecture fluide et agréable doublée d’une scrupuleuse fidélité. S’y ajoute un appareil critique de haute volée, qui prend en compte les acquis philologiques et les recherches académiques récentes (on se souvient entre autres des travaux de Christophe Bouriau, ou d’un recueil pas si ancien dirigé par Jean Salem et Christian Bonnet). Le volume présente en outre l’intérêt de regrouper commodément les deux gros pavés précédemment parus dans la collection « Folio Essais ». Le livre de la Pléiade consacre le retour de Schopenhauer en la patrie. Gageons qu’il viendra bousculer sur les étagères le fameux volume rouge relié cuir.