L’œuvre de Charles Larmore, le plus français des philosophes américains, s’impose au fil des ans comme incontournable. Les entretiens que le philosophe a accordés à Pierre Fasula sous le titre De raisonnables désaccords apportent plus qu’une simple clarification de ses idées maîtresses. La notion de « désaccords raisonnables » permet de faire communiquer les différentes facettes de cette œuvre, de sa conception de la pratique de la philosophie et du statut de la vérité à ses conceptions éthiques et politiques.
Charles Larmore, De raisonnables désaccords. Dialogue avec Pierre Fasula. Les Petits Platons, 124 p., 19 €
Larmore défend un libéralisme entendu non au sens que ce mot a parfois en français – la doctrine économique de la libre entreprise et du libre marché – mais au sens strictement politique de ce terme, plus usuel en anglais. Or, l’idée centrale du libéralisme est qu’il faut rendre les fondements de l’État aussi indépendants que possible de toute conception substantielle du bien, qu’elle soit religieuse ou séculière. Le libéralisme admet le caractère indépassable des désaccords concernant le bien et le juste, quand bien même les citoyens exerceraient de manière non contrainte leur jugement et leurs facultés rationnelles. La base de la conception libérale de l’État n’est donc pas la justice (car il peut y avoir désaccord sur ce qui est juste), ni même l’idée démocratique de souveraineté du peuple (car la souveraineté populaire peut, dans certaines circonstances, dégénérer en dictature), mais l’idée de respect des individus et de leurs opinions.
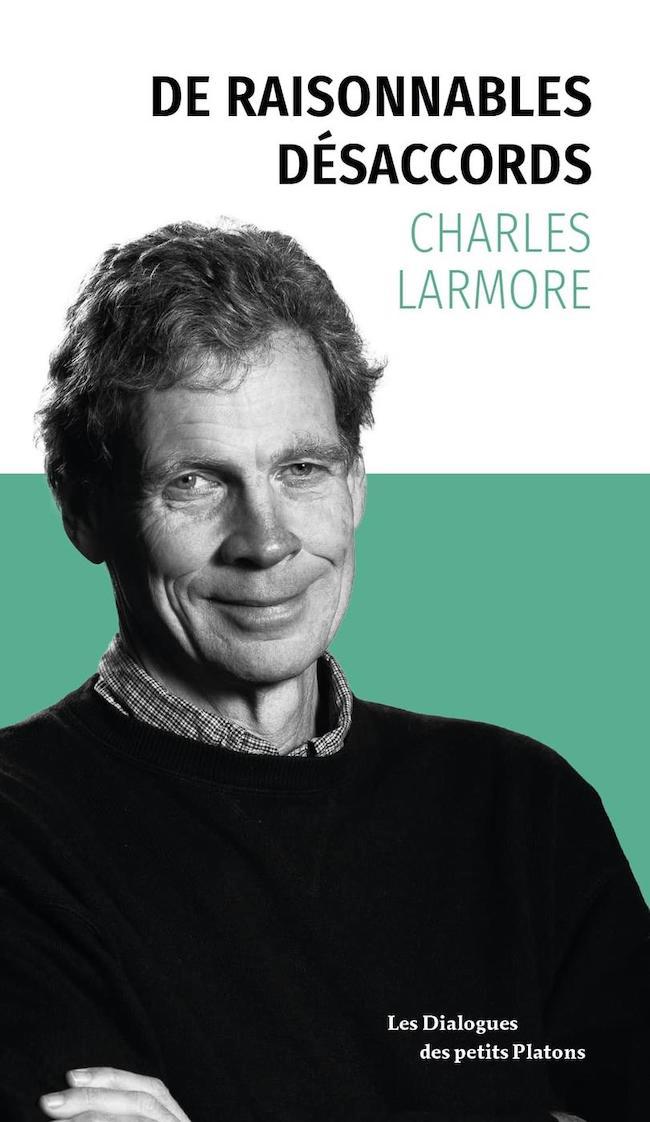
L’association politique doit reposer sur des principes qui sont neutres à l’égard de toute vision du monde particulière, afin de garantir à chaque individu un respect égal et son droit à vivre selon ce qu’il tient pour la vie la meilleure à condition qu’il respecte à son tour le droit d’autrui à faire de même. Les règles qui fondent l’association politique peuvent ainsi en principe être acceptées par tout citoyen, quelle que soit sa conception ultime du bien. En revanche, un tel libéralisme n’a rien à voir avec le néolibéralisme d’une Thatcher ou d’un Reagan, et son principe d’« État minimal ». Au contraire, Larmore soutient que l’obsession du néolibéralisme pour les dangers présumés d’un État fort et sa défense des libertés individuelles s’aveuglent doublement : sur les sources de la domination réelle, qui sont multiples, en particulier économiques, et sur la nature des libertés individuelles. En se désintéressant de la pauvreté, de la précarité, de la maladie, et donc des conditions concrètes de la liberté individuelle, les néolibéraux font reculer celle-ci.
Or, ce pluralisme des opinions a sa contrepartie dans la conception larmorienne de la pratique philosophique (pratique plutôt que méthode, puisque Larmore soutient que les différends de méthode sont assez secondaires en philosophie). Il y a un ethos libéral de la pensée elle-même. En effet, en philosophie également, les désaccords peuvent difficilement être surmontés. Du fait de la complexité des problèmes, mais aussi parce que chacun réfléchit à partir de convictions qu’il ne peut remettre en cause en totalité, et donc selon une perspective particulière, l’idée de parvenir à un complet accord est chimérique. Larmore formule ce qu’il appelle une « loi de conservation de la difficulté en philosophie » qui veut qu’aucune solution aux problèmes philosophiques ne soit complètement satisfaisante. Certes, la vérité telle qu’elle existe en soi, indépendamment de nos points de vue, est ce que vise à atteindre toute réflexion en philosophie. Mais, étant donné que cette réflexion est ancrée dans une vision du monde, elle doit renoncer à l’idéal d’accord.
Cette variété de faillibilisme diffère entièrement d’un relativisme. Larmore est un philosophe réaliste qui a commencé ses travaux par une thèse consacrée au réalisme scientifique. Pour lui, « la vérité […] ne se laisse pas réduire […] aux conditions sous lesquelles on est en principe capable de la connaître ». Il ne s’agit donc pas de dire, comme les relativistes, que la vérité dépend intrinsèquement du point de vue que l’on adopte. Il est ainsi possible de défendre à la fois l’idée que la vérité qui forme l’enjeu de l’enquête est une et absolue (indépendante de tout point de vue) et que la connaissance de cette vérité, étant donné qu’elle s’enracine dans un héritage, une tradition, une image du monde particulière, donne lieu inévitablement à de « raisonnables désaccords ». En somme, comme l’affirme Larmore lui-même, le fil conducteur de toute sa pensée a été d’accorder une place aux points de vue individuels et à leurs irréductibles désaccords sans nullement sacrifier l’idée d’une vérité absolue (réalisme épistémique) ou de normes qui sont indépendantes de nous et s’imposent à nous (réalisme éthique).

« Bleu, jaune, orange » de Michel Carradel © CC2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
Ce que Larmore retient principalement de la philosophie analytique, c’est l’exigence de clarté, cette « bonne foi des philosophes », comme le dit un de ses auteurs de prédilection, Vauvenargues. La clarté, en effet, permet de rendre sa pensée vulnérable à la contradiction, et donc aux objections, mais cette vulnérabilité est signe de force et nullement de faiblesse. Ce que Larmore retient principalement de la philosophie continentale, dont il a une connaissance intime et approfondie, c’est le caractère inévitablement historique de la raison, tel qu’il a été souligné par Heidegger, Gadamer, Ricœur (mais aussi, dans le camp « analytique », par Bernard Williams ou Alasdair McIntyre). C’est justement cette « conception historicisée de la raison » qui conduit à supposer que la convergence complète des esprits, même rationnels, est un but impossible à atteindre.
Qu’elles concernent donc la vérité, le bien, la justice… les conceptions humaines ne peuvent échapper à un certain pluralisme. Faut-il en conclure que c’est l’individu lui-même qui décide ultimement de ce qui est bon ou juste ? Aucunement. Car Larmore s’oppose également à la conception kantienne de l’autonomie selon laquelle les normes éthiques tirent leur légitimité de ce que le sujet, en tant que sujet rationnel, se les prescrit à lui-même au lieu de les recevoir d’une instance extérieure. Larmore rejette cette idée selon laquelle nous serions nous-mêmes « les auteurs des principes de pensée et d’action auxquels nous nous trouvons soumis » et la conception individualiste de l’éthique qui la sous-tend.
Est-ce à dire – puisqu’il n’existe pas de loi sans législateur – qu’il faudrait revenir, par-delà Kant, à la thèse d’un fondement religieux des normes éthiques, comme l’ont suggéré Schopenhauer ou, plus récemment, Elizabeth Anscombe ? Le philosophe refuse de se laisser enfermer dans une telle alternative. Il convient au contraire de rejeter le principe en apparence évident : « Pas de loi sans législateur ». En réalité, remarque-t-il, il existe des principes que personne n’a institués, par exemple les principes de la logique. Il en va de même pour les principes de notre conduite : « ils parlent d’eux-mêmes » et ne possèdent pas, eux non plus, de « source législatrice ». Cette position peut être caractérisée comme un platonisme à condition de ne pas supposer que les raisons que nous avons d’agir peupleraient quelque royaume situé au-delà de notre monde. Elles sont simplement irréductibles à la fois aux faits physiques et aux faits psychologiques.
Une grande partie de cette discussion est consacrée, comme on peut s’y attendre, à la manière dont Larmore conçoit le moi et la subjectivité. Dans Les pratiques du moi, Larmore a défendu ce qu’il appelait une conception normativiste du moi. Cette doctrine rappelle la conception fichtéenne du moi comme autoposition pratique, ou la conception sartrienne du « pour-soi ». Elle réside dans l’idée selon laquelle le moi est constitué par son rapport nécessaire à lui-même, mais ce rapport n’est pas de nature cognitive (comme l’ont supposé tous les cartésiens) mais pratique. Comme Larmore l’écrit dans son ouvrage coécrit avec Vincent Descombes, Dernières nouvelles du moi, « le rapport à nous-mêmes qui fait de chacun de nous le Moi qu’il est, rapport que personne d’autre ne peut donc assumer à notre place, consiste en ce que nous nous engageons, dans tout ce qui fait partie de notre vie mentale, à suivre des raisons de pensée et d’action ». En somme, nos états mentaux sont de l’ordre d’engagements (commitments, dans la version anglaise du texte) que nous prenons à l’égard de nous-mêmes de penser et de nous comporter en suivant des raisons.

© Jean-Luc Bertini
De manière surprenante, Larmore affirme que le concept de moi en philosophie est un concept « terre à terre ». Il fut pourtant introduit par Descartes et, peu après, en anglais par Locke pour désigner quelque chose qui diffère entièrement de l’homme empirique et ordinaire. Il s’agissait d’une création conceptuelle, avec ses gains (éventuels) et les immenses difficultés philosophiques qu’elle soulève. Quelques-unes de ces difficultés refont d’ailleurs surface dans les déclarations de Larmore. Un des problèmes qui a été beaucoup débattu depuis Locke à propos du moi est la question de ses critères d’identité, si ceux-ci diffèrent de ceux de l’être humain (comme Locke dit qu’ils doivent différer). Jusqu’ici, dans ses publications, Larmore ne se prononçait guère sur cette question, et De raisonnables désaccords marque à cet égard une inflexion : Larmore y prend position plus nettement sur le statut de ce moi « terre à terre ». Il ne faut pas le comprendre comme un ego cartésien distinct de son corps. La solution lockienne est, elle aussi, rejetée, avec sa dissociation entre ce qui fait d’un moi un seul et unique moi et ce qui fait d’un homme un seul et unique homme. Car, nous dit à présent Larmore, ce qu’il entend par « le moi », ce n’est rien d’autre qu’« un aspect de l’individu concret, consistant dans un rapport à soi inhérent à tout ce qui fait partie de sa vie mentale, rapport consistant à son tour à se régler sur des raisons ». Ou encore, « le rapport à soi qui est constitutif d’être un moi n’est […] qu’un aspect ou une dimension de l’individu concret et vivant ». Le moi est un « aspect », une « dimension » de l’homme : voilà qui est philosophiquement nouveau. Nul, parmi les tenants des égologies, n’aurait affirmé quelque chose de ce genre, car l’une des raisons qui présidaient à l’introduction de cette notion était précisément que le moi avait pour but de nous identifier, qu’il était le dépositaire de notre identité véritable.
Si l’on en croit Larmore, au contraire, le moi désignerait plutôt une fonction ou une opération : se rapporter à soi-même, ou plutôt pouvoir se rapporter à soi-même réflexivement, avoir la capacité de le faire. Le moi n’est plus un concept de substance, pour utiliser la terminologie de David Wiggins ; c’est un concept de fonction, au même titre que « professeur » ou « président de la République ». Or un concept de fonction ne permet d’identifier personne ; il ne s’applique qu’à un individu qui est déjà identifié par ailleurs.
Cette solution permet-elle de donner au moi un statut philosophiquement moins problématique ? Il y a des raisons d’en douter. Une fonction (se rapporter à soi-même), on l’a dit, n’a pas d’identité à soi ni ne permet de fonder l’identité à soi. Il doit donc être en principe impossible de dire de cette fonction qu’elle est quelque chose d’identique à soi ou de non identique à soi au cours du temps. On doit alors récuser les expressions « être le même moi » ou « ne pas être le même moi ». Or Larmore continue à les employer. Il affirme, par exemple, que « être le même moi et être le même homme ne sont pas séparables l’un de l’autre ». En réalité, si le moi est désormais un « aspect » de l’individu humain, ou une « dimension » de cet individu, une telle affirmation est dépourvue de sens. En outre, la notion de moi est employée pour des raisons si différentes de celles qui présidaient à son introduction dans les grandes égologies (de Descartes à Husserl), à savoir permettre d’identifier et de réidentifier quelqu’un, qu’il est permis de se demander si l’on ne frôle pas à tout instant l’équivoque pure et simple. Le moi n’a plus aucune des caractéristiques qui lui étaient dévolues traditionnellement : par exemple, avoir une intériorité, être quelque chose d’individuel, persister au cours du temps, être l’objet de la référence du pronom « je ». En effet, qu’en est-il de l’individu humain qui perdrait la possibilité de se rapporter à lui-même réflexivement, par exemple parce qu’il aurait sombré dans un état neurovégétatif ? Il aurait perdu son moi au sens larmorien (en tant que fonction) tout en demeurant le même individu humain. Comment affirmer, dans ces conditions, qu’être le même moi et être le même homme sont inséparables l’un de l’autre ?












