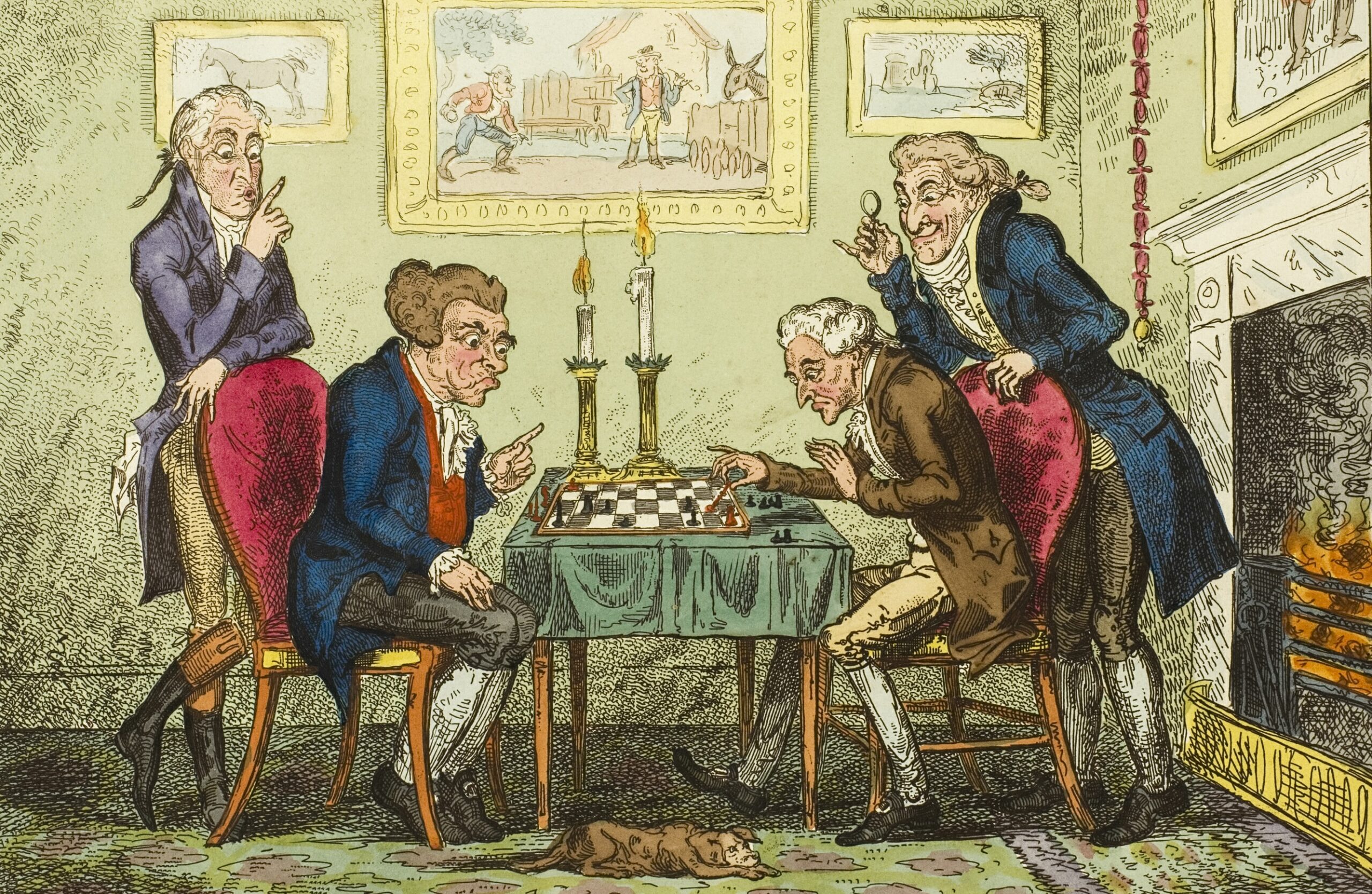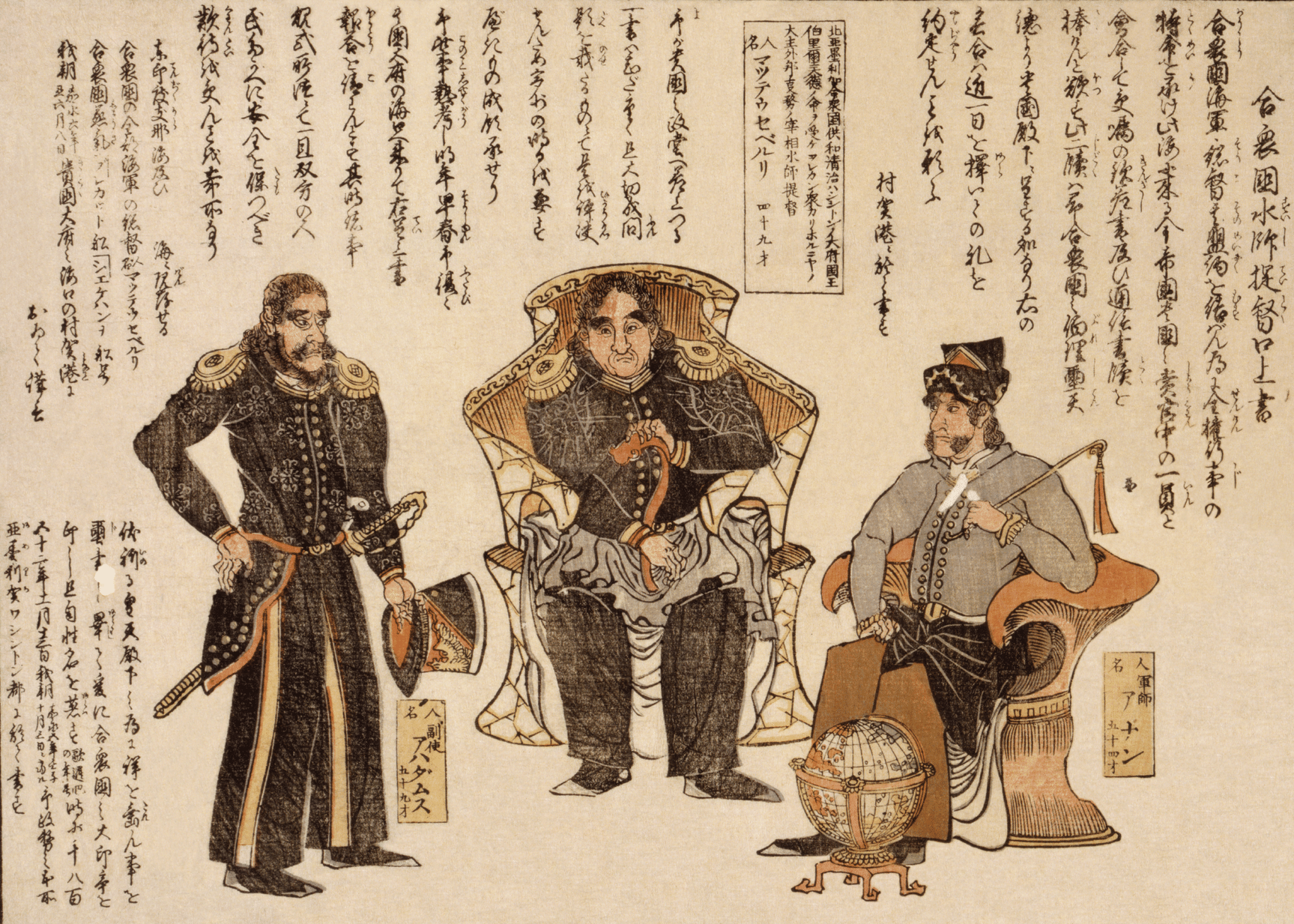Volontiers provocateur, l’auteur de Judaïsme. La généalogie d’une notion moderne, le talmudiste Daniel Boyarin, livre une enquête dans laquelle il montre que le « judaïsme » est un artefact chrétien finalement assumé par les Juifs modernes. Gardant sa puissance interrogatrice, le livre cependant déçoit en ce qu’il semble reconduire subrepticement les problématiques qu’il combat.
Ouvrir un livre de Daniel Boyarin, grand talmudiste et figure originale de l’université de Berkeley, c’est toujours s’attendre à être surpris. C’est vrai encore de son dernier livre paru en 2023 et intitulé The No-State Solution: A Jewish Manifesto (Yale University Press) dans lequel il défend une existence diasporique d’Israël comme nation. Son œuvre commence à être bien connue en français, grâce au travail des éditions du Cerf qui ont notamment publié en 2004 son livre sur le martyre (Mourir pour Dieu. L’invention du martyre aux origines du judaïsme et du christianisme), celui, important, sur « the partition of judaeo-christianity » en 2011, et, en 2013, Le Christ Juif.
L’apport de ses recherches a été décisif dans le changement d’approche, entamé au début des années 2000 par tout un groupe d’historiens réuni outre-Atlantique, qui a bouleversé les études sur les relations entre judaïsme et christianisme entre le Ier et le IVe siècle de notre ère. Boyarin a défendu, pour sa part, alors que le modèle, non plus de la séparation, mais d’un processus lent de « distinction » s’imposait peu à peu, celui, inspiré de la théorie linguistique des vagues ou des ondes, de variations sur un continuum, allant de chrétiens disciples de Marcion, négateurs de tout lien avec la tradition biblique, à des juifs pour qui la « secte » chrétienne ne signifiait absolument rien, d’une « appartenance graduée ». Ce qu’il faut comprendre, pour Boyarin, c’est comment d’un « territoire commun », qui ne se définit pas par une certaine indifférenciation, mais plutôt par une géographie aux frontières mouvantes, laissant précisément cours à toutes les variations possibles, on parvient à la distinction de deux orthodoxies revendiquant pour chacune l’exclusivité de l’héritage biblique.
Dans ce dernier ouvrage traduit en français (paru aux États-Unis en 2018), Boyarin réaffirme des thèses déjà défendues ailleurs, en particulier dans l’introduction de son livre traduit en français en 2011, mais en se concentrant cette fois sur la question du judaïsme. Il répond à sa manière à une interrogation classique de l’historiographie : à partir de quand peut-on parler de « judaïsme » ? Au retour d’exil et avec la reconstruction du temple (fin du VIe siècle avant notre ère), ou bien aux premiers siècles après J.-C. au passage entre Tannaïm, les sages compilateurs de la Mishna et Amoraïm, compilateurs des Talmuds ? Boyarin soutient deux hypothèses : le « judaïsme » est une création chrétienne et il ne devient « religion » que dans ce cadre, renforcé par l’autonomisation moderne des divers « champs » sociaux. Quand le mot « judaïsme » apparaît en contexte biblique, néotestamentaire ou patristique, il a, la plupart du temps, le sens de « judaïser », désignant un ensemble de comportements, celui d’une forme de vie. L’ouvrage va déployer toute une enquête philologique, allant de l’Antiquité à l’époque moderne, pour démontrer ces deux hypothèses.

Quel est, pour Boyarin, l’opérateur essentiel de cette transformation du « judaïsme » en religion ? Le christianisme. Il reprend ici les analyses de plusieurs historiens qui auraient montré que, dans l’Antiquité tardive, au second siècle de notre ère, Tertullien instaure le mot latin religio dans un nouveau sens. Si, pour les Latins, la religio représente l’ortho-piété (entendons par là le juste culte correctement effectué) que l’on doit aux dieux de la cité, et la superstitio une relation déréglée, Tertullien, en se servant du mot, va renverser le rapport entre les deux termes, déclarer superstitio la religio des Latins et désigner le « christianisme » comme « vraie religion ».
Mais il faut évoquer une autre initiative survenue aux alentours de 110 de notre ère : Ignace, évêque martyr d’Antioche, dans une de ses lettres, et cette fois nous parlons grec, emploie le terme de christianismos contraposé à ioudaismos (vocable déjà utilisé par l’apôtre Paul dans le sens ancien de judaïser). C’est la première apparition de ce terme, mais c’est surtout, pour Boyarin, l’indice que la signification de iouadismos a changé. Il devient alors possible de le traduire par « judaïsme », car, jusqu’à cette contraposition avec christianismos, il fut opposé surtout à hellenismos, renvoyant l’un et l’autre aux pratiques d’un peuple, d’un ethnos : les Juifs d’un côté, les Grecs (et tous ceux qui « hellénisent », c’est-à-dire « font les Grecs ») de l’autre. Dans sa lutte contre les chrétiens issus du peuple juif qui jugent compatible reconnaissance de Jésus comme messie et pratique de la Loi, Ignace « invente » un « judaïsme » sans rapport avec la vie des Juifs « réels », il en fait « un outil chrétien » d’instauration d’une frontière, d’une distinction nette entre, non plus des peuples, mais deux orthodoxies.
Pour Boyarin, l’hérésiologie chrétienne construit le « judaïsme » comme son autre « en religion », et ce mécanisme se voit confirmé, amplifié même par l’émergence des sociétés modernes. La première déplace la définition du Juif d’un ethnos et ses traditions vers une théologie, elle-même établie par une autorité séparée du peuple. La seconde, préparée par l’évolution interne du christianisme ‒ avec la Réforme, l’hérésie devient une Église concurrente ‒, entraîne l’apparition d’une « société » distincte de l’Ecclesia médiévale. Cette « société » est elle-même prise, phénomène mis en lumière par la sociologie, dans un processus de complexification croissante qui pousse à la différenciation de plus en plus grande de ce qui devient les différentes dimensions de l’existence humaine, divers « champs » tendant à s’autonomiser les uns par rapport aux autres : l’économique, le politique, le culturel et… le « religieux ». Cette dernière catégorie va recevoir de multiples définitions, anthropologique, sociologique, variables selon les sources dont elles s’inspirent et les adhérences idéologiques de leurs promoteurs, mais ce qui nous intéresse ici, c’est le fait que cette différenciation croissante fait entrer la Modernité dans l’âge des « religions », phénomène en effet inconnu des sociétés anciennes.
Comme le montre Boyarin, le Moyen Âge juif ne connait pas la « religion » juive, mais on pourrait faire remarquer que la chrétienté médiévale ne connaît pas davantage la « religion » chrétienne. Il faudrait ajouter que le Moyen Âge latin ignore également le « judaïsme », mais appréhende « ceux qui observent à la lettre la loi de Moïse, ceux qui judaïsent », selon la formule au XIIIe siècle d’Henri de Suse (cf. Gilbert Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge, Cerf, 1990). Le Kuzari de Yehuda Halevi, au siècle précédent, un des ouvrages essentiels de la tradition juive médiévale, traduit du judéo-arabe en hébreu, ne reconnaît que la dat juive, autrement dit la « loi », au sens de coutumes. Sous les effets croisés de la confessionnalisation et de l’émancipation, la « religion juive », ou encore « la confession juive », va être institutionnalisée sur le modèle des Églises protestantes. C’est seulement alors que le vocable « judaïsme » apparaît, notamment en Allemagne, et Boyarin consacre des pages de son livre à la généalogie linguistique de Judentum.
D’où vient alors, une fois achevée la lecture du livre, le sentiment d’une certaine déception ? D’un effet de surprise émoussé par les nombreuses reprises de choses dites ailleurs ? Il viendrait plutôt de l’impression que cette tentative pour sortir d’une histoire des religions, appauvrie par ses propres instruments d’analyse, reposant, pour l’essentiel sur des oppositions binaires que Gershom Scholem qualifiait de « stériles », se solde par un certain échec. Que les sciences humaines et sociales utilisent à propos des « sociétés » anciennes des concepts inadéquats, à commencer bien sûr par celui de « religion », en tant que domaine distinct de l’existence, et qu’elles aient toutes les peines du monde à les décrire et à les comprendre, fait partie des prises de conscience critiques depuis quelque temps déjà ; que le terme de « judaïsme », dans le sens où nous l’entendons, n’apparaisse pas avant les Temps modernes, nous le savons grâce à Boyarin et à d’autres ; mais à bien regarder le mode de démonstration du spécialiste du Talmud, on s’aperçoit qu’il se fonde sur des oppositions qui reconduisent la catégorisation des sciences des religions contemporaines.

On peut discuter, comme j’ai commencé à le faire à propos du mot « religion » au Moyen Âge latin et des termes dans lesquels ce même Moyen Âge parle du « judaïsme », certaines analyses de Boyarin. En réalité, il semble que l’emploi du substantif ioudaismos soit rare et que l’on trouve le plus souvent dans le grec des Pères le terme de ioudaios/oi. De même pour le destin du mot « christianismos », rare également dans la littérature patristique et médiévale. On le retrouve à l’époque moderne, notamment dans la correspondance des nonces apostoliques – et ce n’est pas un hasard –, quand il aura tendance à remplacer celui de « christianitas » : « alors que la chrétienté était en devenir l’univers entier, le « christianisme » fait l’aveu qu’il est à l’intérieur du monde », écrit l’historien Alphonse Dupront. Quant à la question de l’ethnos, elle souligne bien les embarras du christianisme naissant se revendiquant sans ancrage ethnique et qui, de ce point de vue, propose une « religion » (ou une « philosophie » si l’on parle grec) en rupture avec l’aspect essentiel des « religions » antiques.
L’Ecclesia, l’Église, va constituer ce tertium genus, cette troisième « race », dépassant en principe tous les clivages, ethnique, anthropologique, social, et représentera un « lieu sans lieu » nouveau, dont les institutions seront influencées à la fois par le judaïsme et l’Empire romain. Sans toutefois que cette absence de sol ethnique change la dimension totalisante de la « religion » antique. Le mot « religion » utilisé par Tertullien correspond davantage à un besoin de se faire comprendre des Romains et de défendre la « vraie » religion – et ici le Père latin ne fait que réactualiser ce que Jan Assmann a appelé la « distinction mosaïque » – qu’à une volonté de lui donner un sens nouveau. C’est dans ce type d’analyse philologique que se glisse chez Boyarin un jeu d’oppositions qui l’amène à surinterpréter les textes.
Le concept de « religion », dont le christianisme serait l’initiateur, désigne un « régime de foi », un « engagement personnel », une dogmatique, une « entité qui agit », etc., qui s’oppose aux « doings » (les « faires », les actes, les pratiques), aux « formes de vie » : on reconnaît ici l’opposition entre religion « rituelle » et religion « spirituelle », entre « foi » et « religion » (débat qui a animé les théologiens protestants au début du XXe siècle, mais aussi Martin Buber opposant « religiosité » animant la « religion »), entre extériorité des pratiques et intériorité du cœur, etc. Or, comme le soulignait le grand historien de l’hérésie, Alain Le Boulluec, au moins jusqu’au IVe siècle, « la rectitude de la doctrine est étroitement unie à la vie droite conforme à l’Évangile », l’orthodoxie (ou orthotomia, ouvrir en droite ligne, chez Clément d’Alexandrie) à l’orthopraxie.
À la fin, il faut se poser une question : libérés du « judaïsme » comme invention chrétienne et moderne, que nous reste-t-il ? La description de doings sans « religion ». Libérés du « judaïsme », qui pour Boyarin est toujours déjà un « anti-judaïsme », quel est l’objet des recherches sur l’histoire juive ? Progressons-nous dans la connaissance de l’évolution des diverses « communautés » (écoles, sectes, partis, « judaïsme synagogal, sacerdotal, rabbinique », selon une catégorisation proposée par Simon Claude Mimouni ?) juives, de leur combat interne pour le monopole de la définition de ce qu’est la forme authentique de vie juive, entre la restauration du second temple et la reconnaissance impériale du christianisme ?
Nous devons, écrit Boyarin, nous confectionner un langage scientifique sans « judaïsme », mais n’est-ce pas, tout en étant conscient de l’histoire du mot, courir le risque de postuler une sorte de forma vitae perennis d’un ethnos juif lui-même pérenne, une façon encore plus radicale de délier le judaïsme de son histoire, en revenir à sa dissymétrie d’avec le christianisme (le judaïsme se suffit à lui seul quand le sens même du christianisme en a besoin), l’isolant dans la suffisance parfaite de l’accomplissement quotidien du service de Dieu ? Abandonner l’idée du « terrain commun » sur lequel naissent des « frères jumeaux se tenant par la hanche » (allusion à Esaü et Jacob dans la Genèse) ? Mais peut-être faut-il laisser le dernier mot à Leo Strauss, dans Pourquoi nous restons juifs, qui assignait à la pensée la mission de comprendre jusqu’à quel point allaient ensemble (« question très profonde et très ancienne ») dans l’histoire juive le fait « religieux » – et il rappelait que le mot « religion » n’était pas juif – et celui d’être le peuple d’Abraham, la descendance d’Abraham.