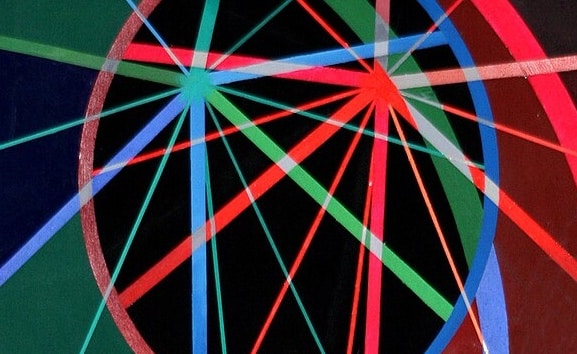Quand, des titres de la presse aux étals de libraires, la dystopie s’étend, il est réconfortant de se plonger dans Terre des sans-patrie de Mahmoud Soumaré. En relatant les rudesses de l’existence des plus démunis, le livre dépeint l’utopie fraternelle née de leur obstination à s’affirmer humains. Avec les armes de l’espérance, le Ravin « sans clocher ni minaret » où une société de gens de rien s’est organisée offre un contre-modèle aux corruptions de « l’Empire Extérieur ».
Contrairement aux fantasmes complaisamment relayés çà et là, les routes migratoires africaines ne mènent en Europe que de façon minoritaire. Environ 80 % de ces migrations se produisent d’un État africain à l’autre. Le roman s’ouvre sur ce fait établi et en rappelle un autre, à savoir les origines historiques coloniales de nombre de ces dynamiques migratoires. Les « sans-patrie » du titre sont des migrants qu’on a fait descendre, dans les années 1950, des terres arides de Haute-Volta (actuel Burkina Faso) vers « le Grand Sud vert et riche : la Côte d’Ivoire » afin de mettre ce dernier en valeur. Peu après les indépendances, ils auraient pu, ainsi que leurs enfants, devenir ivoiriens en vertu du droit du sol. Mais celui-ci « se referme sur eux » en 1972, alors que, restés ignorants de cette possibilité, ils n’ont pas cherché à obtenir, pour eux et leurs familles, la nationalité et le certificat allant avec. Désormais apatrides, les voilà relégués aux marges de la société. Les emplois officiels leur sont fermés, tout logement décent aussi.
Cette marginalité en rencontre une autre : à l’issue du prologue, le premier tiers de ce roman polyphonique se compose d’un entretien entre une femme, Madame Jeannette (qui plus tard relatera sa propre histoire), et un patriarche surnommé Mathusalem ou « Baba Mathus ». Longtemps auparavant, celui-ci, aux premières atteintes de la lèpre, a choisi la route de l’exil, quittant les siens afin de ne pas les contaminer et de ne pas risquer de devenir une charge pour eux. Au terme d’un périple mi-fantastique mi-réaliste, celui qu’on nomme désormais Mathus fait du Ravin, où il s’établit avec des compagnons d’infortune à proximité de la lagune Ébrié, littéralement dans les bas-fonds de la capitale économique ivoirienne, une « terre d’asile et d’espérance ».
« Ici, bien des fois, la nourriture nous manque, l’oxygène social jamais. » Dans les replis obscurs de la société visible s’élabore une utopie faite d’initiatives individuelles généreuses, de micro-gestes solidaires. Ce réseau infrangible repose sur des principes qui prévalent sur l’hypocrite légalité de la société de surface. Ainsi, Baba Mathus, par exemple, n’hésite pas à gruger à millions ceux qui ont les moyens de l’être, pour subvenir aux besoins de la communauté de démunis qu’il a fondée. Les membres de cette communauté qui occupent des emplois subalternes (fille de salle, brancardier, gardien à la morgue) à l’hôpital public exploitent chaque faille du système pour venir en aide aux familles de malades sans moyens. Le monde des « Ravinois » s’oppose en tous points à celui du « quartier des hautains », métonymie de la société des installés qui préfère ignorer ces marginaux. Le groupe de Baba Mathus demeure cependant à distance des exactions des « microbes » installés non loin, ces gamins âgés de six à seize ans qui détroussent les passants en ville, n’hésitant pas à égorger ceux qui résistent.

Quant à Madame Jeannette, c’est une femme généreuse qui se charge d’élever cinq orphelins : Sam, Chem, Lunda et les jumelles Marda et Marda, ces trois dernières ainsi nommées selon le jour de la semaine où elles ont été trouvées, après des pluies torrentielles qui ont dévasté le bidonville et emporté leur famille. La présence de Madame Jeannette au Ravin répond à un concours de circonstances : c’est pour ne pas risquer un retard du fait d’embouteillages le jour de l’examen qu’elle y a sollicité un logement provisoire, car le Ravin jouxte l’hôpital public. Ayant réussi, malgré la corruption ambiante, le difficile concours d’infirmière, elle s’en voit exclue par une clause d’âge pour seulement quelques jours. Elle choisit alors d’exercer comme « fille de salle » afin de toucher un maigre salaire tout en continuant à venir en aide aux autres. Elle doit par ailleurs recourir à des expédients (par exemple, la vente de vieux journaux oubliés en salle d’attente) pour parvenir à nourrir sa nichée, le plus souvent grâce au riz « denicatcha (les enfants sont nombreux) » qui gonfle dans l’assiette. Son histoire, sa formation et le recul que celles-ci lui offrent en font une chroniqueuse privilégiée de cette utopie concrète fomentée par des pauvres, alimentée par des « grimpeurs-ramasseurs » de batteries usagées, inversant les polarités entre la « fosse » et une métropole qui s’étend « quelques centaines de mètres plus haut ».
Entrecroisant les modalités du récit, le roman délaisse par moments la perspective de cette narratrice impliquée pour verser dans un réalisme magique discret mâtiné d’écopoétique, notamment autour des « jumelles prodigieuses » identiquement prénommées et souffrant de drépanocytose, et surtout à travers la figure de « la Petite ». Celle-ci aimante la mémoire et l’imaginaire du patriarche, puis celui des adolescents qui vont alors partir à sa recherche : « Pendant qu’on parlait, deux tortues géantes sortirent de je ne sais où pour venir s’arrêter à ses pieds. “Ce sont mes vrais parents, me dit-elle avec fierté et sourire. Tu vas prendre soin d’eux en attendant notre mariage… Regarde ces souches. Ce sont les restes d’arbres abattus par ceux qui sont éternellement à la recherche d’essences rares. Ceux qui sont venus les couper ont emporté des familles entières de tortues. Ces deux-là ont pu se cacher, ou bien elles étaient en vadrouille loin d’ici. Ce sont monsieur et madame, qui te regardent maintenant avec amitié. Elles ont l’air de dire que tu es manifestement différent des pillards : tu n’as ni fusil ni machette.” »
« La patrie, disent les Soninkés, c’est là où l’on est bien » : « l’Arche des sans-patrie », territoire autonome inventé et maintenu par Mathus et les siens, interroge la fabrique des identités communautaires, dément les fictions morales d’une société en surplomb, oublieuse des valeurs fondatrices. La « fosse » où des humains s’entassent en compagnie d’animaux et de déchets customisés veut réinventer l’humanité en relation. À cette ambition, on pourrait citer de nombreux précédents. Le roman réserve d’ailleurs une place singulière, parmi des références plus surprenantes dans la chanson, le cinéma ou le roman, à Victor Hugo ainsi qu’au sculpteur Ousmane Sow, rendant hommage à Hugo à travers une statue « de plâtre, d’eau et de filasse ». Avec un propos peut-être moins directement politique mais plus radical, Terre des sans-patrie pourrait aussi rappeler La grève des Bàttu (1979) d’Aminata Sow Fall, roman dans lequel les mendiants de Dakar prenaient le pouvoir sur des hommes politiques en quête de leurs bénédictions. Comme la romancière sénégalaise, également autrice, entre autres, d’Un grain de vie et d’espérance (2002), de Festins de la détresse (2005) et de L’empire du mensonge (2017), Mahmoud Soumaré fait fond sur les ressources spirituelles et les aptitudes concrètes des gens de peu.
Mathématicien né à Bamako en 1948 et installé en Côte d’Ivoire, le romancier a été lauréat, en 2016, du Prix Bernard Dadié du jeune écrivain pour sa saga en trois tomes Les marcheurs de Bougreville. Initialement publié en 2023 à Abidjan, aux Classiques africains, Terre des sans-patrie est aujourd’hui en lice pour le prix Ouest-France Étonnants voyageurs qui sera décerné lors du festival à Saint-Malo dans quelques mois. Cette nouvelle édition française a été accompagnée par la « forge littéraire » Ægitna, qui œuvre pour le décentrement de l’édition et de la traduction en favorisant de nouvelles circulations des livres, et, à travers ces derniers, des imaginaires et des perspectives sur le monde.