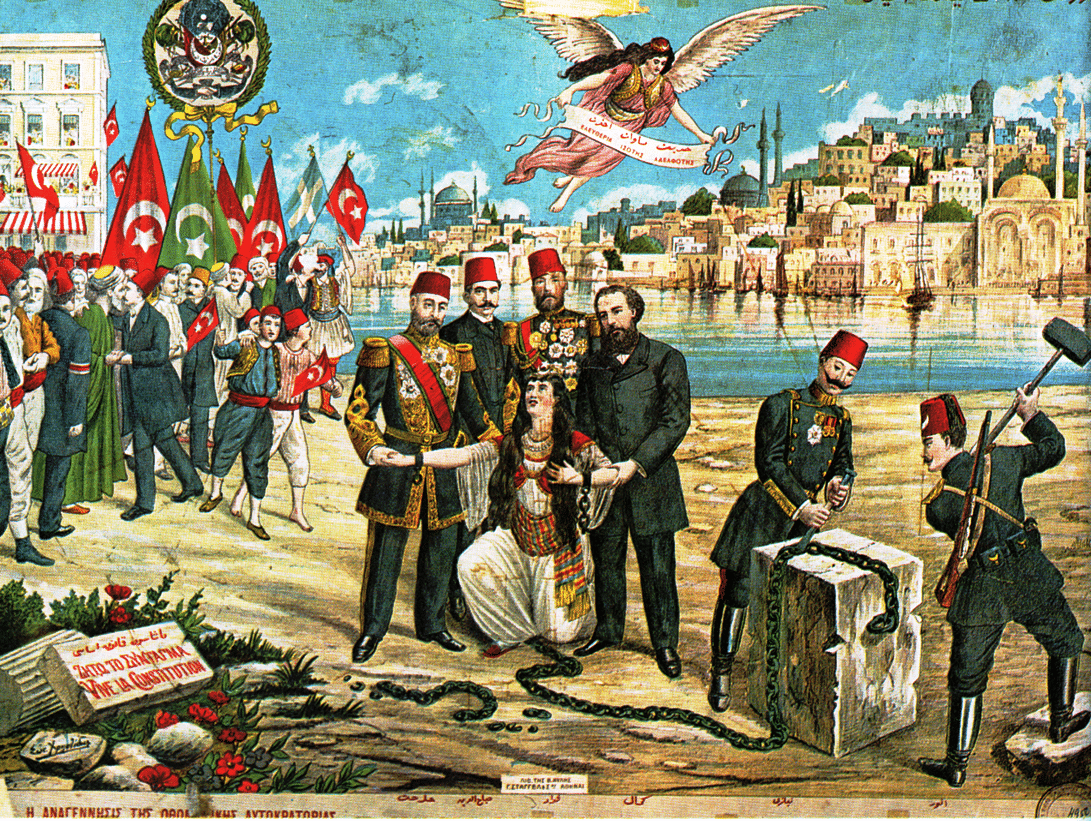L’histoire des éléments naturels, dite environnementale, est encore peu connue en France. Empires. Une histoire sociale de l’environnement, sous la direction de Guillaume Blanc et Antonin Plarier, réunit des articles évoquant des histoires emblématiques sur les transferts de plantes dans les colonies, l’esprit colonial à l’œuvre dans Le Roi Lion, ou la cinquième plus grosse centrale hydroélectrique du monde au Mozambique.
C’est moins une histoire sociale de l’environnement qu’une histoire coloniale de l’environnement qu’étudie cet essai coordonné par Guillaume Blanc et Antonin Plarier. Le premier est professeur d’histoire contemporaine à Science Po Bordeaux, spécialiste de l’histoire de l’environnement et de l’Afrique au XXe siècle. Le second est maitre de conférences en histoire contemporaine à l’université Lyon 3 où il travaille sur l’histoire des mondes coloniaux, l’histoire environnementale et l’histoire sociale. L’objectif des auteurs des articles réunis dans cet ouvrage collectif est de montrer « comment le rapport des sociétés colonisées à leur environnement a été bouleversé par l’irruption coloniale ». C’est ce qui fait de l’histoire environnementale des empires une histoire sociale. Les dénominations comptent dans un ouvrage scientifique où elles délimitent des champs d’étude. Plusieurs contributions ont d’ailleurs été traduites pour rendre accessibles en français « des textes pionniers de cette histoire encore méconnue » et qui évoquent des histoires britanniques et indiennes, portugaises et mozambicaines, françaises et vietnamiennes, allemandes et tanzaniennes. Ce qui les relie, c’est leur manière de se servir de l’approche environnementale pour « renouveler la compréhension des territoires coloniaux ».
L’histoire environnementale est un champ théorique qui a émergé dans les années 1970 aux États Unis. Sous l’inspiration des études féministes et afro-américaines, elle cherche à raconter l’histoire des éléments naturels, grands oubliés de l’histoire officielle. Elle se distingue de ce que les auteurs de cet essai nomment « écologie humaine », expression qui aurait vu le jour en 1925 et désigne l’étude des êtres humains et de leur interaction avec leurs environnements. L’histoire environnementale est complexe car les historiens ont montré qu’elle procédait d’une « étroite association » entre « prédation et conservation de la nature ». D’abord destinées à celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire des empires coloniaux, les contributions présentées dans ce volume peuvent attirer l’attention d’un lectorat plus large ou plus directement intéressé par l’écologie du fait d’exemples emblématiques de cette histoire.

Premier exemple marquant : Le Roi Lion, film des studios Disney qui, selon William Adams, offre « une triste idéalisation de la nature » : « La version édénique d’une nature sauvage et pourtant harmonieuse est synthétisée pour être offerte à la consommation internationale. » Sorti en 1994, ce film d’animation manifeste selon l’auteur de l’article intitulé « L’esprit colonial de la nature » une « présentation racialisée quasi transparente des menaces qui pèsent sur l’environnement en Afrique : c’est par la voix d’acteurs noirs qu’arrivent la destruction, l’absence générale d’intégrité, les pratiques de chasse déraisonnables, la sécheresse et la famine ». Mufasa et Simba sont des souverains idéalisés, impérialistes et paternalistes, observe William Adams qui ajoute que « le sens du devoir que Mufasa tente d’inculquer à Simba fait directement écho au fardeau de l’homme blanc de Rudyard Kipling ».
Deuxième exemple : la figue de barbarie à Madagascar. « Entre le XVIe et le XIXe siècle, les Européens tentèrent à plusieurs reprises de coloniser l’île de Madagascar. Mais le colonisateur le plus efficace du grand sud malgache au cours de cette période fut probablement une variété de figuier de Barbarie. Ce cactus de type Opuntia avait été introduit dans le sud-est de l’île par le conte de Maudave (ou Modave), qui avait essayé d’établir une colonie française à Fort Dauphiné entre 1768 et 1771 », raconte Karen Middleton dans un passionnant chapitre qui explore l’histoire de ce transfert de plante suivant les dynamiques à l’œuvre et les répercussions sur les économies locales. Selon Alfred Crosby, auteur de Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe 900-1900, l’impérialisme européen a trouvé en certains être vivants des alliés écologiques, dont les végétaux européens qui s’acclimatèrent rapidement à leurs nouveaux environnements, souvent pour y devenir invasifs. Cette approche est contredite par celle d’un autre chercheur, John Iliffe, selon qui les Africains ont colonisé une région du monde particulièrement hostile pour le bénéfice de tous les êtres humains. Il met notamment en avant leur capacité à accepter ou rejeter les transferts de plantes européennes. Le chapitre note avec ironie que le transfert de plantes s’est retourné contre le projet impérialiste.
Troisième exemple : le thé d’Assam. « En 1800, la East India Company vendait près de mille tonnes d’un thé de Chine de grande valeur en Angleterre où les classes moyennes et supérieures étaient devenues des inconditionnelles du breuvage », relate Jayeeta Sharma. Dans « Science britannique, savoir-faire chinois et thé d’Assam. La fabrique d’un jardin impérial », la chercheuse met un coup de projecteur sur le rôle des jardins impériaux dans les transferts de plantes dans les colonies tropicales et la constitution de savoirs botaniques. « Le thé, poursuit-elle, cette fameuse « tasse qui réconforte », occupe une place centrale dans cette entreprise d’introduction de plantes exogènes, faisant converger vers lui désirs de science et désirs d’empires. » La plante fait partie de ce qu’on appelait alors les « drogues alimentaires » et qui comprenait des substances stimulantes : sucre, thé, café, chocolat ou cacao. En Inde, les Britanniques ont estimé que les Indiens n’étaient pas capables d’exploiter correctement le thé, alors ils se sont approprié les plantations. Les consommateurs du monde entier poursuivent cette histoire aujourd’hui dans une économie mondialisée où la dévaluation des produits et de la main-d’œuvre rappelle la situation de l’époque coloniale.
Dans l’Afrique orientale allemande, les colons ont affirmé que les populations du futur Tanganyika détruisaient la terre et la faune et ils les ont privées du droit d’accès à la faune. Idem pour le cuivre zambien ou le caoutchouc du Vietnam : scientifiques et colons ont discrédité les savoirs et les pratiques des sociétés colonisées pour légitimer leur exclusion de la société coloniale. Colonisation et exploitation de la nature génèrent des conflits qui nourrissent la troisième partie de cet essai et pourraient préfigurer les nouveaux conflits d’usage liés à la raréfaction des ressources naturelles aujourd’hui. Comme autour de la place de l’eau dans la société zambienne, de la chasse à l’éléphant au Tanganyika, de la récolte de caoutchouc au sud-est du Vietnam pendant la guerre d’Indochine ou du barrage de Cahora Bassa au Mozambique, cinquième plus grosse centrale hydroélectrique du monde. « Les liens étroits entre ce barrage et les préoccupations sécuritaires de l’État colonial sont des éléments fondamentaux de son histoire sociale », résument les auteurs de l’article, Allen Isaacman et Chris Sneddon. Le chantier de construction au début des années 1970 a permis au pouvoir portugais d’éloigner les paysans des opposants à un projet dénoncé comme instrument de l’oppression coloniale. L’histoire de ce barrage est assez documentée en termes de prouesse technologique mais son impact sur les populations, les villages, jardins, pâturages et lagons en aval est resté dans l’ombre. Cet article fait la lumière en explorant cette histoire sous l’angle de « la durabilité des moyens de subsistance ».