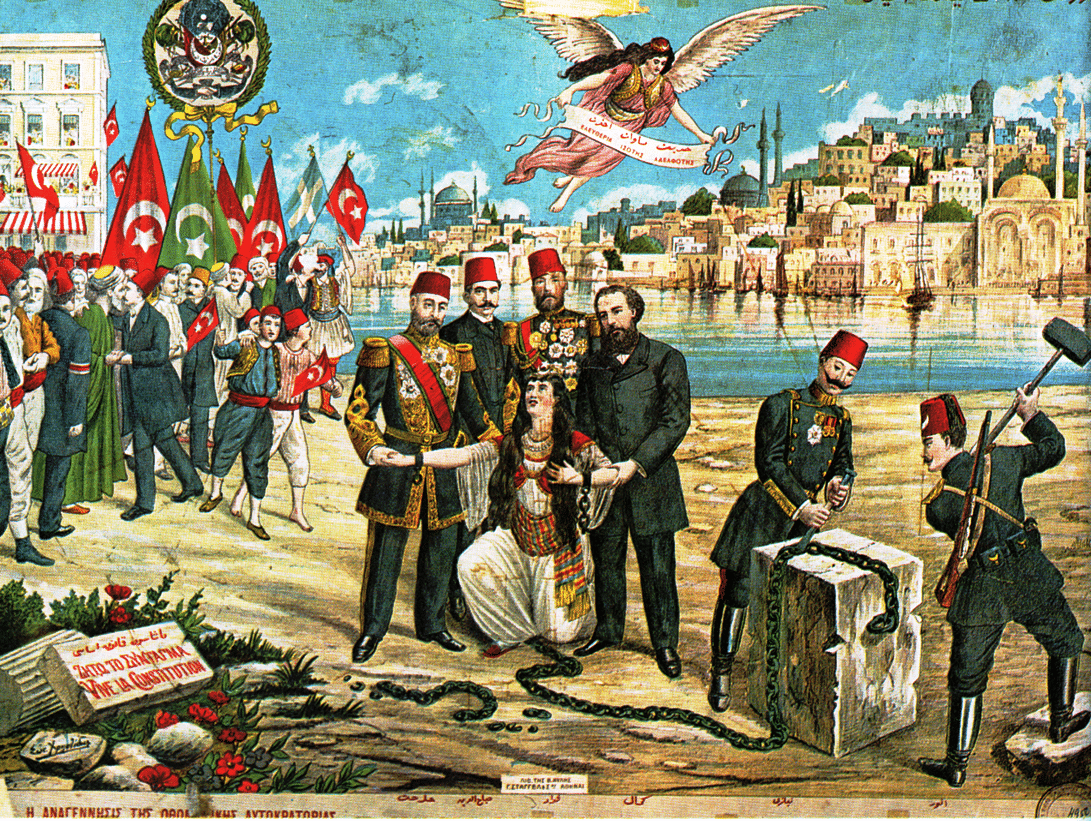La Petite histoire de la maternelle de Fabienne Montmasson-Michel permet de donner épaisseur historique et signification politique à ces institutions désormais familières et répandues : les écoles maternelles. Bien loin d’être, comme les boulangeries, des officines répondant à des besoins immémoriaux, ces bâtiments ont une histoire récente et une portée politique précise que tous les parents, et tous les enfants, ont intérêt à connaître pour mieux appréhender ses effets et ses problèmes. Grâce à ce livre, c’est possible.
Un livre bien utile vient de paraître, issu de l’École (c’est à l’origine une thèse universitaire) mais à elle consacrée et opérant un retour réflexif sur ses propres conditions d’élaboration : non, certes, celles du fonctionnement de l’Université, mais, de manière bien plus radicale, sur ce qu’on pourrait appeler « l’invention de l’école maternelle », ou « de la maternelle ».
Divisé en deux parties d’inégales longueurs, le livre s’attache d’abord, de manière très perspicace, à dégager le modèle de l’enfance qui va devenir l’objet de son institutionnalisation, pour ensuite faire l’histoire et l’analyse théorique des enjeux de cette institution qu’est l’école maternelle, matrice du système scolaire français dans son ensemble et de cette entreprise de « scolarisation », au sens où Ivan Illich l’entendait, qui va donner forme structurelle à une société dans sa globalité : une société scolarisée.
La première partie montre comment est inventé l’enfant « langagier », c’est-à-dire non plus réduit à sa survie mais intégré dans un projet culturel ; la seconde analyse les étapes de l’organisation républicaine du jeune citoyen depuis la prise en charge par les salles d’asile du XIXe siècle jusqu’à la massification de la fin du XXe siècle, sous l’action décisive d’un certain nombre de femmes inspectrices générales comme Marie Pape-Carpantier et Pauline Kergomard dont les noms, à défaut de l’œuvre, peuvent être connus du grand public dans la mesure où ils ont servi à baptiser un nombre considérable d’écoles maternelles. La force particulière du livre réside dans l’attention qu’il porte à la question du langage, vecteur de la formation des identités scolaires, mais aussi de leur hiérarchisation, facteur décisif à la fois d’identités et d’inégalités.
Fabienne Montmasson-Michel, est une ancienne institutrice ayant parcouru tous les échelons de la profession d’enseignante dans le cadre de l’école maternelle. Elle a traversé les différentes réformes de la formation et a rencontré, comme elle le raconte, « la sociologie à plus de quarante ans, [rencontre] qui a été un émerveillement » et dont elle a finalement fait sa profession. Elle constate alors que cette discipline lui a permis de « réaliser ce qui aurait pourtant pu [lui] sauter aux yeux : la difficulté d’apprentissage, c’est du social ». Elle ajoute que ce travail de découverte et la thèse qui en a découlé lui ont permis de « comprendre les logiques d’une société et d’une institution inégalitaires, traversées par des rapports sociaux et leur violence ».

Si l’on apprécie la franchise du propos, on est tenté dans un premier temps de s’interroger sur la naïveté d’un texte publié en 2025, soit plus de cinquante-cinq ans après des textes majeurs – Les héritiers et La reproduction de Pierre Bourdieu (1964 et 67), Vers une pédagogie institutionnelle d’Aïda Vasquez et Fernand Oury (1967), Chronique de l’école caserne de Jacques Pain et Fernand Oury (1972), L’école capitaliste en France de Christian Baudelot et Roger Establet (1970), Le quotient intellectuel de Michel Tort (1974) et quelques autres. Tenant compte de ce moment particulier où se sont précipitées les études sur la nature de classe de l’École capitaliste, française tout particulièrement, faisant suite lointainement à l’étonnant livre d’Edmond Goblot, La barrière et le niveau. Étude sociologique sur la bourgeoisie française moderne, publié en 1925 par un éminent philosophe épistémologue dont les analyses ont imprégné en profondeur tous les travaux critiques ultérieurs, sans que leurs auteurs le reconnaissent (ou le sachent) forcément.
Ces analyses ont eu ensuite un sort particulier, analogue en quelque sorte à celui de la psychanalyse. D’une part, la conjoncture a fait que la veine s’est tarie et que l’assaut n’a pas eu lieu (un livre qui vient de paraître aux PUF, Écoles. Critique matérialiste des appareils scolaires, reprenant des textes inédits des années 1970, en raconte la chronique et avance des explications de cette interruption).
Mais surtout, le tranchant de leur irruption une fois émoussé, ces éléments critiques ont acquis un statut d’évidence, pour ne pas dire de banalité, ils sont devenus une sorte de koinè du discours sur l’École et l’Université, soutenu en cela par la pertinence indiscutable de leur propos (tout enseignant un tant soit peu lucide ne pouvait que reconnaître dans ces descriptions le quotidien et la logique profonde de son travail). Mais ils ont aussi été récupérés à front renversé par les institutions pour alimenter la lancinante lamentation sur l’échec scolaire, malhonnête en ce qu’elle enfourchait la déploration de l’après-68 tout en en travestissant complètement le contenu. La production d’une inégalité et d’une différenciation effective entre les élites et la masse devenait un constat de la faillite prétendument globale de tout un système. Ce qui permettait de mettre dans le même sac des politiques gouvernementales et la supposée incurie ou incompétence des enseignants qui ne cessaient eux-mêmes, pourtant, de dénoncer la situation.
Au plus fort de cette dérive, dominait l’idée que ces analyses politico-sociologiques péchaient par fatalisme et excès de déterminisme. Pendant ce temps, à bas bruit, les multiples expériences de résistance à cet ordre étouffant se poursuivaient au quotidien. Œuvre d’enseignants plus soucieux de faire fonctionner au moins mal l’institution dont ils avaient la charge que d’en mener la critique radicale, raidis sur cette position par le fait que les forces réactionnaires et les tenants de l’école privée et confessionnelle ne se gênaient pas pour faire de cette critique leur cheval de bataille. Sans oublier que c’était d’un tout autre point de vue, inverse, dénonçant non pas l’inégalitarisme de l’école mais sa massification et sa fantasmatique « baisse de niveau ».
C’est dans ce contexte que prend tout son sens le livre de Fabienne Montmasson-Michel. En fait, plutôt que de souligner une naïveté et un retard historique notables, il est beaucoup plus intéressant de faire de sa position un symptôme révélateur du fonctionnement de l’institution dont elle décrit si bien l’histoire. Comme elle le dit elle-même : « cela aurait pu lui sauter aux yeux ». Mais cela ne s’est pas produit : et non par hasard, ou par l’effet d’une cécité individuelle, mais parce que c’est le fonctionnement même de l’École que de produire continûment cet effet d’aveuglement qui fait qu’« on ne voit pas ce qu’il y a à voir » comme le dit Péguy, qui interdit que les évidences qu’on a sous les yeux soient spontanément saisies, vécues et interprétées autrement.
L’une des raisons de cet aveuglement réside dans un aspect sur lequel le livre revient sans cesse (pensons grand livre de Philippe Ariès) : l’objet même de l’école, son centre, son cadre, les catégories qui permettent de nommer ses déterminations et ses fonctionnements essentiels sont fondamentalement des réalités construites, historiquement élaborées et portant en elles les règles ou normes qui semblent ne pas en être séparables. Parmi ces réalités portant en elles en quelque sorte leur mode d’emploi, la plus importante est bien sûr celle de l’enfant ou de l’enfance, Fabienne Montmasson-Michel montre comment, sous les effets conjoints de la démographie et de l’investissement dans le projet d’une gestion plus comptable de la population, l’enfant, qui faisait partie sous l’Ancien Régime d’une masse confuse, profuse et en grande partie vouée à la mort, devient un être langagier à éduquer.
Des repères chronologiques et une bibliographie très riche complètent cet ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre les ressorts profonds de ces institutions où se trame subrepticement, à travers la « fabrique » des enfants, le devenir de notre société et où s’élaborent des scénarios dont la crise actuelle montrent que, pour être prégnants, ils n’en sont pas moins toujours susceptibles d’être écrits autrement.