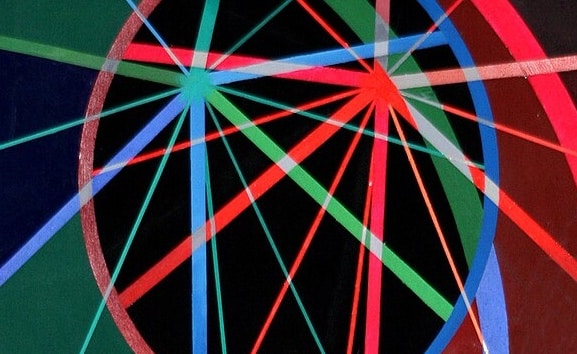Dans Les écrivains collaborateurs. Engagement, stigmate et postérité, Tristan Rouquet retrace la trajectoire de plus de deux cents écrivains avant, pendant et après la collaboration. En recontextualisant la survie tant symbolique qu’économique d’auteurs comme Céline, Drieu la Rochelle ou Rebatet après la Libération, l’ouvrage éclaire d’un jour nouveau les postérités diverses qu’ont connues les écrivains après leur engagement sous l’Occupation. Impressionnante mise au point historique, l’ouvrage fera date.
Dans ce livre, Tristan Rouquet, docteur en science politique, retrace la carrière professionnelle et la survie symbolique des écrivains ayant collaboré sous l’Occupation. « À partir des archives de l’épuration et des Renseignements généraux, des biographies, écrits intimes et dictionnaires biographiques », il met en lumière « les conditions sociales » qui assurent la notoriété de ceux que l’on trouve encore aujourd’hui, par le biais des multiples rééditions de leurs œuvres, aux programmes d’agrégation ou sur les étals des libraires.
Portant sur les « incidences biographiques et bibliographiques de l’engagement dans la collaboration, non pas comme les conséquences mécaniques de la compromission, mais comme un processus social d’assignation identitaire », l’ouvrage analyse l’impact social et professionnel de la collaboration. Se focalisant sur les effets de la compromission sur la carrière des écrivains, il s’inscrit dans le champ de recherche ouvert par Gisèle Sapiro. Dans La responsabilité de l’écrivain (2011), Gisèle Sapiro montrait à quel point les « discours de stigmatisation » des écrivains engageaient, aux yeux des instances de l’épuration, la « responsabilité pénale de l’auteur » ayant légitimé, sous l’Occupation, « la mise au ban d’individus du fait de leur origine, de leur religion [ou] de leurs convictions ».
Inversant quelque peu la perspective, Rouquet s’intéresse quant à lui aux stratégies des auteurs compromis cherchant à reconfigurer, à l’issue de la guerre, leur propre assignation stigmatique dans le monde des lettres. Il fait ainsi ressortir l’inversion symbolique qui suit la Libération : les plumes ayant collaboré tentent désormais de contourner ou, au contraire, d’entretenir leur propre stigmatisation pour « survivre » sur le marché éditorial. De fait, l’ouvrage ambitionne de révéler l’articulation entre « le stigmate de la collaboration et le capital symbolique de ces gens de lettres » d’après leur compromission.
Afin de dresser la prosopographie des écrivains collaborateurs, Rouquet recourt à deux sources qui lui permettent de ne retenir que « les auteurs désignés comme collaborateurs par leurs pairs lors de l’épuration ». Il s’agit, d’une part, de la liste d’écrivains compromis établie par le Comité national des écrivains (CNE), dont plusieurs versions ont paru dans Les Lettres françaises à l’automne 1944, et, d’autre part, de celle du Comité national d’épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs, créé en mai 1945. L’ouvrage s’intéresse ainsi aux épurations symboliques et professionnelles, portant, dans le sillage des travaux d’Anne Simonin, sur les incidences de la répression des faits de collaboration. Les 227 écrivains retenus constituent une population suffisamment large pour permettre d’illustrer la variété des trajectoires et les différentes formes de postérité ou d’oubli.
Dans la période d’après-guerre, différents facteurs influent sur le devenir des écrivains collaborateurs, notamment leur degré d’implication dans de nouveaux réseaux d’extrême droite, ou encore leur capital symbolique avant la guerre, leur âge ou l’aide qu’ils ont reçue (ou non) de la part de différentes maisons d’édition et d’intermédiaires culturels. La « capacité à persévérer dans la matérialité des livres a facilité, à terme, leur réactualisation ».

C’est en outre la situation carcérale, devenue ressource et topos littéraire, qui structure largement la population des écrivains collaborateurs dans leur trajectoire d’après-guerre, distinguant ceux qui écrivent voire publient au temps de leur incarcération, comme Rebatet, Maurras ou Bernard Faÿ, de ceux qui n’en ont pas les moyens matériels. À l’instar des 60 jours de prison de Sacha Guitry (1949), ces témoignages, écrits ou conçus en prison, se fondent en une véritable « prise de position contre l’épuration », en se réappropriant, littérairement, la situation d’incarcération (infamante). Empruntant au modèle générique du récit de prison, la littérature sert en effet de ressource symbolique pour déplacer, voire inverser, les effets de la stigmatisation. D’aucuns font dans le même temps la promotion du retour à la « littérature », entendue comme pratique d’écriture désintéressée, à l’exemple de Lucien Rebatet qui rédige Les deux étendards en détention, roman qui se verra publié dans la « Blanche » de Gallimard en 1952.
En se focalisant sur le processus de stigmatisation, l’ouvrage de Rouquet fait voir le régime de victimisation qui structure la postérité des écrivains collaborateurs sur les plans tant symbolique que littéraire. C’est en effet en « endossant » le stigmate de la collaboration que plusieurs écrivains, comme Jacques Benoist-Méchin ou Marc Augier, constituent une « solidarité victimaire de l’épuration », consolidant les réseaux d’anciens collaborateurs à partir de 1944. C’est, entre autres, le cas de Lucien Rebatet qui renoue, après l’échec critique des Deux étendards, avec la posture du pamphlétaire politique, en signant des articles dans Spectacle du monde ou encore dans Valeurs actuelles. Mobilisés par une large part des auteurs compromis qui continuent de publier après la guerre, les discours victimaires sous-tendent en outre leurs dépositions lors de l’instruction judiciaire, leurs prises de position publiques, leurs plaintes en diffamation après les décrets de grâce et les lois d’amnistie (1951/1953), ainsi que leur activité littéraire. La littérature y devient en effet, elle aussi, un espace qui actualise et concrétise le régime de victimisation. Le stigmate, « labellisation infamante », assure la postérité de ces auteurs, « auréolée du magistère symbolique accordé au statut d’écrivain » et d’une tradition d’écrivains « maudits ».
Or le focus sur la construction dynamique du stigmate, imposée et entretenue après la collaboration, instaure une rupture symbolique qui n’est, en réalité, pas si nette. La continuité de la « carrière éditoriale et professionnelle » que constate l’ouvrage pour une grande partie des écrivains évoqués est également d’ordre idéologique. La volonté de se constituer en victimes, processus d’auto-assignation du stigmate, avait d’ores et déjà caractérisé les politiques littéraires des écrivains avant et pendant l’Occupation. Après la guerre, le stigmate devient une « contrainte », tout en restant une « ressource » qui fait le lien avec la production antérieure d’un Drieu ou d’un Céline.
On a ainsi tendance à sous-estimer, voire oublier, l’impact des décrets-lois Marchandeau – qui ne sont évoqués nulle part dans l’ouvrage – sur l’activité des écrivains collaborateurs avant l’Occupation. Instaurés en 1939 avant d’être révoqués par Vichy en 1940, ils tentaient de remédier à la diffusion de pamphlets antisémites en « articulant la répression de la haine raciste et celle de la propagande d’inspiration étrangère » (Emmanuel Debono), en modifiant la loi sur la liberté de la presse de 1881. Ayant eu un effet provisoire, modeste mais perceptible, sur le débat public, leur abrogation permit aux écrivains antisémites de capitaliser sur leur stigmatisation juridique et symbolique d’avant Vichy. À l’instar de Céline (à qui Rouquet consacre un chapitre entier), ils transposaient leur statut de victimes d’une supposée restriction de la liberté d’expression, souvent structurante dans leurs écrits de l’entre-deux-guerres, en une posture dominante. Pour l’auteur des Beaux draps, la parole pamphlétaire est censée se fonder en opposition aux décrets, comme il l’explique encore en 1941 : « Faudra surveiller son langage. Y a des décrets aussi pour ça. Je suis passé en Correctionnelle, faut pas que ça recommence ! » [1]
Les « postures systématiques de la défense » lors des procès d’épuration reprennent quant à elles le même modèle, constituant leurs clients, à l’instar d’un Lucien Combelle, en victimes de leur condition économique avant et sous l’Occupation. La détention de presque la moitié des enquêtés (103 sur 227) permet, qui plus est, l’« incarnation matérielle » du « stigmate symbolique », amenant José Germain en 1948 à déclarer dans Mes catastrophes, souvenirs qu’il se serait livré « en holocauste des malheurs du pays ».
La Libération ne se caractérise peut-être pas tant « par une inversion des assignations identitaires » que par une forme de temporisation d’une identité littéraire qui reste constante de part et d’autre de la collaboration. L’épuration symbolique installe en effet la stigmatisation dans la longue durée et structure la canonisation des auteurs « maintenus » jusqu’à notre actualité. La transmission de ces auteurs passe par une forme, médiatique et littéraire, qui leur est spécifique : le procès permanent qui remédie à leur pétrification. Si la posture célinienne établit l’écrivain en victime du « complot permanent » (Bagatelles pour un massacre) – qu’il s’agisse de l’Académie Goncourt qui ne distingue pas le Voyage en 1932, la critique « enjuivée » (pamphlets) qui aurait refusé ses ballets ou les instances d’épuration dans la trilogie allemande (D’un château l’autre, Nord, Rigodon) –, on ne s’étonne pas que l’héritage célinien se retrouve aujourd’hui entre les mains de François Gibault, avocat organisant la « défense » de l’auteur.
La « biographie collective » des écrivains collaborateurs qu’offre l’ouvrage permet de déployer la quantité considérable de paramètres ayant joué un rôle dans la survie de certains et l’oubli des autres. Elle nous permet de désacraliser la parole d’un grand nombre d’auteurs, reliant l’idée d’une qualité intrinsèque des œuvres à des variables sociales se trouvant à l’origine de la promotion des « maintenus ». Céline n’est-il pas avant tout celui qui a réuni en son sein tout ce qui permet de subsister : une grande notoriété atteinte avant l’Occupation ; une détention (relativement courte) et un exil vécus dans des conditions qui lui permettent de composer Féerie pour une autre fois (1952) ; l’âge atteint, idéal pour continuer à écrire dans les années 1950 ; et enfin le fait d’investir différents genres littéraires sans oublier d’évoquer le réseau d’intermédiaires culturels et politiques qui assurent la survie de son œuvre ? Défiant les partages faciles entre œuvre et auteur, littérature et politique, la sociologie historique telle que pratiquée par Tristan Rouquet fait magistralement ressortir la complexité de la transmission en littérature.
[1] N. B. : Céline n’a jamais été condamné en vertu des décrets-lois Marchandeau. Il fait ici référence au procès pour diffamation que Pierre Rouquès lui avait intenté après avoir fait l’objet d’une mention personnelle dans L’école des cadavres. L’effet des décrets-lois fut néanmoins réel : son éditeur, Denoël, décida de retirer provisoirement de la vente Bagatelles pour un massacre et L’école des cadavres en 1939.