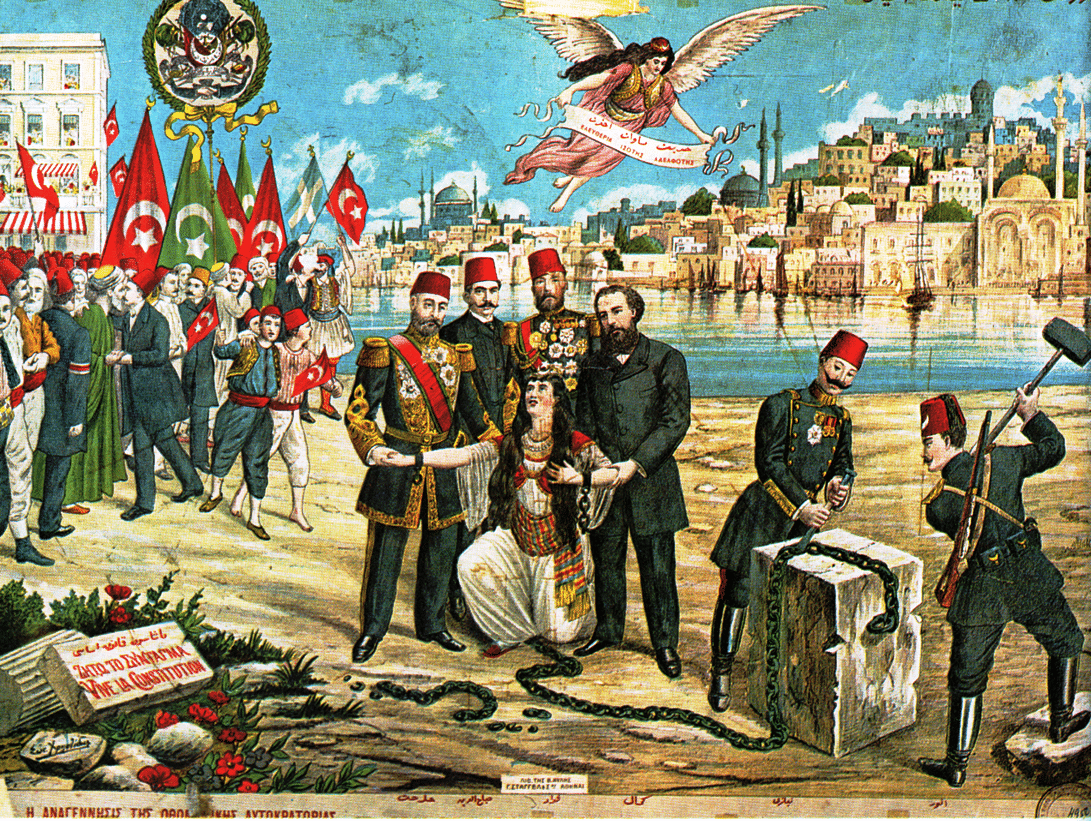Pekka Hämäläinen présente ici un continent nord-américain demeuré indigène pratiquement jusqu’à la moitié du XIXe siècle grâce aux stratégies puissantes de nombre de nations amérindiennes avec les Euro-Américains – de la diplomatie aux guerres de confrontation en passant par des alliances. Un rappel historique indispensable.
« Le mythe de l’Amérique coloniale. » Ainsi nous accueille Pekka Hämäläinen, prévenant qu’il s’agit ici d’« un autre récit… d’une nouvelle vision de l’histoire américaine ». Foin de « la légende tenace » d’un Christophe Colomb arrivé par hasard sur un continent inconnu et de la ruée subséquente d’empires européens attirés par l’appât des terres et de l’or – quant aux Indiens, bien qu’ils aient longtemps résisté, ils auraient finalement été écrasés…
Loin de cette Amérique coloniale imaginaire et de ses suites, ce livre présente l’histoire d’une Amérique indigène, devenue très progressivement coloniale (deux ou trois siècles) et à travers bien des variantes. En 1776, les peuples autochtones contrôlaient donc toujours le continent, réalité ignorée de ces Européens qui aimaient à se croire maîtres de vastes terres et percevaient la réalité à travers le pouvoir de l’État et de sa bureaucratie alors que les nations indiennes la vivaient à travers leurs liens de parenté et les systèmes politiques ainsi induits, dont la guerre et la diplomatie. À maintes reprises, de quoi « réduire à néant ou bloquer les projets coloniaux des nouveaux venus pendant quatre siècles ». Loin de la « généralisation abusive et des œillères du particularisme », l’auteur va décrivant, analysant et mettant en lumière « l’essor et la chute d’un vaste éventail d’univers amérindiens entre la fin du XVe siècle et celle du XIXe ».
Vivaient ainsi d’une part des variétés de peuples – dont de grandes nations et confédérations, véritables empires moteurs de ce qui fut une épopée –, d’autre part plusieurs types de colons et de colonialismes – « de peuplement, de d’extraction ; impérial, missionnaire, commercial et juridique ». D’où la complexité. Lors des hostilités, tandis que « les Indiens l’emportaient une fois sur deux », l’essentiel des atrocités était le fait de colons, coupables de « nettoyage ethnique, de génocide » et d’autres crimes encore. D’où le thème ultime de ce livre, « celui du pouvoir, de la capacité à contrôler l’espace et les ressources, à être à l’initiative des changements ou à leur résister […] une biographie du pouvoir […] aussi bien des colons européens que des Amérindiens ». Pour ce faire, Hämäläinen a organisé cette exploration en huit parties, partant de la « naissance du continent indigène, ou les 70 premiers millénaires » jusqu’à l’ère « des empires équestres », déjà sujet de deux ouvrages de l’auteur, remarquables et remarqués [1].

Avec la dernière ère glaciaire, c’est la naissance, de l’Alaska au Chili actuel, de mondes indiens d’une diversité et d’une résilience stupéfiantes. D’où ces légendes et mythologies toujours vivantes qui expliquent la présence des peuples indiens – Pawnee, Cherokee, Kiowa, Navajo, Sioux, Comanche, Péquot, Shoshone… – sur ces terres d’une Amérique désormais multiethnique.
Prenant à juste titre l’histoire américaine à contrechamp du récit linéaire d’une conquête d’est en ouest, l’auteur l’aborde par le sud et l’ouest du continent. Au début de notre ère, les Amérindiens avaient commencé à domestiquer le maïs, à l’échanger, à construire des réseaux d’irrigation et des cultures en terrasse, à traverser des territoires au fil de voies navigables, chamans et savants les guidant vers l’équilibre de l’univers. Ils s’appelaient Hohokams et Mogollons, ils devinrent des Anassazsi puis des Pueblos.
« De loin, ils paraissent être des géants. » Avec « le long XVIe siècle », les Espagnols surgissent, premiers arrivés et convaincus que ces terres sont vides ou n’appartiennent à personne – vivent alors en Floride trois cent cinquante mille Indiens. L’Espagne pose ses marques écrasantes le long de la côte ouest, jusqu’au nord. Sur la côte orientale, des marins anglais et français débarquent plus tard et, loin de toute doctrine officielle de conquête, envisagent plutôt pour leur part « un système souple de commerce » – produits de la mer et de la terre –, non sans rivalités avec des Italiens, des Portugais, des Espagnols mais surtout et ensuite et jusqu’à la guerre, entre leurs deux pays.
Face à ces Européens auxquels il leur est nécessaire de s’adapter, mais de loin, les Amérindiens recourent à diverses tactiques et stratégies, méfiantes et ingénieuses, visant à échanger, acheter, vendre – éventuellement les uns contre les autres en fonction des Européens avec lesquels ils ont choisi de faire affaire. En 1619, des corsaires anglais livrent les premiers esclaves africains aux colons de Virginie – « deux ans après, on y produisait cent soixante-sept tonnes de tabac ». Grand virage et virage définitif dans la société multi-coloniale du territoire nord-américain.
Rivalités européennes aidant, la colonisation s’étend, les relations euro-amérindiennes se compliquent et inquiètent de part et d’autre – des Amérindiens se rangeront aux côtés des Anglais contre les futurs Américains –, la confédération des Péquots domine « le négoce de la fourrure et du wampum dans la vallée du Connecticut » et refuse tout tribut aux Britanniques. Ainsi survint le premier et emblématique massacre (1637) d’une population et d’une société indigène d’un futur État américain par des Anglais. Répétitives, ces « attaques » traduisent, selon l’auteur, la peur des colons face aux autochtones qui refusent « de se soumettre à leur autorité ». Diagnostic incomplet : il s’agit aussi de la première liberté de rapine et d’extermination pratiquée pour croître et multiplier en paix.

Au XVIIe siècle, « la lutte pour le vaste intérieur de l’Amérique » déclenchée par l’essor spectaculaire de la Ligue des Cinq-Nations et par les Iroquois pour, suite aux épidémies entre autres, restaurer leur rang, leurs forces et leur vitalité spirituelle au détriment de leurs voisins autochtones, en est une excellente illustration. Gagnant en stabilité et en plasticité, ils finissent par imposer aux trois empires européens qui les cernent la paix en Nouvelle-France.
Du côté des Grands Lacs, où les Sioux comptent sur les Français pour les armes et les marchandises, le Pays d’en haut constitue jusqu’au début du XVIIIe siècle une quasi « négation du colonialisme ». Mais les États-Unis ne l’entendant pas de cette oreille, ils découvrent alors ce qu’il en est de l’endurance du continent indigène, qu’ils réduisent : nombre des droits et des privilèges indiens acquis du temps des colonies anglaises disparaissent, la mise à distance se fait impitoyable et les déportations des riches nations amérindiennes du Sud-Ouest détruisent des mondes entiers au long de plusieurs Pistes des Larmes.
« Au cœur du continent », néanmoins, les Américains ayant à connaître de la puissance sioux et comanche, ils doivent reculer. Au sud et à l‘ouest, en revanche – Nouveau-Mexique, Texas, Californie et Oregon –, les résistances indigènes contre d’abord les Espagnols, les Mexicains puis les Américains, pour puissantes et durables qu’elles sont, s’amenuisent et s’effritent avec les déportations manu militari par l’État fédéral, local, et par les milices.
L’intrication de ces mondes, de leurs relations antagoniques et étirées au travers d’immensités rugueuses et richissimes, est offerte par l’auteur sans concession et avec une grande abondance de données. Si la complexité de cette contre-histoire, au demeurant établie par des historiens depuis une trentaine d’années, peut parfois avoir tendance à essentialiser le « continent indigène », elle a le mérite, au long de ces pages très fouillées, de faire advenir l’histoire hors et malgré le mythe. Rien de plus vivant, de plus vivifiant !
[1] L’empire comanche (Anacharsis, 2012) et L’Amérique des Sioux. Nouvelle histoire d’une puissance indigène (Albin Michel, 2022).