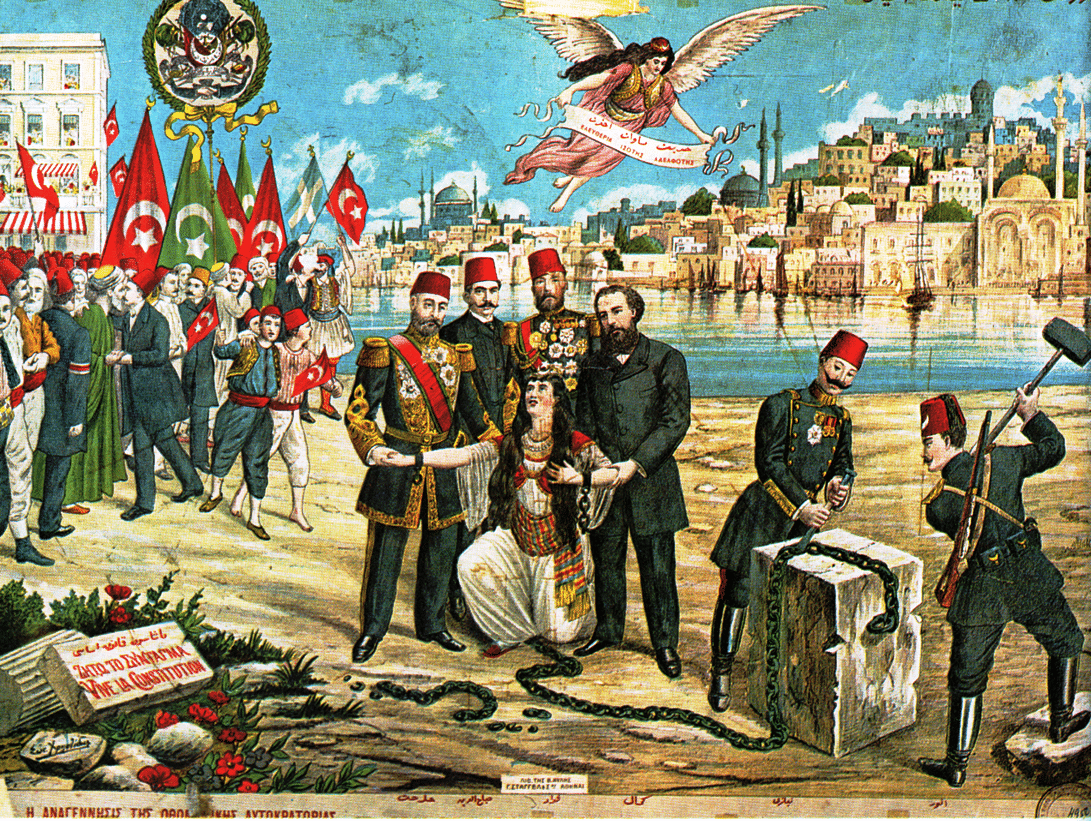Parfois, c’est du passé qu’un souffle d’air frais vient soulever la mince pellicule de poussière qui s’était accumulée sur une discipline sans que ceux chargés de l’entretenir y prennent garde. Sous la direction éditoriale de Fabienne Dumont, les Presses du Réel republient le soixante-dixième livre de l’écrivaine et activiste écoféministe (le mot est d’elle) Françoise d’Eaubonne, Histoire de l’art et lutte des sexes, paru en 1978. La publication cinq ans plus tôt d’Histoire de l’art et lutte des classes, dont l’auteur, Nicos Hadjinicolaou, négligeait un peu trop à son goût les questions de genre, motiva Françoise d’Eaubonne à entreprendre cette incursion hors de ses champs habituels d’intervention, pourtant nombreux.
« Cet ouvrage fait d’elle une Linda Nochlin ou une Carla Lonzi ponctuelle », écrit Fabienne Dumont dans sa préface, sans que l’on sache exactement si la ponctualité dont elle crédite Françoise d’Eaubonne signifie qu’elle tombe à point ou bien que son incursion est restée isolée tant au regard du reste de son œuvre que de celles des autres historiennes de l’art féministes, elle qui « n’appartenait pas au sérail universitaire », rappelle encore Fabienne Dumont. Une position qui a sans doute évité à d’Eaubonne de répéter la liste de ses achievements en préambule de ses essais, contrairement aux figures pionnières de l’histoire de l’art féministe une fois devenues tutélaires.
D’autant que Françoise d’Eaubonne, qui ne lisait pas l’anglais, n’a probablement pas eu accès à « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? », que Nochlin fait paraître dès 1971, inaugurant une longue série d’études féministes sur l’art qui ne font pourtant pas référence à Histoire de l’art et lutte des sexes. Si Griselda Pollock assure quant à elle à Dumont en avoir très tôt mesuré l’importance, elle ne s’y réfère ni dans Maîtresses d’autrefois. Femmes, art et idéologies en 1981, ni dans Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art sept ans plus tard. Gen Doy la cite en revanche au début de Seeing & Consciousness: Women, Class and Representation, en 1995, mais à seule fin de la disqualifier : la « radical feminist » qu’était à ses yeux Françoise d’Eaubonne en faisant selon elle une adversaire du marxisme ; ce qui est un contresens.
De fait, ce dont cette dernière fait grief à Histoire de l’art et lutte des classes, ce n’est aucunement son marxisme, même « vulgaire », comme on disait à l’époque, auquel Hadjinicolaou lui-même consacre d’ailleurs un chapitre critique. Elle lui reproche de ne pas apercevoir que l’art fut d’abord le théâtre de la lutte des sexes avant que n’y surgisse celle des classes : « il faut avant tout commencer à établir, dans la lutte qui de tout temps divisa l’humanité, la priorité chronologique de la lutte des sexes sur la lutte de classes, puisqu’il ne s’agit pas seulement pour les femmes d’avoir été de simples biens de consommation, mais fondamentalement des signes d’échange ». Des signes ironiquement traités, puisque, « chargées de signifier », affirme d’Eaubonne, les femmes « sont donc condamnées à l’insignifiance ».

Cette hypothèse l’amène par conséquent, non pas à remettre en cause le cadre marxiste fixé par Hadjinicolaou, mais à amender certaines de ses analyses, et à en regarder les objets avec des yeux moins prudes. Dans un chapitre dédié à Alain Fleig, l’un des fondateurs en 1971 du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) auquel elle a elle-même appartenu, Françoise d’Eaubonne relève par exemple, à propos du Silène ivre (ca. 1618-1625, Alte Pinakothek, Munich) de Pierre Paul Rubens, que « le personnage le plus important après le dieu de cette scène », qu’elle présente comme un « superbe Africain placé derrière » le Silène, ne lui pince pas la cuisse, comme l’écrit aimablement Hadjinicolaou : « Tout simplement, il le sodomise », écrit-elle, « si fort que le dieu manque en tomber ! », ajoute-t-elle.
Le mouvement qu’impulse l’étreinte amorce en effet au sein de la composition une chute des corps depuis la verticale fournie par l’homme noir vers l’oblique du dieu blanc jusqu’à l’horizontal de la femme aux joues rosies (celles du Silène sont rouges) allaitant à ses pieds deux bébés satyres particulièrement grassouillets, même pour des Rubens. Mouvement qui, dans l’interprétation moins compositionnelle qu’en livre d’Eaubonne, correspond à une répartition agonistique des statuts et des genres : « À l’homme-roi : tous les gestes du plaisir, et le prestige que rien ne peut contester ; à la femelle-mère : la transmission de l’espèce, l’agenouillement extatique devant son maître, l’enfoncement le plus profond possible dans la matière et la chair. Lui fait l’histoire ; elle est l’histoire. »
De même, lorsqu’elle revient plus loin sur trois versions de l’enlèvement de Ganymède – d’après Michel-Ange, chez Rubens à nouveau et dans la version démystifiante de Rembrandt –, Françoise d’Eaubonne peut en conclure que le traitement de ce motif suppose que « seul un dieu peut posséder charnellement un garçon ; à entendre évidemment comme : posséder charnellement un garçon est un plaisir de dieu ». Pareille mise en évidence des ressorts plus ou moins avoués de l’« idéologie imagée », suivant la dénomination de Hadjinicolaou que d’Eaubonne fait sienne, entourant le mythe de Ganymède, dont Erwin Panofsky circonscrivait la dimension homo-érotique au seul Moyen Âge dans La Renaissance et ses avant-courriers en 1960, dresse de surcroît un « parallélisme entre la place réservée à la permission homosexuelle et la condition féminine » qui est, selon Françoise d’Eaubonne, « toujours historiquement significatif ».
Pour féconds que soient donc effectivement cette interprétation d’un point de vue historique et les parallèles qu’elle permet de mettre en évidence, elle souffre cependant de ne pas encore prêter attention à la distribution racisée des rôles, ainsi que le déplore Dumont dans sa préface, sinon sur un mode allusif et daté. Dans l’œuvre de Rubens, le « superbe Africain », en lequel d’Eaubonne voit un « bel athlète d’ébène », est le résultat d’une combinaison de deux des non moins superbes Quatre études de la tête d’un Maure (ca. 1614-1616, musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles) auxquelles le peintre avait déjà eu recours dans La Bacchanale (ca. 1618-1620) de Berlin, une variation sur le même thème réputée perdue depuis 1945. Cet usage récurrent et structurant du « modèle noir », pour reprendre le titre de l’exposition organisée en 2019 par le musée d’Orsay, et plus encore de ce modèle noir en particulier, détermine et trouble simultanément la généalogie des « pages noirs » soumis à leurs maîtres qu’a retracée Anne Lafont dans L’art et la race (également paru aux Presses du Réel la même année 2019), une lignée, écrit l’historienne de l’art, où « désir et distanciation fondent l’altérisation du Noir ».

Or, les Noirs occupent dans l’art occidental qu’étudie Françoise d’Eaubonne une position elle aussi parallèle à celle des femmes, dont « la présence obsessionnelle » en tant que « figures » est « parfaitement symétrique » à leur « absence presque totale » en tant que « personnalités ». Parmi les cas les plus représentatifs que répertorie Histoire de l’art et lutte des sexes, l’autrice compte les odalisques dénudées de François Boucher, lesquelles « manifestaient l’inadmissible prétention d’exciter à la fois le désir pour la chair et l’estime pour la personne ». Une incompatibilité vérifiable y compris au sein des classes supérieures, où « une femme, même de la caste dominante, si elle veut pouvoir montrer son esprit, a le plus grand intérêt à pouvoir exhiber ses fesses », juge Françoise d’Eaubonne à partir de la peinture de la période des Lumières.
Bien qu’elle renonce à l’exhibition sexuée, celle du Premier Empire entérine en revanche la hiérarchie sexuelle qui la motivait. Avec Le Couronnement de l’empereur Napoléon ier et de l’impératrice Joséphine (1807, musée du Louvre) de Jacques-Louis David, « on croit assister à la naissance d’un huitième sacrement : celui de l’abnégation totale et absolue d’une moitié du genre humain se remettant entre les mains de l’autre. L’antique pacte du patriarcalisme est renouvelé solennellement par ce bail ; l’impératrice, fine et ravissante, pareille à une fragile vénus, se remet à Mars corps et âme ». Lorsque, une quinzaine d’années plus tard, David désormais exilé entreprend de peindre cette fois Mars désarmé par Vénus (1824, musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles), peut-être ne fait-il qu’épouser une fois encore un contre-mouvement idéologique, hasarde d’Eaubonne. Mais ce qui est clair dans son esprit, c’est qu’à travers l’une et l’autre de ses « grandes machines », David « a découvert la tension de la lutte des sexes bien plus profondément occultée que l’autre, celle des classes ».
Il n’est guère qu’en temps de crise, déclare Françoise d’Eaubonne, c’est-à-dire « à l’occasion des luttes populaires, luttes de classes ou luttes d’indépendance, que les hommes d’une certaine fraction (pays envahi, classe exploitée) laissent leurs compagnes vivre selon des critères qu’ils se réservent le reste du temps ». L’artiste emblématique de ces moments critiques n’est autre, selon elle, que Goya, c’est-à-dire l’anti-David. Ses femmes sont des personnalités et plus seulement des figures ou des signes, si bien, remarque-t-elle, que « nulle part on n’en voit une supplier l’agresseur ou s’efforcer de le séduire, ni même retenir un époux ou un fils en armes ; ces tableaux sont absents de toute la série des Désastres de la guerre. Ici, point de Sabines ; point, non plus, de femmes d’Horaces ».
La question ayant présidé à ces conclusions semble très éloignée de celles que les historien·nes de l’art posent habituellement à un corpus iconographique : « Comment une si vieille coutume féminine, la guérilla, entre-t-elle en ligne de compte dans le sujet qui nous intéresse, et qu’apporte-t-elle de neuf ? » Elle s’avère pourtant étonnamment pertinente pour saisir pourquoi Goya représente les femmes espagnoles en guérilleras. L’autre question qui la précède paraît cette fois très étrangère aux questionnements inesthétiques de d’Eaubonne et de toutes celles et ceux qui, à la suite de Hadjinicolaou, identifient la notion de style à celle d’« idéologie imagée » : « En Goya, le noir est-il un élément “formelˮ ? », demande l’autrice. Un noir qui correspond pourtant lui aussi aux ténèbres contre lesquels se détachent et luttent dans un même élan les guérilleras de Goya. Aussi l’historienne de l’art « ponctuelle » peut-elle assurer, cette fois sans doute à l’adresse des lecteurs « militants » que visait déjà Hadjinicolaou, en plus des « historiens d’art de “bonne volontéˮ », comme il les désignait, que « cette question d’esthétisme va ouvrir de nouveaux domaines à analyser ».
A priori, l’ouverture précocement ménagée par Histoire de l’art et lutte des sexes est désormais une brèche, tant l’analyse gagne à ne pas dissocier, et moins encore à opposer, pas davantage qu’à les confondre, approches sociales et perspectives formelles. Mais si la méthode est effectivement éclairante, elle ne provoque de véritable arc électrique de portée heuristique que par accident, comme s’il fallait que les conditions méthodologiques soient réunies pour qu’elles produisent un effet que leur réunion ne permettait pas de prévoir.
Ainsi du passage où Françoise d’Eaubonne entrevoit une résonance entre le « Y no hay remedio » (« Et il n’y a pas de remède ») de la planche 15 des Désastres de la guerre de Goya et « le nitchevo des Russes décadents de La Cerisaie » d’Anton Tchekhov, que Françoise Morvan et André Markowicz traduisent par « ça ne fait rien » (La Cerisaie, Actes Sud, 1992), le fatalisme issu de l’extrême brutalité faisant écho, par-delà le siècle qui les sépare, à la résignation printanière pour signifier dans les deux cas la fin d’un monde. « Tout régime condamné », commente de son côté Françoise d’Eaubonne, « exalte le renoncement » ; tout art qui condamne un tel régime, paraît-elle suggérer, exige en retour et en conséquence qu’on pose sur lui un nouveau genre de regard.