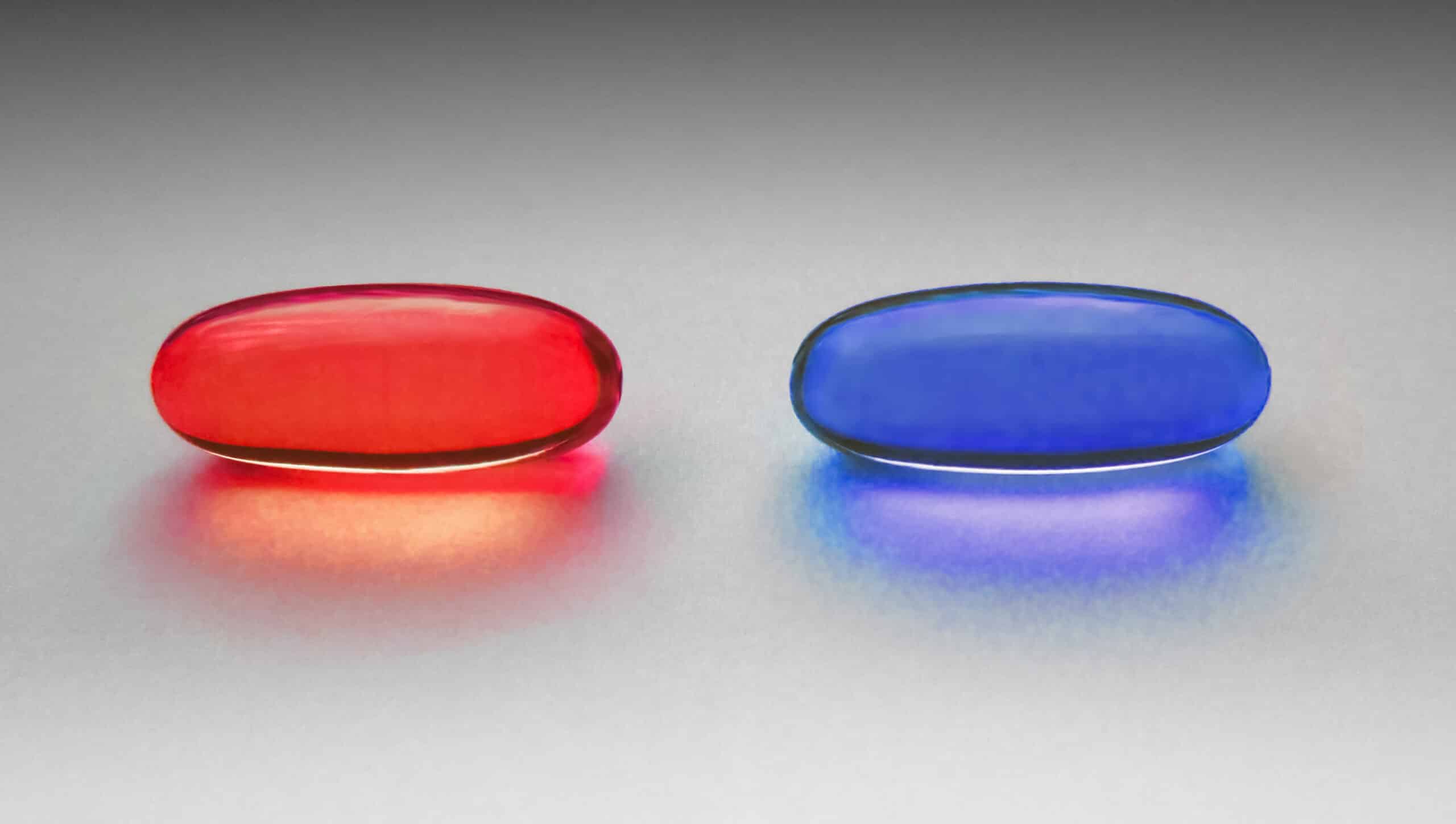Que se passe-t-il lorsqu’une révolution explose et qu’elle n’aboutit pas ? Les énergies mobilisées fabriquent alors les moyens d’une résistance au long cours où les liens permettent de tenir et de construire une mémoire à réactiver plus tard. Riche d’une expérience iranienne élargie par un regard sur les soulèvements des quinze dernières années, Chowra Makaremi recueille ce savoir des affects qui nous aide à résister à la sidération et au déni devant les fascismes. Pourquoi les femmes sont-elles à l’avant-garde de ces mouvements et des pensées qui les portent ? En documentant la créativité de « Femme, Vie, Liberté » par le recueil de ses poèmes et slogans, Chahla Chafiq, dans Un orage de mots, confirme et illustre le propos de Chowra Makaremi dans Résistances affectives.
Certains livres font saisir combien ils nous manquaient, en nous faisant aussi comprendre pourquoi ils nous seront désormais précieux. C’est le cas du nouvel essai de l’anthropologue franco-iranienne Chowra Makaremi, Résistances affectives, dont l’importance s’impose au fil de la lecture. Consacré aux « politiques de l’attachement » des sociétés sujettes aux « politiques de la cruauté » qui défigurent notre monde, il observe les élans et puissances de refus, répliques et ressources de fond mises en œuvre pendant et après les révoltes qui, étouffées ou réprimées dans le sang, ne conduisent pas à un changement de régime mais imprègnent et transforment ces sociétés en profondeur : l’après-vie des révolutions défaites et des insurrections brisées, dont la trame moins visible peut nourrir un réveil ultérieur. Un réveil rempli du souvenir de ceux qui s’y sont brûlés et de la joie d’avoir surmonté la peur, goûté à une vie libre et entrevu un monde possible.
L’autrice recueille en plusieurs endroits du globe où ont explosé des mouvements de masse dans les années 2010-2020 – Iran, États-Unis, Soudan, Chili, Inde, Liban, Syrie – un savoir incarné qui pourrait être profitable à tous, y compris aux populations encore protégées par le dispositif démocratique mais travaillées d’autres maux où s’éteint la puissance d’action : fatigue, impuissance, désorientation, sidération, déni.
Un va-et-vient s’effectue pour comprendre ce qui relie des mouvements tels que Black Lives Matter, Femme, Vie, Liberté, Ni Una Menos, les révolutions soudanaise et syrienne, les résistances des femmes afghanes à leur relégation et des femmes mexicaines au féminicide… Chacun de ces mouvements est replacé dans une histoire et déchiffré dans son code culturel, et c’est à partir de ces spécificités qu’est réalisée leur mise en lien, empêchant les amalgames et les identifications illusoires. Cette attention aux temporalités fait remonter aux décennies antérieures – émeutes en banlieue parisienne de 2005, campagne « Un million de signatures » et Mouvement vert en Iran (2006 et 2009), Printemps arabe tunisien (2010-2011), émeutes de Baltimore et Ferguson en 2014-2015 – et en amont aux années 1960-1980, évoquant la lutte pour les droits civiques, l’Argentine des Mères de la place de Mai et les répressions khomeinistes en Iran.

Chowra Makaremi repère de fortes parentés malgré les enjeux et situations disparates : explosion et propagation d’une indignation causée par une mort intolérable, meurtre ou suicide, qui fait déborder la coupe ; exigence de dignité et de liberté en réaction à une chaîne d’injustices et d’humiliations ; exaltation de la vie, du désir et de la joie à partir d’interdictions, de privations et d’arrachements ; renversement des rites de deuil en protestation collective et hymne à la vie ; soins tenaces donnés aux liens contre les politiques d’atomisation propres aux régimes de terreur ; politiques de présence et parole là où il y a invisibilisation et silenciation, créativité poétique dans l’usage des mots et l’image des corps.
Chowra Makaremi analyse le rôle des femmes et des féminismes à la fois dans ces mouvements de révolte et dans les théories politiques qu’ils inspirent, en se concentrant sur le travail des affects comme puissances de refus, d’affirmation et de persistance, sur l’usage résistant des logiques de parenté et de solidarité, sur la pertinence politique de l’amour. Elle discute ici la tradition rationaliste que suivait Hannah Arendt dans son fascinant dialogue avec James Baldwin, et mobilise les féminismes des années 1960-1970 et ultra-contemporains, noirs et latino-américains en particulier.
Elle cherche à comprendre ce que la forme de ces soulèvements et résistances doit à la durable expérience des femmes, aux désirs radicaux qu’engendrent leurs aliénations multiples en pays patriarcal et en civilisation néo-capitaliste, aggravées par le virilisme de régimes théocratiques ou néolibéraux : refus du règne de la mort et de la désensibilisation propre à toute politique de terreur, effort pour recréer malgré la peur et le mépris une dynamique de vie attachée et agissante. Elle décrit leurs manières créatives d’investir une vie publique interdite, de sortir du ban et d’en faire un point d’appel et d’appui pour réclamer un changement global, d’investir le temps long en résistant aux pièges de la lutte armée et des éclatements régionaux ou ethniques profitables aux pouvoirs meurtriers, de poursuivre en sourdine un affranchissement obligé à la discrétion, parfois à l’exil.
Un regard transversal mais précis est posé sur le rôle des images, scènes, chants, poèmes et gestes symboliques par lesquels un affect partagé se transforme en émotion politique et tourne au soulèvement s’il trouve un terreau sociopolitique adéquat ou un « système nerveux » permettant des « points de bascule » ; puis, avec la répression, la manière dont le collectif empêché fabrique d’autres forces pour ne pas se dissoudre dans le temps, œuvrant au maintien des liens qui font « tenir » et assurent une mémoire et une continuité vivantes.
Ces conduites sont réfléchies et relayées en théorie par l’articulation des divers plans de vie et de transformation du réel, engageant transversalement l’économique, le politique, le culturel et le religieux. Le politique se reconfigure alors comme un indémêlable ensemble d’expériences et de combats de fond, engageant le quotidien des vies de tous, et, plus qu’une abstraite « convergence des luttes », une autre manière de vouloir changer tout et de faire monde déjà. L’enjeu est moins une réinvention de la théorie qu’un ajustement épistémique de la pensée politique par l’observation lucide de ce qui se fait et s’est fait ici et là : un mélange de pragmatisme local et de radicalité globale qui bouleverse le rapport entre public et privé, émotions et rationalité, femmes et hommes, et invite à invoquer une politique de l’attention sensible aux inattentions systémiques ou ciblées, une politique de liens sur le double terrain des sociétés et des épistémès, dans les deux cas à l’échelle locale et mondiale.
Une transversale se trace ainsi entre les endroits du monde où bouillonnent des peuples bâillonnés qui prennent la parole autrement, se réinventent dans des gestes initiés ici et repris là, modulés par une foule d’autres, dans des scènes et formules virales qui passent les frontières. Ce tracé se fait sur différents plans, chaque fois à travers une image : « Cheveux », « Feux », « Systèmes nerveux », « Contre-archives », « Graines », « Cordes », « Voix ». Il est impossible ici de rendre compte des démonstrations que contient chacun de ces sept chapitres, ni du tissage fin que fabrique entre eux une écriture efficace, nerveuse. Il faut dire ce qui se joue d’emblée d’essentiel au premier chapitre, « Cheveux », qui montre à la fois la profondeur du geste révolutionnaire et les effets nocifs de sa « fétichisation ».
Le propos revient à l’Iran de septembre 2022, et part de la transformation du geste féminin de deuil kurde – se couper les cheveux – en geste politique iranien, femmes et hommes ensemble, qui lance le mouvement Femme, Vie, Liberté. Par le détour d’un petit film méconnu d’Abbas Kiarostami, qui montre combien en Iran les cheveux relèvent de l’intégrité de soi dès l’enfance – cette enfance elle aussi saisie comme élan et puissance résistante, fil fugace qui mérite d’être poursuivi –, l’autrice explique combien la résistance se joue comme « mouvement depuis le corps », mais cette fois en bouleversant cette intégrité par le lien à l’autre, conduisant à un « changement de paradigme dans la résistance » : les femmes franchissent la « ligne rouge » des conduites auxquelles une tradition de résistance réformiste s’était tenue depuis des décennies, pragmatisme convaincu d’échec politique et naturalisé en mœurs conservatrices. Elle se coupent les cheveux dans les rues, sur les places, sur Instagram, dans des films viraux. Elles brûlent leurs voiles, dansent et allument des feux – ces « feux » qui, au chapitre suivant, font embrayer sur les pratiques d’immolation déclenchant l’insurrection, et réfléchir sur la manière dont la colère et la joie peuvent se nourrir et se relayer quand une puissance naît de la perte.
Rappelant les spécificités régionales et culturelles de l’Iran insurgé, Chowra Makaremi invite le lecteur français à se « laver les yeux de toute cette après-vie publicitaire du geste », en revenant à l’explosion de colère initiale et à sa propagation accélérée, la synchronisation des colères aboutissant à une forme de pulsation nationale. Elle analyse aussi comment, derrière les écrans et frontières, la fétichisation du geste dissocié des enjeux de la lutte locale permet à tous de s’identifier sans prendre acte de ce qui s’y jouait de brûlant et d’ouvert politiquement. Or cette déconnexion fétichiste, elle le montre avec clarté, est un des points majeurs de désactivation politique dans une société libérale : elle opère lorsque Nike lance des campagnes d’affichage Black Lives Matter dissociées de la réforme de la police et de la justice criminelle par laquelle le racisme systémique anti-noir continue de tuer aux États-Unis. On sait ce qu’il en est depuis la fascisation du pays ; cette déconnexion y aura contribué.
La répétition à vide du geste exaltant, au contraire de liens d’empathie informés et lucides, empêche de penser ensemble les mouvements de révolte et clive les féminismes en traçant une frontière à l’endroit du voile islamique, comme si celui-ci avait la même valeur en Iran et en France en 2022 : malentendu qui nourrit ici un laïcisme aveugle à son héritage colonial et ses pratiques discriminantes – lesquelles sont assumées en Inde contre les minorités musulmanes par un régime nationaliste indexé à l’hindouisme. C’est ce que l’autrice appelle la « seconde vie du fétichisme » : un mouvement au départ indissociable d’une revendication d’égalité pour les minorités (kurdes, baloutches), hostile aux citoyennetés de seconde zone, se retourne en Europe contre les minorités immigrées.
Il faut donc défaire la lutte anti-théocratique des femmes iraniennes et afghanes de ce malentendu fétichiste, et refuser la « désertion stratégique » d’un domaine qu’on estime récupéré, ici par le féminisme laïciste. Car laisser le terrain à ceux qui le manipulent éternise l’impasse. Regarder partout à la fois et ensemble est le seul moyen de ne pas donner prise à « l’ingénierie du silence affectif » partagée en haut lieu. La « politique de l’attention » n’est pas une vague morale universelle mais un exercice de discernement (« qui a le pouvoir de détourner l’attention ? Qui est contraint de la donner sans retour ? »), une « façon de tenir les choses ensemble » en saisissant ce que la visibilité engage de différent ici et là : qui doit rester invisible, et « qui est vu sans l’avoir choisi, surexposé ? ». Perception et attention sont des actes complexes et des « zones de risque » : « il ne suffit pas de devenir visible, il faut pouvoir reprendre la main sur les conditions de visibilité ».

« Reprendre la main », l’expression fait retour, y compris à propos des gouvernements menacés par « l’incroyable fil de la participation féministe », qui poursuivent une « histoire de la suite du monde contre les femmes et sans elles ». C’est au chapitre « Contre-archives », qui montre comment, quand l’affect « expose la structure », nos « vies affectives » deviennent des archives – y compris d’aveuglements à teneur semi-véridictionnelle, comme ceux de Foucault et de la propre tante de l’autrice sur la révolution khomeiniste. Ce contre-archivisme s’appuie sur les analyses d’Arielle Aïcha Azoulay sur les photos interdites de 1947-1948 prises par les soldats israéliens, et de Saidyia Hartman sur les « traces » intimes de l’esclavage. La « zone » y revient à propos des « zones grises historiques » accaparées par les récits officiels et investies par les contre-récits.
La notion-titre de « résistance affective » s’expose dans « Graines », qui pense le temps long de la germination et les moyens de résister à l’érosion et la submersion. L’autrice relie deux poèmes des années 1970, l’un de Forough Farokhzad, (« Croyons au début de la saison froide […] et aux graines emprisonnées »), l’autre de Dinos Christianopoulos (« Que n’as-tu fait pour m’enterrer / Mais tu as oublié que j’étais une graine »), ressuscité cinquante ans plus tard par les féminismes d’Amérique latine, au film récent de Mohammad Rasoulof, Les graines du figuier sauvage, inspiré par Femme, Vie, Liberté. L’image d’une fécondation aérienne et d’un enracinement à rebours dit que la résistance affective est le lieu d’un renversement, qui à la fin fait danser, comme c’est le cas dans tant de films iraniens consacrés aux deux révolutions féministes réprimées par la théocratie, 1979 et 2022.
On retrouve la danse, l’envol, la joie et la graine dans un autre livre précieux qui, publié au même moment par la sociologue Chahla Chafiq, documente la créativité de la jeunesse iranienne : Un orage de mots. La révolution « Femme, Vie, Liberté » dite par celles et ceux qui la font ; recueil de slogans dont chacun est référé à sa source vivante, souvent un poème, à un nom, une histoire et un corps la plupart du temps massacré, mais dont le visage et les mots circulent ensuite. La vie s’affirme à travers le verre d’eau, la fleur rouge, les ailes, l’arc-en-ciel, images qu’on trouvait déjà pour certaines dans les blogs de 2006, dont l’un, signé « Farzaneh Simone », s’intitulait « L’étang de Beauvoir ».
Orage de mots, postfacé par Sylvie Le Bon de Beauvoir, s’appuie sur un féminisme différent de celui de Chowra Makaremi, et leurs pensées diffèrent sur le féminisme islamique. Mais les vers de Farzaneh Simone, « Pour qu’un jour / Mon moi tiré au clair / Accède au calme d’un étang », rappellent le chant sans emphase, retenu et presque serein de Nina Simone écouté par Chowra Makaremi au début de son livre : « O Baltimore, ain’t it hard, just to live ? ». L’anthologie illustre parfaitement la « résistance affective » dont parle celle-ci, et confirme que le renversement se fait au sein même de l’idée de « martyre », chahid : « aujourd’hui, dit Chowra Makaremi, c’est par attachement à la vie qu’on peut se dire prêt à mourir ». Question délicate, tragique, décisive. Autant que reste décisif le geste d’Antigone, revisité au chapitre « Cordes » où se nouent parenté et citoyenneté : elle y évoque les « mères du samedi » kurdes en Turquie, le combat d’Assa Traoré en France, et celui d’Erica Garner aux États-Unis, la fille d’Eric Garner, qui mourut à New York en 2014 sous le genou d’un policier en disant « I can’t breathe ! »
Just to live. C’est sur cette formule que s’ouvre le beau préambule de Résistances affectives, quasi musical, qui associe Téhéran en 2022 et Baltimore en 2015 et en 1968, la ville de la précarité noire en deuil de Martin Luther King, chantée par Nina Simone. Et ce lien passe par le souvenir d’une amie anthropologue disparue trop tôt, Sandrine Musso, qu’on retrouve à la fin du livre, atteinte d’un cancer et secourue par une solide chaîne d’amitiés. C’est à propos du corps massacré de Jina Mahsa Amini, vingt-deux ans, que l’autrice se rappelle le début de la chanson : « Beat-up little seagull / On a marble stair », « Petite mouette cabossée / Sur un escalier en marbre… ». Les Antigones d’aujourd’hui sont souvent de petites mouettes cabossées. Erica Garner est morte d’un arrêt cardiaque à vingt-sept ans, incarnant la double peine des corps noirs masculins et féminins.
Le cœur vibrant de cette réflexion transnationale est une méditation iranienne, nourrie du travail de précision qu’avait réalisé l’essai précédent, Femme ! Vie ! Liberté !, Échos d’un soulèvement en Iran (2023) : chronique presque quotidienne de l’insurrection de septembre 2022 à février 2023, qui ouvrait pour chaque événement un champ historique et analytique permettant de pénétrer la genèse et la dynamique de ce mouvement qui avait enflammé le pays, et qu’avait passionnément vécu à distance une diaspora mondiale en exil.
Telle est la situation de l’autrice depuis sa traduction et son édition française en 2011 du Cahier d’Aziz (Gallimard, 2011), qui lui interdit le moindre séjour en Iran : récit découvert en 2004, où son grand-père maternel avait raconté, dans les terribles années 1980, le quotidien de son foyer déchiré par l’incarcération de ses deux filles, Fataneh et Fatemeh, révolutionnaires de 1978 passées dans l’opposition des « Moudjahidines du peuple » au régime de Khomeini, torturées des jours et des mois durant avant d’être exécutées, l’une en 1982, l’autre en 1988 lors d’un massacre massif de prisonniers politiques. La seconde, Fatemeh, la mère de Chowra Makaremi, fut tuée alors que l’enfant avait huit ans. Le père avait alors déjà pris la route de l’exil en France avec sa fille et son fils. Hitch, « Rien », est le titre de l’émouvant et subtil documentaire où les deux enfants et le père dialoguent autour des objets laissés par la mère, échangeant sur le sens de cette présence-absence dans la vie présente, en un mélange de tension agonistique et d’inconditionnelle complicité [1].

Dans Résistances affectives, Chowra Makaremi revient sur cette histoire familiale, mais de manière infinitésimale, en l’égrenant d’un chapitre à l’autre. Elle apparaît par éclats, sous différents angles, écheveau d’émotions que l’essai déplie en significations partageables. Le mouvement d’approfondissement qui entraîne le lecteur, et à la fin le bouleverse (« Voix »), doit beaucoup à ce centre de gravité intime : il se révèle être le moteur de cette réflexion conceptuelle riche, où l’anthropologie des violences et des résistances ouvre un chantier épistémologique, où des savoirs nocturnes issus des rêves viennent éclairer le savoir diurne. Elle s’interroge sur le sens de cet irrésistible retour à ces années 1980, marquées au sceau des pires cruautés et privations, et sur ce que cette impossible expérience de la disparition a d’épuisant et d’inépuisable.
Mais l’anthropologue le fait au sein d’un travail polycentrique sur les liens qui font vivre et penser, et son effort d’observation et de théorisation fait que ce retour à un vécu abyssal devient lui-même constructeur et producteur de liens. Lorsqu’elle évoque certains rushes abandonnés lors du montage de Hitch, c’est pour aller chercher dans ces chutes, comme elle le fait dans ses rêves, de quoi approfondir le questionnement et élargir le champ. L’image filmique, le déchiffrement des faits sociaux et la réflexion essayistique forment un tout, une œuvre incessamment au travail, servie par une écriture très sûre, fortement visuelle, qui confine par endroits au poétique et réalise le renversement vital analysé : la mobilisation d’énergies capables de transformer une épreuve de perte violente en dynamique de vie, d’invention, de transmission et de création.
L’échelle globale de l’approche, liée à l’existence diasporique d’une chercheuse que son travail fait doublement circuler, s’étaye – par renvois en notes et sans pédanterie – sur une vaste bibliothèque transfrontalière, où le transnational relève d’une modalité théorique et d’une stratégie politique. Héritier d’un féminisme matérialiste qui élabore ses théories à partir d’actions concrètes, le féminisme ultra-contemporain, né de la rencontre critique – ulcérée, mais au travail – des féminismes occidentaux et extra-occidentaux, relie les mobilisations à l’échelle du globe et pense à cette aune la « puissance féministe ». La philosophe argentine Véronica Gago, l’une de celles qui montrent avec force aujourd’hui d’où le « désir de tout changer » vient aux femmes, est citée à côté de Judith Butler, Anne Stoler, Sara Ahmed, Françoise Proust, Nicole Loraux, Somayeh Rostampour, Sarah Ihmoud, Anne Cvetkovich, et beaucoup d’autres, dans une bibliographie nullement exclusive des hommes. Ici aussi le lien domine et la chaîne des sœurs est aussi celle des frères d’Antigone.
Chwora Makaremi est une autrice engagée, qu’on a vue se mobiliser ou manifester pour la Syrie et l’Ukraine autant que pour l’Iran et la Palestine, et qui aime accompagner son travail conceptuel d’actes et de gestes concrets. L’appel transnational à signer la pétition de soutien à la flottille Global Sumud pour Gaza, le 24 septembre 2025, reprenait un des plus précieux passages de ce livre, consacré à la sidération et aux possibilités de la briser par une « contre-politique de l’empathie » [2].
« Le spectacle du génocide nous sidère, mais la destruction n’est pas la fin de tout : elle initie de nouvelles façons de gouverner, et partout dans le monde, bien au-delà de Gaza, de nouveaux sujets dévitalisés, sidérés, paralysés. Qu’on le veuille ou non, la scène se joue à trois : les tueurs, les tués, et les spectateurs. Nous autres, spectateurs, devenons une population réduite à se percevoir, dans la honte et la rage, comme impuissante – prise en son point le plus fragile : la sensibilité à l’obscène, mêlée d’effroi et de fascination ; puis une désensibilisation progressive à ce même spectacle. Cette politique de la cruauté […] cherche à enfermer la subjectivité dans l’abjection, à ne plus pouvoir envisager un futur. Elle vise nos liens, notre capacité d’attachement ; elle isole les individus, rend suspect tout mouvement d’empathie, et intimide toute critique par des menaces tacites mais parfaitement claires. Elle crée un monde où l’appartenance politique se négocie dans un consentement par défaut – un consentement par absence de réaction à la souffrance exhibée. […] Il ne s’agit pas seulement de cacher les crimes et de rendre la souffrance invisible. Ce qui doit rester invisible, cette fois, c’est aussi notre réaction à cette souffrance. Les petites lâchetés auxquelles on nous accule et on nous habitue : ce sont précisément elles qui permettent la mise en place du fascisme. »
Le maintien de cette vigilance à plusieurs échelles et de l’attention portée aux singularités intimes de sa propre expérience donne à Résistances affectives sa tension vibrante et son caractère magistral. Dans ce livre beau, profond et vital, Chowra Makaremi met des mots précis sur les endroits les plus atteints de nos manières de vivre dans le monde tel qu’il est, traversé de violences politiques écrasantes pour les uns, sidérantes pour les autres. Elle le fait en retissant des liens abîmés ou reniés, d’une situation historique à une autre, d’une cause à une autre a priori étrangère, sinon adverse, des liens dits d’« attachement élémentaire » et de sens qui sont au fond d’amour et d’amour de la vie.
Leur caractère viscéral ne leur fait jamais quitter le commun politique : au contraire, il les engage dans l’exigence radicale d’une transformation vitale pour tous. Dans sa propre histoire familiale fracassée, elle va chercher cela aussi : ce qui par l’attachement résiste. En pensant à la fois les raisons de la colère et la joie de se dégager et d’agir ensemble, ce livre fait du bien, aide qui le lit à penser, à ne pas se sentir seul, à vivre dans le monde malgré la rage et la honte, à agir.
[1] Hitch. Une histoire iranienne, 71 min, 2019, Prod. Alter Ego.
[2] « Flottille Global Sumud : ‘Il faut protéger ces citoyens et citoyennes embarqués au nom de la dignité humaine’ », Télérama, 24 septembre 2025. Signé entre autres par Judith Butler, Angela Davis, Elsa Dorlin, Alice Diop, Dominique Eddé, Sepideh Farsi, Véronica Gago, Catherine Malabou…