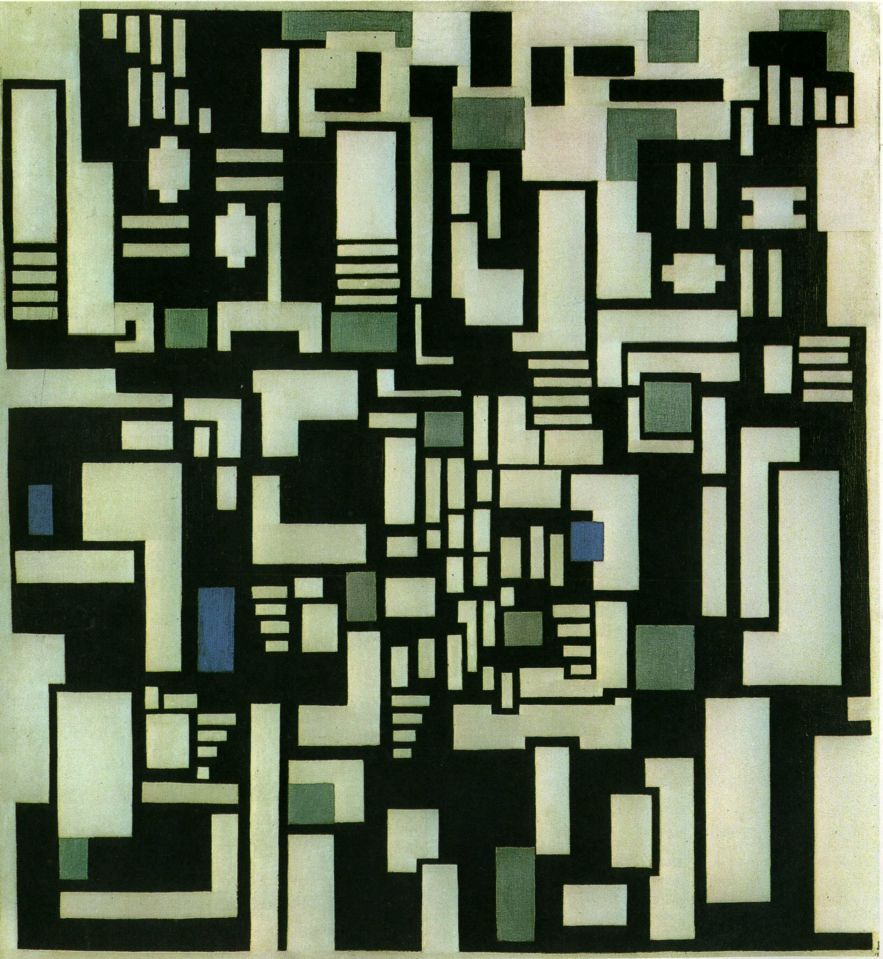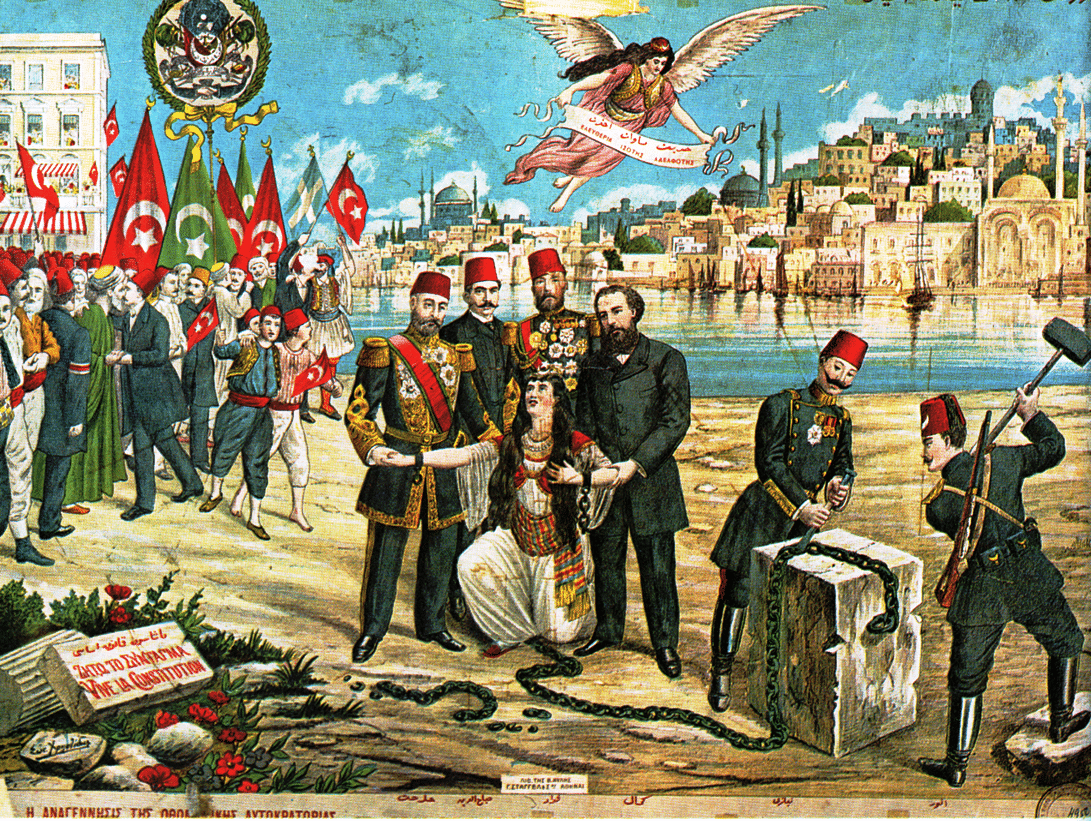La théorie critique est l’une des grandes entreprises intellectuelles du XXe siècle. Elle est pourtant longtemps restée marginale en France, quand elle n’a pas été totalement ignorée : il a fallu attendre les années 2000 pour que les Français prennent au sérieux ce courant de pensée. Clément Rodier fait la lumière sur la réception tardive de l’École de Francfort dans notre pays.
Ils furent les premiers à prendre au sérieux la culture populaire moderne, les premiers à essayer de montrer comment l’industrie culturelle, en produisant à la chaîne de la camelote vendue et consommée comme du chewing-gum, abrutissait les foules, atomisait les individus et sapait la haute culture. Cette thèse un peu outrancière a été tempérée depuis, mais elle n’a jamais manqué d’intérêt. Les Américains, les Argentins et les Italiens l’ont ainsi accueillie à bras ouverts, tandis que les Français ne lui manifestaient qu’indifférence ou dédain.
Cette réaction française est d’autant plus surprenante que la France a été la première terre d’exil de ce collectif intellectuel, réuni au sein de l’Institut de recherche sociale de Francfort. En 1933, pour échapper au nazisme, l’Institut s’installa rue d’Ulm, dans les locaux de l’École normale supérieure, avant de s’envoler vers New York à l’entrée en guerre de la France. L’École de Francfort ne vécut donc que six années à Paris. Mais ces six années furent décisives : elles virent éclore la théorie critique, dans un mélange original de philosophie, de sociologie, de marxisme et de psychanalyse.
Les théoriciens francfortois retrouvèrent dans la capitale française un terreau intellectuel similaire à celui qu’ils avaient quitté. En France aussi, des penseurs essayaient de sauver le marxisme des appels au grand soir et des arguties économiques où il s’ensablait. Ce fut peine perdue. Dédaigné d’un côté par les disciples de Durkheim qui peuplaient la rue d’Ulm, le marxisme critique de l’École de Francfort s’inclina de l’autre devant le marxisme dogmatique de petits tsars staliniens. La greffe de la théorie critique en France fut d’autant plus compliquée que les exilés allemands subirent de front déclassement social, difficultés financières, problèmes juridiques et imbroglios administratifs. Beaucoup, à l’instar de Walter Benjamin, se recroquevillèrent sur leur œuvre.
Le livre rappelle aussi le rôle néfaste joué par Max Horkheimer à partir des années 1940. Véritable despote, il accapara le gros des fonds propres de l’Institut (rescapés de placements boursiers hasardeux), mit un terme à la revue du collectif (parce qu’elle ne servait plus ses desseins personnels) et gaspilla les énergies des uns et des autres (en mettant ses confrères en concurrence pour trouver leurs propres financements). Si bien que l’École de Francfort cessa d’être une école. Elle se réduisit au phare intellectuel formé par Max Horkheimer et Theodor Adorno, qui étouffèrent l’œuvre collective de l’Institut pour mieux faire briller leurs ambitions personnelles.
Horkheimer, Adorno et quelques-uns de leurs collègues vinrent reprendre racine à Francfort dans les années 1950. En quête d’argent pour l’Institut, Horkheimer et Adorno proposèrent leurs services à l’occupant américain et à de grandes entreprises allemandes, et tant pis si cela nécessitait d’élaguer les aspects subversifs de la théorie critique. Ironie du sort, l’expression « École de Francfort » fleurit au moment même où son inspiration initiale était piétinée par ces collaborations. Horkheimer ne s’en plaignit pas, qui fit une belle carrière au sein de l’establishment allemand. Les penseurs radicaux ne sont pas toujours très cohérents, ni toujours très vertueux.

Durant ces années 1940 et 1950, les Francfortois n’eurent apparemment aucun écho en France. Il fallut attendre l’orée des années 1960 pour qu’Adorno et Marcuse fussent invités à la Sorbonne, à l’École pratique des hautes études et au Collège de France. Au même moment, les animateurs de la revue Arguments, parmi lesquels on trouvait Colette Audry, Edgar Morin, Roland Barthes ou encore Kostas Axelos, s’annexèrent l’École de Francfort pour épauler leurs assauts contre l’orthodoxie marxiste. Et pourtant, cette fois encore, le dialogue n’eut pas lieu, et la théorie critique retomba bien vite dans l’oubli.
Selon Rodier, deux raisons expliquent ce nouveau rendez-vous manqué. Tout d’abord, les Francfortois, désespérés par le ralliement d’une grande partie de la classe ouvrière allemande au nazisme, ne considéraient pas le prolétariat comme une force révolutionnaire en puissance – ce qui était, à l’époque, un véritable crime de lèse-Marx. Ensuite, au début des années 1960, les grands esprits français vivaient déjà une idylle avec un penseur allemand, Martin Heidegger, que louangeaient sans retenue Sartre, Merleau-Ponty, Levinas et Derrida, mais aussi des marxistes purs et durs qui l’utilisèrent pour amender les critiques de la technique proposées par Marx. Adorno se priva sans doute du soutien de nombreux intellectuels français quand il blasphéma, dans les lieux saints de l’intelligentsia parisienne, le métaphysicien d’Heidelberg, dont il ne goûtait ni les thèses conservatrices, ni les impardonnables engagements nazis, ni la pensée anhistorique flottant loin au-dessus du monde, ni le style mystificateur. Il n’est qu’à lire son Jargon de l’authenticité (Payot, 1989).
Durant les années 1960, la théorie critique buissonna. Horkheimer devint conservateur, Adorno resta fidèle au projet initial, Marcuse vira révolutionnaire. Cette troisième solution fut la plus populaire en France, où un petit cercle d’intellectuels fit ainsi traduire Marcuse, avant que Mai 68 n’en fît l’équivalent philosophique de Paul McCartney. En deux mois à peine, les libraires vendirent 350 000 exemplaires de L’Homme unidimensionnel. Un chiffre faramineux.
Hélas, si de nombreux étudiants révoltés rejoignaient la critique marcusienne de la civilisation industrielle, peu eurent la curiosité d’explorer la vaste ramure de l’École de Francfort et Mai 68 ne s’accompagna d’aucune floraison théorique d’envergure – Socialisme ou Barbarie s’éteignit en 1967, l’Internationale situationniste en 1969. Marcuse fut brandi comme une icône, mais pas discuté comme un penseur.
La mort de Theodor Adorno, en 1969, marqua la fin de l’École de Francfort. Un an à peine après ce joli mois de mai, l’Institut cessait pratiquement de vivre et le gros de la jeune génération quitta Francfort. Paradoxalement, ce fut à ce moment-là que la théorie critique réveilla l’intérêt des intellectuels français, qui empilèrent les traductions, les publications et les commentaires. À la tête de la collection « Critique de la politique », qu’il fonda aux éditions Payot en 1974, Miguel Abensour fut l’un des chefs d’orchestre de ce duo franco-allemand. Luc Ferry et Alain Renaut contribuèrent aussi à cette mise en musique, même si ce fut en mettant la partition critique au service de leurs sérénades anti-marxistes.
Durant les années 1970 et 1980, la plupart des intellectuels français réduisirent l’École de Francfort à Jürgen Habermas, malgré l’hostilité de cet auteur envers le projet originel de l’École. Si Horkheimer et Adorno critiquaient la Raison, qu’ils assimilaient abusivement au despotisme, Habermas entreprit au contraire de raviver la flamme des Lumières. À ce titre, il critiqua Lyotard, Derrida, Foucault et leurs réductions du discours à un moyen d’oppression, pour montrer au contraire que les démocraties libérales ne peuvent vivre sans discussion publique – Foucault, qui témoigna d’abord un certain intérêt pour l’École de Francfort, s’en détacha quand elle fut associée à la figure d’Habermas.
Depuis deux décennies, après le silence des années 1930 à 1970, après l’annexion des années 1970 à 1980, après le reflux des années 1990, les intellectuels français prennent enfin au sérieux la théorie critique. Grâce aux éditions Payot, Allia et Klincksieck, ils redécouvrent le projet originel de la théorie critique, nettoyé des caricatures et des contresens qui ont obéré ses précédents accueils. Ce faisant, ils redécouvrent aussi les limites de cette pensée, notamment sa méconnaissance des sciences sociales et de l’écologie. Theodor Adorno et Walter Benjamin sont particulièrement à l’honneur, et Siegfried Kracauer est enfin lu sérieusement. Le nouveau directeur de l’Institut de recherche sociale de Francfort, Axel Honneth, est également traduit et discuté. Malheureusement, Erich Fromm et Herbert Marcuse restent quant à eux confinés aux travaux sur Mai 68.
La transplantation longtemps ajournée de la théorie critique en France est une histoire aussi passionnante que désespérante – n’en sortent grandis ni Horkheimer, ni Adorno, ni les intellectuels français. On peut regretter toutefois le style un peu scolaire du livre, où l’on sent encore trop la thèse dont il est issu. La reconstitution des panoramas intellectuels français et allemand est un brin sommaire (Sartre n’est cité qu’une fois, Leo Strauss et Carl Schmitt jamais). Et, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’exercice, elle manque aussi d’épaisseur sociologique (pour expliquer ce rendez-vous manqué, l’auteur aurait pu prendre en compte les singularités du milieu culturel français). Plus surprenant, le propos n’exploite pas d’archives allemandes ni aucun document publié en allemand. Cette histoire des idées, classique et sérieuse, n’en est pas moins une contribution bienvenue à la florissante histoire transnationale des concepts.