Que retenir des années Apostrophes ? Noël Herpe, chaque semaine devant le poste pour assister à l’émission présentée par Bernard Pivot, fait le tour de la question à sa façon, toute personnelle : en parlant des auteurs qui l’ont marqué, sans fard et avec quelques couronnes.
Disons-le d’emblée : Ma vie avec Bernard Pivot s’inscrit dans la droite ligne des livres à la première personne de Noël Herpe : construire un autoportrait à coup de pièces rapportées ; jouer au vivant entre les morts ; jauger, quand ce n’est pas juger, son « je » à l’aune d’autres « je » alentour. On nommera cette posture comme on voudra : farandole intime, comédie du moi, satire autofictionnelle… Elle présente au moins l’avantage de ne pas laisser le lecteur indifférent : elle le happe ou il la zappe !
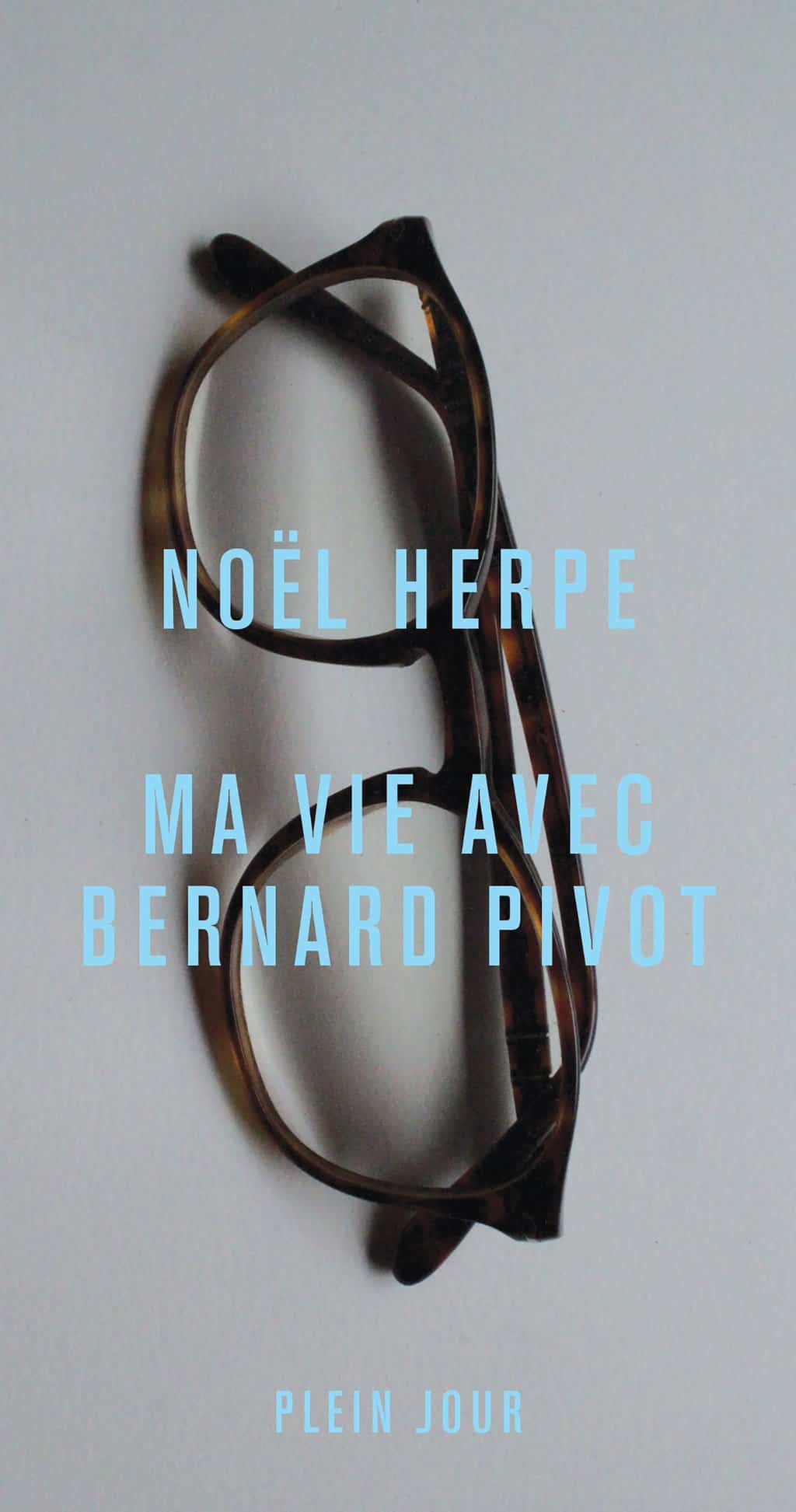
Rembobinons. Pivot a régné sur le monde de la télévision culturelle pendant plus de deux décennies, avec une émission, Apostrophes, qui faisait entrer dans le salon de tout un chacun les écrivains, philosophes, historiens d’un jour, quand ils n’étaient pas d’hier et de demain. Vendredi soir se passait ainsi en compagnie de Simenon, Duras ou Jankélévitch. On regardait et on devisait, on se divisait parfois. La famille s’allumait puis s’agrandissait miraculeusement. C’était comme la scène d’un théâtre d’ombres à laquelle personne n’échappait, à commencer par l’auteur : « Dans mon cœur de téléspectateur déjà vieux, Apostrophes prenait peu à peu la place d’Au théâtre ce soir […]. Le rituel seul de l’émission s’inscrivait dans la tradition de Pierre Sabbagh, en la mettant au goût du jour […] On faisait tous la même chose : déléguer notre destin à des gens plus bavards que nous. On goûtait, dans ce partage un peu veule, la volupté de n’être rien. »
Au vrai, les choix du jeune Herpe, dans ce qui constitue une revisitation subjective de l’émission, se portent moins sur les grands moments que sur les rencontres singulières, les face-à-face entre un jeune homme et un écrivain dont il peut espérer tirer leçons et profit. À cet égard, Herpe tombe plus que de raison sur ses semblables, ou plutôt partage sa sensibilité avec des acteurs doués de la même sensibilité, entendez : penchants, quand bien même ils ne les exposeraient qu’à demi-mots, ou demi-gestes, époque ou génération oblige. Ici, c’est Julien Green qui s’exprime à voix basse, « comme dans un confessionnal » et couve « ses secrets à petit feu ». Là, c’est Pierre Sipriot, le biographe de Montherlant, qui pourfend, pour ne pas dire trahit, la légende et ses masques. D’autres lui apparaissent plus crus, voire cruels, comme Dominique Fernandez, qui révèle à Herpe toute l’étendue de la « mollesse » sexuelle dont il souffre : « Fernandez alla plus loin. Il déclara, comme à mon attention particulière, qu’un jeune homme qui, de nos jours, n’assumerait pas ses désirs homosexuels, serait un lâche. Je pris cette phrase comme un soufflet en pleine figure. »
Herpe choisit donc ses pères, comme d’autres maîtres leur élève, pères qu’il regarde d’ailleurs avec son géniteur, comme si se partageait, ou se divisait, d’un coup d’un seul l’intimité d’un rapport qui bat de l’aile au-dedans et prend son envol, certes timide, au dehors. Herpe et son père, c’est une histoire qui se défait à coup de petite hache symbolique, comme une incompréhension affective. Celui qui est devenu dentiste alors qu’il aurait pu être écrivain préfère Yves Berger à Béatrix Beck et Norman Mailer à Tennessee Williams. Des goûts et des couleurs, il vaut mieux ne pas discuter…

Au-delà ou en deçà de ce « drame » familial, restent quelques portraits de célébrités, ou d’oubliés, de « monstres inédits » qui « devenaient connus de l’homme de la rue », brossés avec l’élégance de la vitesse, sans fard et avec quelques couronnes : Raymond Aron, Sylvie Caster, René Girard, Valérie Valère, ou cette débutante, Élisabeth Barillé, qui vient présenter son premier livre, Corps de jeune fille, et qui se fait humilier en direct par une certaine Ginette Guitard-Auviste, biographe de Chardonne. Inutile de préciser combien cette sorte de duel sied à l’auteur : « Je jouissais de cet affrontement spectaculaire, où l’interdit reprenait forme. » Sans oublier le maître de céans : Pivot lui-même, dans son rôle préféré, qu’il répète à satiété : le tireur de vers du nez !
Ainsi font font font les petites marionnettes d’Apostrophes, et accessoirement de Bouillon de culture (l’émission qui suivit, mais n’eut pas tout à fait le même succès), dont la dernière – marionnette – n’est pas forcément celle à laquelle on s’attendait : l’auteur en personne, qui n’est pourtant jamais passé chez Pivot, mais est bien repassé par chez lui, à coup de magnétoscope et de révision du côté de l’INA. Le voilà qui tire déjà le rideau sur une époque, une façon d’écrire et de parler, d’être et de ne pas être, exposé et protégé. Comme à l’ombre du passé.
(P.S. en forme de morale : à peu près au même moment où je lis Bernard Pivot dans Le Journal du dimanche, qui raconte que son nom a été rayé de la plupart des services de presse « la semaine qui a suivi l’annonce de l’abandon de sa chronique dans le JDD », je reçois le mail d’une attachée de presse qui me demande si je serais intéressé par la lecture de… Ma vie avec Bernard Pivot. Ceci réparant cela !)












