Esquif Poésie (11)
Claude Adelen et Michel Collot n’occupent pas le devant des scènes, ils ne clament pas, ils murmurent : on n’en désire que davantage aller à leur rencontre.
Claude Adelen, Les poètes que j’ai connus. Tarabuste, coll. « Brèves rencontres », 225 p., 12 €
Michel Collot, Épitaphes Épiphanies. Tarabuste, 104 p., 14 €
On connait Claude Adelen pour de multiples raisons : jeune poète adoubé par Aragon, membre actif de la revue Action poétique pendant de longues années, poète et chroniqueur littéraire dans cette revue mais aussi dans La Quinzaine littéraire, L’Humanité, la NRF… C’est en tant que chroniqueur qu’il nous est revenu avant l’été avec un petit livre beige au format de poche, pareil au carnet qu’on emmène avec soi dans ses déplacements, et dans lequel il a rassemblé 27 poètes, que, d’une manière ludique et grave, il a eu envie de se remémorer pendant les mois de confinement, pour se tenir en bonne compagnie d’amitié. Il rédigeait un texte par jour et l’envoyait au poète concerné ainsi qu’à un cercle d’amis, d’amies. Lesquels répondaient et, la plupart du temps, s’enthousiasmaient et encourageaient.
Le résultat est un ouvrage curieux et émouvant, il s’adresse, on le sent à sa lecture, non seulement à l’auteur dont il est question, même quand il a disparu, mais aussi à ceux qu’il a tenus dans la confidence de ses élans, avec qui il a partagé ses souvenirs, ses admirations, sa reconnaissance pour des poètes qu’il considère comme des maitres. Figurent, dans cet assemblage, des talents fort divers, qu’on n’aurait pas toujours l’idée de faire cohabiter, comme Marie-Claire Bancquart et Joseph Julien Guglielmi, et qui « incarnent les tendances les plus représentatives de la poésie contemporaine ».
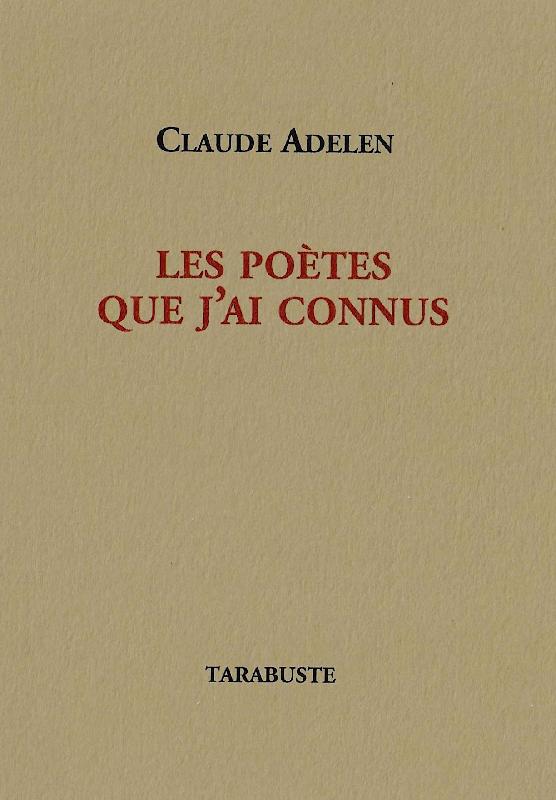
Son critère ? Que ces poètes et poétesses lui procurent, par leurs écrits, L’émotion concrète, définie dans le recueil de chroniques qui porte ce titre (paru aux éditions Comp’Act en 2004). C’est-à-dire une émotion qui ne refuse pas le lyrisme à condition qu’il ne se confonde pas avec la sentimentalité. Le but de ce qu’il appelle modestement « ce petit opuscule » est de montrer que « la lecture de poésie est aussi une lecture affective » ; de pérenniser, autant que faire se peut, des noms parfois déjà disparus des mémoires dans une société « où l’amnésie généralisée ne frappe pas seulement les poètes ».
Ce n’est pas une anthologie, au sens où on l’entend habituellement mais une sorte de manifeste pour la poésie telle qu’il la préfère, et un répertoire d’enthousiasmes qui rassemble des textes rigoureusement construits sur le même modèle et dans le même nombre de pages – aucun n’étant favorisé par rapport à d’autres. Une longue citation du poète retenu, que Claude Adelen a choisie avec soin, précède un texte qui est à la fois une présentation, une analyse, et un rappel des circonstances de leur rencontre, des moments et des motifs de leur amitié, dans une prose qui marie l’émotion et la pensée.
Les vers de Pierre Lartigue sont « comme prononcés dans une langue parlée en rêves » ; Charles Dobzynski « sait faire éclater la grande gaieté grinçante du langage » ; Lionel Ray partage avec lui l’idéal « d’une poésie lyrique, attachée en dépit des fausses modernités, à la présence du Sujet dans le poème » ; Paul Louis Rossi considère que l’écriture « se referme sur un secret initial » ; Gérard Noiret tente, dans certains de ses livres, d’emprunter « la voie royale de l’épopée se confondant avec celle de la confidence » ; Jacques Réda a « une inimitable façon de capturer le surgissement du tragique dans la banalité des mots », cependant qu’« un fleuve de vie et de mots coule » en Jacques Darras.
Claude Adelen est capable de défendre âprement Marie-Claire Bancquart (l’une des rares femmes du recueil, avec Hélène Sanguinetti, Esther Tellermann et moi-même), à qui « les tenants des diverses modernités » faisaient mauvaise presse, ou Yves di Manno, dont l’anthologie (éditée avec Isabelle Garron) suscita bien des rancœurs… Sa présentation de Franck Venaille commence par cette déclaration : « Il m’a toujours semblé, à moi, qu’écrire de la poésie c’était comme parler de l’autre côté des choses » ; et celle de Mathieu Bénézet s’achève par ces mots : « Très tard, Mathieu, mon frère sauvage, nous nous croiserons encore, parmi les fantômes. » Un livre fervent et généreux mais aussi un livre d’écrivain et de poète.

© Delphine Presles
Michel Collot a longtemps enseigné la poésie contemporaine à l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Il donnait à cette époque l’image d’un homme affable et ouvert, capable d’accueillir dans les séminaires qu’il organisait pour ses étudiants des poètes de tendances diverses, de sorte qu’il était difficile de le situer lui-même dans le paysage poétique d’alors, à moins de se pencher sérieusement sur ses publications, dont la première, un essai, date de 1981.
Sa pratique personnelle de la poésie, plus tardive, est moins connue. C’est ce qui arrive à ceux qui consacrent leur attention et leur temps aux autres. D’autant qu’en ce qui le concerne, son enseignement se prolonge tout naturellement par une réflexion sur les poètes qu’il admire et le type de poésie qui le requiert. Ses essais sont nombreux, il publie, dans la Pléiade, le tome II de l’Anthologie de la poésie française, les Œuvres complètes de Jules Supervielle, participe à l’un des volumes consacrés à Francis Ponge, toujours dans la Pléiade ; et, en « Poésie/Gallimard », André du Bouchet, Carnets. Quant aux ouvrages collectifs qu’il a dirigés, on en compte plus de dix.
Il écrit, nous dit-on, de la poésie depuis les années 1970, mais, officiellement, son premier livre de poésie, Issu de l’oubli, publié par Le Cormier, date de 1997. On peut avoir le sentiment, compte tenu de sa discrétion sur sa pratique poétique, du fait que le public n’a pu y avoir vraiment accès qu’à cette date, qu’elle recèle un double peu connu, qui se serait débarrassé des contraintes pesant inévitablement sur un universitaire de renom. C’est du moins ce que j’ai cru découvrir lors d’un récent colloque auquel nous participions tous les deux.
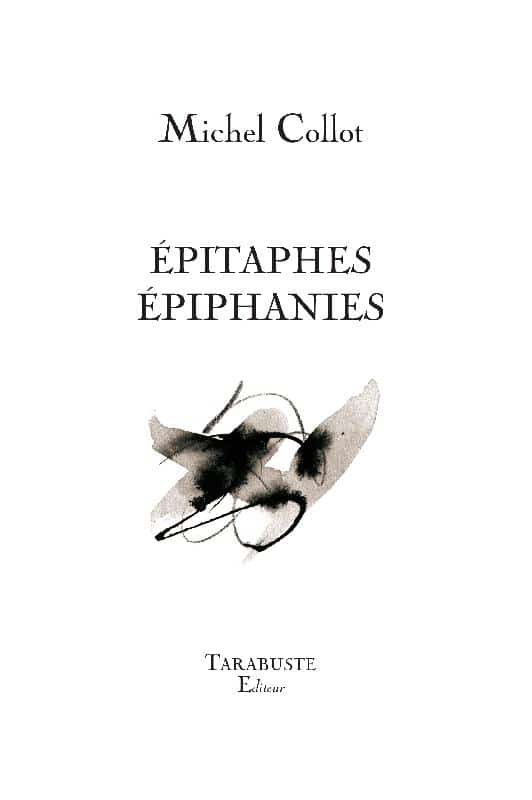
Humour tendre qui sait aussi être corrosif, fantaisie insolente, liberté formelle, telles sont les qualités qui se révèlent dans Épitaphes Épiphanies, ensemble de brèves nouvelles aux accents de poèmes en prose, regroupées en cinq grands chapitres : « Épiphanies », « En blanc et noir », « Épitaphe », « Poèmes (dé)confinés », « En compagnie des œuvres ». Certaines sont gratifiées d’un titre, d’autres pas. Toujours le désir de ne pas figer le vivant, de ne pas aboutir au « tableau de chasse ». De sorte que ce n’est pas l’oiseau aperçu dans les buissons qui est abattu par le coup de fusil du chasseur, mais son observateur qui est « saisi, pris au piège de la merveille », « heureux de n’avoir rien trouvé » qui l’empêche « de rêver et d’écrire ».
De quelques éléments saisis dans un square, un bois, devant la mer, évoqués avec précision (« une boule de poils et de plumes », « les galets […] sertis d’un anneau d’or, comme autant de pierres précieuses », « des plantes qui fleurissent au début de l’été »), destinés à disparaître, à devenir ternes, à faner, il tire « une essence précieuse » comme celle qu’on enferme dans de petits sachets et qu’on peut humer « en ouvrant le flacon ou l’armoire » et « ainsi un instant pénétrer dans l’éternité ».
C’est comme s’il n’y avait pas avec lui de différence entre les conversations des éléments et les conversations des êtres humains : ce n’est pas le sens qu’il perçoit mais la musique. La réalité des lieux et des êtres n’est pas pour autant refusée, au contraire. « L’eau bout dans la casserole ou éructe dans la cafetière. Le lait coule à flots dans les bols. Les moineaux font du tapage, se disputent les miettes. Des rires fusent ». Mais le bonheur de la maison de vacances ne survivra que s’il est suivi de celui de la solitude et de l’écriture, qui permettra de se « mettre à l’écoute des mots », d’« ausculter leur résonance » et ainsi de « faire écho à la polyphonie du paysage ».
Si le monde que Michel Collot nous offre ressemble parfois à une pièce vide, une maison qu’on n’habite plus, « une scène sans personnages » où « les choses parlent à voix basse », c’est parce qu’un jour « nous n’y serons plus », qu’il poursuivra sans nous « sa vie silencieuse ». Ainsi nomme-t-on les natures mortes que peignaient les artistes de l’école flamande au XVIIe siècle.
Le poète est celui qui s’« enfonce dans le sous-sol des mots et de la mémoire, les couches sédimentées du sens en décomposition », qui tient encore la main de celle qui l’a quitté, plus à plaindre que lui, car elle est partie seule, sans aucun secours. « Comment accompagner la migration des âmes, leur frayer un passage, leur donner le repos ? » Il est aussi celui qui chante, au sens propre du terme, des chansons populaires, des folksongs, pour retrouver en lui la force de l’horizon.
Les poèmes en prose de Michel Collot semblent parfois émaner d’un tableau où l’artiste a cherché à immortaliser une épiphanie, qui se révèle en même temps être une épitaphe. Célébrons ce qui va mourir. Ramassons la rose tombée dans le caniveau « avant qu’il ne soit trop tard ».












