On ne lâche pas Bernanos parce que, d’emblée, il empoigne : c’est lui qui ne veut pas lâcher. Il ne cède à l’écriture que pour n’y céder rien. Il ne dialogue pas, mais il écoute, reçoit, regarde, voit et s’impose. Il ne quitte pas le mouvement : c’est un errant et il passe sans cesse de pensées improbables en lieux improbables, avec une force de refus et de rappel qui l’apparente aux prophètes.
François Angelier, Georges Bernanos. La colère et la grâce. Seuil, coll. « Biographie », 631 p., 25 €
Bernanos annonce. Et il chausse les « grandes bottes de sept lieues » de son écriture et de l’aventurier qu’il se dit être afin de « pousser à fond » les situations, les portraits. Il serre les nœuds non pour bloquer mais pour qu’ils se brisent. Ou bien il les humecte d’une eau de source inconnue. Il est combattant, conquérant et soignant. Il cherche et trouve midi à minuit et minuit au plein soleil et au plein bruit d’une action.
« … ce que je suis, un romancier, et s’il plaît à Dieu, aussi, un poète. »
« Je n’invente rien, je raconte ce que je vois. »
La citation, comme les autres de cet article, est tirée des Enfants humiliés. Journal 1939-1940 (Gallimard, 1949), dont l’unique copie fut confiée par Bernanos à Henri Michaux, de passage au Brésil, en janvier 1940. Gardé et perdu par un officier supérieur dans la débâcle de juin 1940, le manuscrit fut retrouvé en 1948. Bernanos, alors en Tunisie, a pu le revoir et apporter quelques retouches. Les enfants humiliés sont comme les paroles d’un chant miraculeusement retrouvé.
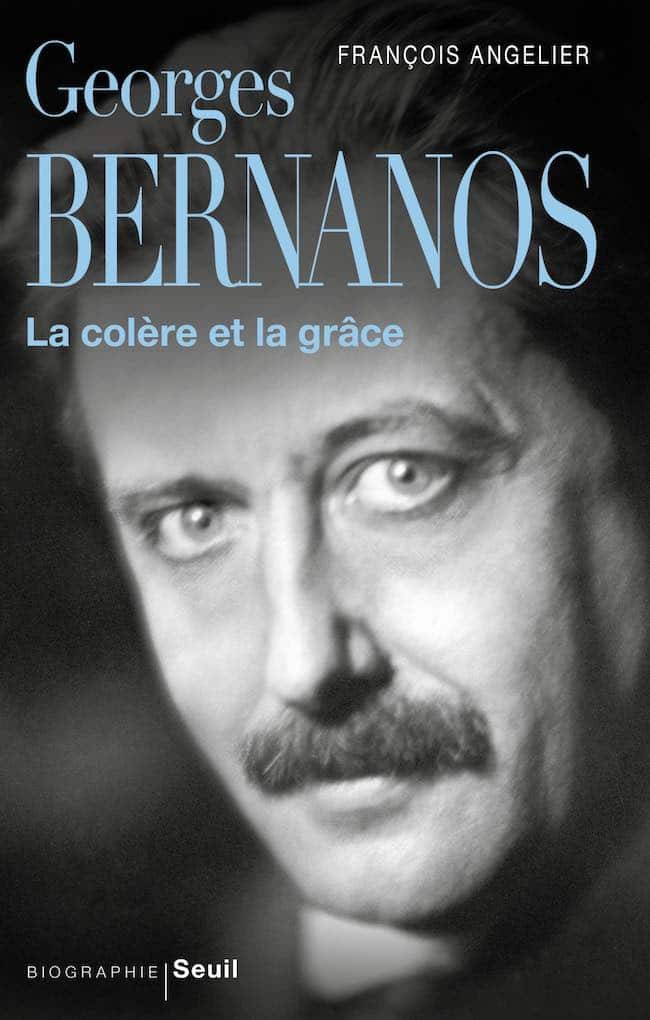
La vie de l’écrivain est son œuvre. Il est scellé à elle. Il ne s’agit pas de l’homme et de l’œuvre mais de l’homme/œuvre. Et chez Bernanos cela donne quelque chose de cinétique et de vertigineux. « Une vision combattante et conquérante de l’écriture », note François Angelier. C’est-à-dire : une vision combattante et conquérante de soi. Son âme, ses héros et le monde, c’est une même empoignade. Chez lui, la surrection est fille de l’abîme. L’écriture à tout prix doit suivre : « C’est l’une des plus incompréhensibles disgrâces de l’homme, qu’il doive confier ce qu’il a de plus précieux à quelque chose d’aussi instable, d’aussi plastique, hélas, que le mot. » C’est qu’il faut à Bernanos « être lucide jusqu’au déchirement ». Et ainsi apprendre : « Nous sommes étouffés par trop de gens qui savent écrire, et n’ont pourtant rien à apprendre à personne. »
Bernanos ne connaît pourtant pas le mépris et recherche toujours le chemin de son lecteur. Que dire de cette pensée inclassable, sinon de cette déflagration au cœur même de la pensée : « Je hais le peu que je sais dès que le savoir menace de m’éloigner des hommes au lieu de m’en rapprocher » ? Ou bien encore : « Infirme, je me dégoûte moins. » Bernanos s’expose, s’offre d’abord au lecteur avant de dire ce qu’il a à dire. Il ne joue pas, il est cartes sur table. Et il a un esprit de puissance.
Chaque œuvre de Bernanos crée une sorte de tourbillon tant spirituel que politique où tout se retrouve bousculé, redistribué, quand ce n’est pas tout bonnement terrassé, mis à terre, notre terre même où le ciel et l’enfer et les limbes se mêlent et règnent ensemble. Chaque œuvre se présente d’abord incarnée, une incarnation trop absente, par exemple, selon Bernanos lui-même, de la poésie moderne.
S’il se sent parfois découragé, Bernanos se défend de faiblir, il n’est riche que d’une seule loi : « ce qui seul importe à mon âge, c’est de ne plus reculer ». L’étendue même de sa déception lui offre une lice pour revenir de plus belle à la charge. Ainsi, il ne se contente pas de s’éloigner de l’Action française : il ne lui tourne pas le dos mais bien en face la rejette. Et il voit et prévoit très vite, avant 1940, le naufrage de Maurras : « une immense déception pour mon pays ».
François Angelier suit admirablement l’itinéraire créateur et chaotique de Bernanos (tant le monde que décrit l’écrivain ressemble à un chaos originel), et souligne l’évolution de son rapport à l’écriture : de la profusion (Sous le soleil de Satan, 1926) à l’implacable et froide maîtrise (Monsieur Ouine, publié à Rio en 1943 et à Paris en 1946). Une évolution d’emblée moins perceptible mais parallèle dans l’écriture des essais : depuis La grande peur des bien-pensants (1931) à La France contre les robots (Rio, 1946 ; Paris, 1947).
Alors Bernanos s’affirme et s’affermit. Sa lucidité finit par bannir tout lyrisme. Il se veut d’abord à la peine. Il suffit de comparer les derniers mots des Grands cimetières sous la lune (1938) avec ceux de La France contre les robots : on passe d’un lyrisme tout brûlant d’indignation et de combat à un froid état des lieux. Pour autant, Bernanos n’est devenu ni notaire ni notable mais lucide. Et notre époque n’est certainement pas là pour infirmer son pronostic. Elle remplit à merveille le mauvais contrat maintes fois dénoncé. Elle dépense sans compter sa pusillanimité. Et plus question de s’enfuir quand il n’y a plus d’endroit où s’enfuir, comme Bernanos, en 1938, put le faire en gagnant le Brésil. Aujourd’hui où la hâte journalistique semble vouloir fixer la pensée, nul ne s’étonne plus que paradis soit enchaîné à fiscal.
Sur la fin de sa vie, Bernanos oriente sa réflexion vers une robotisation qu’il voit venir, avec des machines qui « dispensent de penser, de vouloir, de prévoir ». Il précise (et ce n’est pas tant d’un visionnaire que d’une pensée bien conduite) : « Le danger n’est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d’hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner » (20 janvier 1945). Péguy déjà se méfiait des hommes et des pensées habitués.
Chacune de ses mises en garde est pour Bernanos l’exposition d’une blessure : « L’idée que la liberté puisse disparaître peu à peu d’une civilisation technique où, en effet, elle n’a pas de place, m’est, à la lettre, intolérable. » Là où Péguy, tout de jubilation, combat et raille, Bernanos aussi combat et raille mais il laisse apparaître sa souffrance.
L’urgence de la situation (la fin de la guerre et ses multiples conséquences et directions) lui fait abandonner la forme romanesque (et sa trop longue élaboration) pour choisir les articles, les essais, la correspondance même où il peut sans retard composer et développer sa réflexion. Il rejoint ainsi la manière tout aussi directe de Camus. Tous deux se révèlent penseurs de l’urgence. Sans se départir de leur sort d’exilés (Bernanos exilé de sa terre de Picardie, Camus de celle d’Algérie), sinon même de rejetés : nés pour aimer leur pays, ils rencontrèrent la défiance. Il n’y a pas à s’étonner. Le destin de chaque génération est toujours de « réapprendre le pays » et la vie, fût-ce au prix de s’en écarter.

Le 6 juillet 1948, le journal « Combat » annonce la mort de son collaborateur Georges Bernanos © Gallica/BnF
Considérons alors cet homme inouï, presque à terre, et il lui faudra y être, il le sait mais n’en démord pas moins : « je commence à dominer ». Toute fin de vie fait commencer et Bernanos à sa fin nous apprend à commencer. C’est beaucoup. « Chaque chose arrive en son temps, voilà tout. » Et : « le langage humain est tout de même plein de Dieu ». N’est-ce pas ici l’audace d’affirmer que les textes sacrés peuvent se trouver aussi bien hors des Écritures reconnues ? Bernanos enfonce le clou : « agir surnaturellement, par l’écriture, sur le monde ». Et aussi : « Pas de page, pas de pain. » C’est l’attente commune de l’écrivain et du lecteur.
Bernanos est un errant spirituel, autant à rebours de lui-même que du monde : « J’ai bien peur de l’exil dans le temps. » Cependant il recherche l’exil. Bernanos reproche violemment à Claudel des appétits d’établissement et de fortune, quand le seul établissement et la seule fortune d’un homme sont la fragilité et la précarité de son corps et de son destin. « Pensez à moi comme à une espèce de voyageur, d’aventurier » : un errant, et il faut le prendre dans tous les sens, toutes les profondeurs d’errances et d’errements.
Pourtant, rien n’est le fruit de l’accidentel et du hasard chez Bernanos : le monde y est trop empoigné par la Grâce ou par Satan et les deux découragent. Seulement, Bernanos, au cœur même de ses impatiences, sait attendre.
Nous en resterons là et signalerons qu’il y a beaucoup, beaucoup d’autres choses à découvrir (un exemple encore : les relations avec son éditeur qui tiennent, de son aveu, du « vampirisme psychique ») dans cette biographie d’amour et de lucidité à propos d’un homme et de son temps : toujours le nôtre, car les années apportent depuis leur origine les mêmes hommes comme le sablier de l’océan écoule le même sable.
Ici, chaque lecteur de François Angelier ne peut qu’aller ensuite ouvrir ou rouvrir son Bernanos, gardant en mémoire cette juste définition du « regard bernanosien » sur toute chose politique et sociale ajouterons-nous et pas seulement « sur le second conflit mondial » : « mélange de réaction affective et psychologique spontanée, d’analyse politique à long terme et de profondes décantations spirituelles des événements ». Voilà qui nous conduit au cœur de Bernanos.
Georges Bernanos se veut l’hôte de tous, à coup sûr il est totalement incarné dans son siècle. Et pour avancer dans notre nouveau siècle déjà balbutiant de nouvelles tragédies, nous avons besoin de lui, de cet appel de prophète : « Rompe avec moi qui voudra le pain de l’amertume ».
Ni cette voix ni cet être ne changent jamais. Cette voix, François Angelier a su, en ses divers registres, en quelque sorte la présenter une. C’est aimer son timbre et toute la résonance de celui qui ne craignait pas d’affirmer : « Quant à la France, elle est inhabitable pour moi. » Quelle importance ? Il est seulement heureux que la langue française soit venue habiter un tel homme.












