Le 25 septembre 1940, au matin, à Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, Walter Benjamin (« le vieux Benjamin », comme disaient les émigrés allemands) se présente de façon cérémonieuse, à son habitude, mais à l’improviste dans la petite chambre de Lisa Fittko : il souhaite qu’on l’aide à franchir la frontière espagnole alors que les troupes allemandes s’emparent de la France. Ce n’est encore qu’une rumeur, mais il croit savoir que la militante allemande organise de tels passages par des sentiers dans la montagne. Lisa Fittko est morte en 2005. Son récit des événements entourant la mort de Walter Benjamin, publié en allemand en 1985 et en français deux ans plus tard, reparaît aujourd’hui.
Lisa Fittko, Le chemin de Walter Benjamin. Souvenirs 1940-1944. Trad. de l’allemand par Léa Marcou. Précédé de « Le présent du passé » par Edwy Plenel. Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 384 p., 24 €
Ce que Walter Benjamin ne sait pas, c’est que le « chemin » qu’il va emprunter n’a encore jamais été effectivement utilisé par des émigrés allemands : c’est une vieille « route » de contrebandiers, plus haut dans la montagne que la voie jusqu’ici empruntée et devenue dangereuse car plus étroitement surveillée. C’est le maire socialiste de Banyuls, Vincent Azéma, qui a indiqué à Lisa Fittko ce nouvel itinéraire, la ruta Lister, du nom du général républicain, une voie empruntée dans ce sens par les réfugiés espagnols fuyant la guerre civile et la répression de Franco.
Benjamin arrive ce jour-là de Marseille où il a fait une première tentative malheureuse, en se cachant sur un cargo, déguisé en marin français… Improbable geste de désespoir. Le passage des Pyrénées à partir de Banyuls-sur-Mer est l’ultime chance d’échapper aux argousins de la commission d’armistice, c’est-à-dire à la police allemande et au camp de concentration.
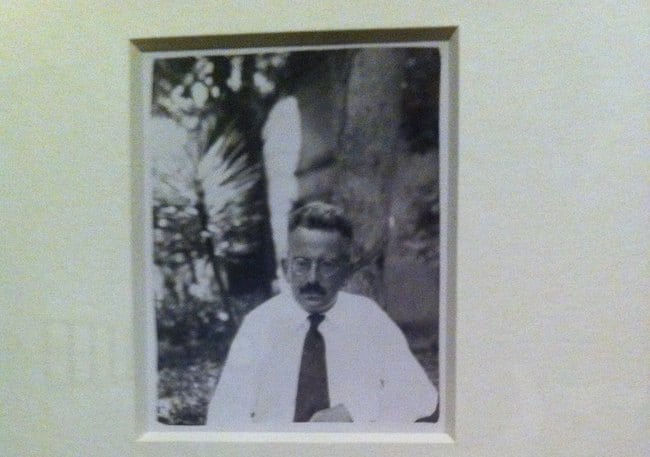
Exposition Walter Benjamin au Musée d’art et d’histoire du judaïsme de Paris (2011) © CC/Esteban Romero
Walter Benjamin, enfin muni d’un visa américain grâce à l’Américain Varian Fry du « Centre américain de secours », mais désespérant d’obtenir l’autorisation de sortir du territoire français – situation tragiquement absurde –, va donc tenter de franchir la frontière franco-espagnole en compagnie de Henny Gurland, une Allemande, et de son fils de seize ans, Joseph. L’aventure est d’autant plus risquée que cet itinéraire n’a donc pas encore été emprunté et qu’il est facile de se perdre dans les hauteurs.
Le 25 septembre, de Banuyls – à partir du Puig del Mas – le petit groupe part en reconnaissance dans les vignes selon les indications fournies par le maire. Cette reconnaissance effectuée, ils décident de retourner en ville pour y passer la nuit et partir très tôt, avant l’aube. Mais Benjamin, qui porte une grosse sacoche noire et, cardiaque, se fatigue vite, préfère dormir à la belle étoile et rester dans la clairière où ils sont déjà parvenus. Il veut en particulier absolument sauver le « manuscrit » qu’il emporte avec lui et qui est, dit-il, plus important que sa personne. Le lendemain, 26 septembre, le petit groupe mené par Lise Fittko retrouve, par miracle, Benjamin au lieu choisi la veille et, après une marche hasardeuse de neuf heures, par les abruptes collines qui marquent la frontière – « parfois nous devions grimper en nous mettant à quatre pattes » –, ils arrivent à Portbou, en Catalogne, dans l’après-midi.
Sauvés ? Benjamin, obligé de reprendre son souffle à chaque pas dans la montagne, est épuisé. Or les policiers espagnols refusent désormais de valider les visas de transit des apatrides en vertu d’un décret récent du gouvernement franquiste. Les réfugiés vont être refoulés. On les autorise cependant à passer la nuit à Portbou avant d’être expulsés le lendemain et remis à la Gestapo, très présente dans la ville. Benjamin, qui loge à la fonda de Francia, découragé, désespéré, épuisé, met à exécution un projet qu’il a souvent caressé et préparé : il se suicide dans la nuit du 25 au 26 septembre au moyen d’une forte dose de morphine qu’il avait partagée à Paris avec Arthur Koestler et gardée par-devers lui. Dans une lettre d’une ultime élégance confiée à Henny Gurland, il écrit : « dans une situation sans issue je n’ai d’autre choix que d’en finir […]. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j’eusse voulu écrire ».

Monument à Walter Benjamin à Portbou © CC/elojeador
Il perd connaissance, un médecin constate une « apoplexie foudroyante » qui interdit tout transport à l’hôpital. Benjamin meurt vers 22 h dans la nuit du 26 au 27 septembre. L’enterrement a lieu le 28 septembre après des obsèques religieuses à l’église Santa Maria, les autorités espagnoles ayant considéré, sur la foi de documents découverts sur lui, que le « Dr Benjamin Walter » était catholique… Henny Gurland et son fils, compte tenu des circonstances, ont pu poursuivre leur voyage, non sans avoir acheté 75 pesetas une concession de cinq ans au cimetière marin de Portbou. Si le modeste cimetière marin, accroché à la falaise, n’a, en fait, pas recueilli les restes de Benjamin, placés quelque part dans une fosse commune, une fois la concession épuisée, un monument de métal de Dani Karavan offre une plongée vertigineuse sur la mer agitée en contrebas. Plus évocateur qu’esthétiquement réussi. Quant au manuscrit mystérieux – de nouvelles Thèses sur l’histoire, une ultime version de Paris, capitale du XIXe siècle ? – que le fugitif voulait à tout prix sauver, il a disparu.
Le récit par Lise Fittko de cette tentative pour échapper au destin a fait sensation en Allemagne quand il a été publié en 1985 chez un éditeur de Munich (Carl Hanser Verlag) sous le titre, à dessein discret, de Mein Weg über die Pyrenäen, soit quelque chose comme « mon passage des Pyrénées ». Dès 1987, une traduction en français due à Léa Marcou a été publiée aux éditions Maren Sell. Peu à peu, une sorte de légende s’est créée autour de cet itinéraire aujourd’hui balisé de 15 km entre Banuyls et Portbou par le col de Rumpissa. Edwy Plenel parle dans sa préface de « pèlerinage agnostique », mais aussi de « suicide socratique » et de « mort à l’antique », et il est certain qu’il est difficile de résister à la force de suggestion de ce qui est devenu presque un mythe.
Edwy Plenel a souhaité souligner à la fois l’actualité et le caractère symbolique de ce « chemin » à l’heure où l’extrême droite affirme sa présence dans la région : il reprend ainsi l’idée benjaminienne d’une actualité du passé, d’une demande qu’il nous adresse, d’une attente en souffrance à laquelle il appartient à chaque génération de répondre. Benjamin, par sa vision mystérieuse et radicale de l’histoire, « à rebrousse-poil », a voulu remettre en question les certitudes des socialistes et des communistes d’alors, leur conception de l’histoire positiviste et optimiste. Qui les empêchait de voir la catastrophe.

Mais la réédition de ce Chemin de Walter Benjamin dans la traduction de Léa Marcou ne serait-elle pas l’occasion de changer de perspective et d’accorder une attention plus grande à celle qui fut la guide et l’organisatrice de ces passages clandestins, Lisa Fittko ? Ce sont ses souvenirs, d’une grande franchise et d’une grande fraîcheur, que nous lisons avec admiration, et le destin si symbolique de Benjamin ne doit pas faire négliger les destinées des autres émigrés. Lisa Fittko, avec un grand sens du concret et une sorte d’humour, retrouve l’atmosphère du beau roman Transit d’Anna Seghers, tous ces réfugiés qui cherchent désespérément à quitter la France qui les a abandonnés, pour une destination qui leur garantisse au moins la vie sauve, la liberté, qui leur offre au moins une chance de survie. Il serait dommage que cette figure si vivante fût reléguée au second plan par celle de Benjamin.
Lisa Fittko, née Elisabeth Ekstein en 1909 dans une ville d’Autriche-Hongrie, passe son enfance à Vienne ; en 1922, la famille s’installe à Berlin. La jeune fille milite dans les rangs de la gauche radicale, lutte contre le nazisme et doit émigrer en 1933, d’abord à Prague où elle rencontre son futur époux, Hans, puis en Suisse, en Hollande, en Tchécoslovaquie. Habitués à la clandestinité, ils finissent par demeurer en France où ils se trouvent quand notre pays est envahi. Dès septembre 1939, suspecte car allemande – peu importe qu’elle ait milité contre le nazisme –, elle est envoyée en mai 1940 au camp pour femmes de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques. La description concrète de la vie humiliante du camp de Gurs fait partie des passages les plus forts de ces mémoires, pleins d’empathie et de lucidité. Elle parvient à quitter le camp en profitant de la confusion de juin 1940 et s’installe à Marseille pour tenter de quitter la France avec son mari, puis à Port-Vendres.
L’itinéraire vers l’Espagne fourni par le maire de Banyuls, l’arrivée inopinée de Benjamin, la terrible journée du 26 septembre, le suicide, le succès par la suite de la « filière Fittko » jusqu’en avril 1941, tout cela mérite d’être rappelé. En octobre 1941, les époux Fittko obtinrent des visas pour Cuba, et s’installèrent ensuite à Chicago.












