Ce qui nous arrive
L’essai d’histoire de l’art sociale que publia Millard Meiss en 1951 en anglais peut être considéré comme un jalon, précisément parce qu’il s’éloigne des jalons posés par l’iconologie classique. La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire écartait en effet d’emblée de son champ d’étude (et de compétence) un sujet tel que l’influence de la Grande Peste sur la peinture du Trecento siennois et florentin. L’ouvrage ne fit donc que peu d’émules dans la communauté des historiens de l’art, bien que sa publication coïncidât avec les débuts d’abord timides d’un mouvement de dessillement de la discipline, qui est allé s’affirmant au cours des dernières décennies.
Millard Meiss, La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire. Les arts, la religion, la société au milieu du XIVe siècle. Trad. de l’anglais par Dominique Le Bourg. Préface de Georges Didi-Huberman. Hazan, coll. « Bibliothèque Hazan », 2013, 328 p., 15 € (publié en 1951 ; traduit en 2013)
Un an avant Meiss, Liliane Guerry avait fait paraître ses propres analyses consacrées au Thème du Triomphe de la Mort dans la peinture italienne. D’elle, on a davantage retenu cependant son Cézanne et l’expression de l’espace, également paru en 1950 et réédité en 1966. Meiss, quant à lui, ne revint plus à ces questions, peut-être dissuadé par la recension plutôt réservée que son confrère Ernst Gombrich fit à l’époque de La peinture à Florence et à Sienne après la peste noire, ouvrage traduit en français seulement en 2013.
Pour tout dire, Meiss s’éloignait de son sujet principal dès le cinquième chapitre de son livre, bifurquant tout à coup vers une autre problématique, passionnante mais connexe, concernant les relations entre textes et images dans les écrits de Catherine de Sienne. Il y soutient que « les œuvres d’art ont contribué de façon importante à façonner l’imagination religieuse de la sainte, car certains aspects de ses visions lui ont été indubitablement inspirés par des peintures ».
Comme en miroir, mais inversé, Liliane Guerry estimait pour sa part que les sermons publics devaient être tenus pour les véritables sources des tableaux figurant les triomphes de la mort. Même lorsque ceux-ci accédèrent à la littérature écrite grâce à Pétrarque, à partir de 1352, ils ne suivaient presque aucune des indications du texte, cela en dépit de constantes manifestes dans le contenu des œuvres, suggérant là encore que le terrain référentiel commun se situait à l’époque ailleurs que dans les écrits. Dans les deux cas, le texte comme repère de l’interprétation iconologique perdait à chaque fois de sa centralité.
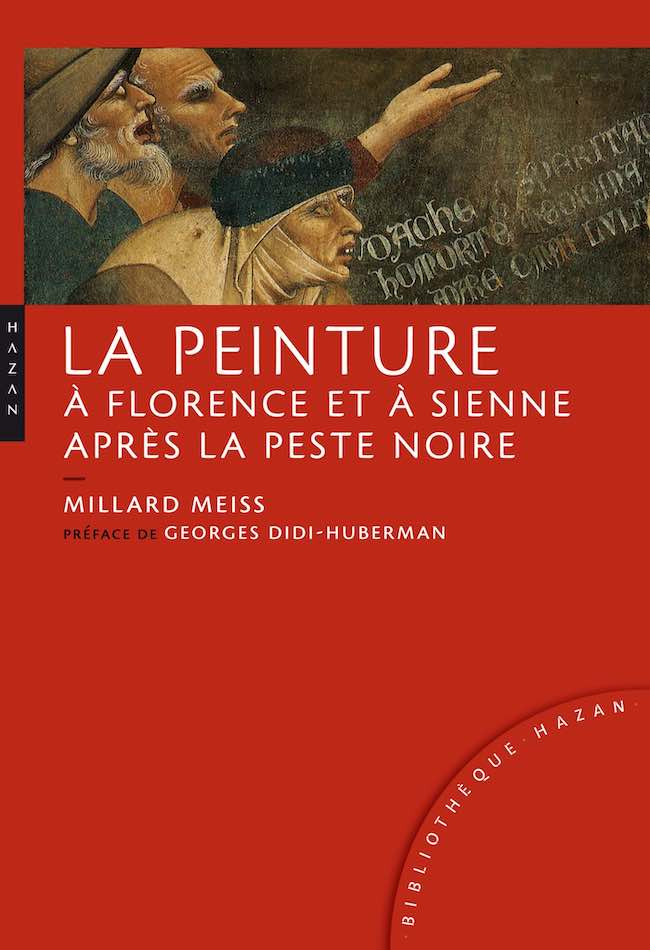
Meiss et Guerry se rejoignaient en outre pour constater que l’iconographie de la mort, si prégnante à l’époque, se dégrade, et par là même qu’elle se diffuse dans toutes les strates de l’imagerie postérieure, distendant progressivement jusqu’à le diluer tout à fait le lien que l’on penserait évident avec la peste. Or ce lien n’est pas avéré, et l’impossibilité de le démontrer en s’appuyant sur des preuves irréfutables, en l’occurrence sur des représentations claires et nettes des effets de la peste noire dans les tableaux de cette période, y compris ceux illustrant le triomphe de la mort, explique sans doute le glissement opéré par Meiss.
Mais que de tels tableaux soient introuvables, qu’il ne se trouve pas de tableaux de la peste, était inévitable, selon Georges Didi-Huberman, par ailleurs auteur lui-même d’un Mémorandum de la peste (Christian Bourgois, 1983). À cela deux raisons, exposées dans la préface qu’il donne à l’édition française de Meiss, l’une liée à l’histoire de l’art elle-même, l’autre à l’objet que lui a assigné l’auteur : la peste, justement. Celle-ci, écrit Didi-Huberman, étant « indescriptible et irracontable », aucune œuvre ne peut l’accueillir sans que sa composition n’implose, car, « comme le disait Muratori [en 1720], la peste « désorganise l’imagination », la met en désordre (disordinando la fantasia) ».
C’est pourquoi elle ne se rencontre nulle part composée. En la cherchant inaltérée, écrit Didi-Huberman, « Millard Meiss a voulu faire de la peste ce qu’elle n’était pas exactement : à savoir une cause historique orientant l’histoire de la peinture, ainsi qu’un objet référentiel ». Meiss occupe en ce sens une position ingrate, à la fois encore aux prises avec son « préjugé référentiel » et démentant déjà le « déni de peste » qui traversait l’histoire de l’art en la maintenant à l’écart de son historicité, comme si on faisait celle du XXe siècle, hasarde Didi-Huberman, « sans jamais mentionner les deux guerres mondiales, ni Auschwitz, ni Hiroshima ».
Une remarque incidente de Meiss, qui au reste ne s’attarde guère sur le caractère inédit de son approche ni sur sa potentielle actualité, confirme cependant qu’il était conscient des relations qu’elle entretenait alors avec son passé proche. Citant le début du Décaméron de Boccace où celui-ci évoque brièvement la peste dont il est le témoin à Florence, voyant « l’énorme tranchée » dans laquelle étaient déposés « les cadavres à mesure qu’ils arrivaient, par centaines à la fois, les empilant par couches successives », Meiss observe simplement qu’il s’agit de « visions qui ne sont pas étrangères à des yeux modernes ». Il est probable, cependant, qu’il songeait alors davantage à des photographies qu’à des peintures, tant les signes d’Auschwitz dans l’art sont encore à peine perceptibles cinq ans après la fin de la guerre, et qu’ils demeureront ensuite pour l’essentiel indirects.
Contrairement à ce que laisse entendre Didi-Huberman, Meiss a produit le relevé de quelques indices du même genre, signalant que les formes des œuvres du second XIVe siècle avaient bel et bien été affectées par la peste. Meiss aperçoit par exemple qu’un certain équilibre compositionnel, « entre les formes et l’espace, entre les corps solides et le vide », a été « supplanté par une tension entre ces éléments », et que cette tension atteint les figures elles-mêmes, qui n’offrent plus que « des masques impassibles, des regards dispersés, des actions en suspens ». La peste n’est pas là représentée, mais elle est là, présente, sous-tendant la structure même des tableaux.

« Le Déluge », de Paolo Uccello (Florence, 1446-1448)
Certaines couleurs aussi se modifient et contribuent à intensifier « l’expressivité des visages durs, austères, tristes et souvent angoissés », tout en rappelant « les mosaïques et les panneaux d’un art plus ancien », d’orientation byzantine. Les contrastes chromatiques eux-mêmes sont traversés par une tension nouvelle. « Ce bleu d’une dureté insolite voisinant avec un écarlate, observé dans le Retable Strozzi [d’Orcagna, 1354-1357], nous le rencontrons ensuite constamment dans la peinture de Florence, et fréquemment dans celle de Sienne. » Comme si la disparité de deux tons pouvait trahir l’éclatement d’un monde.
Dans un petit texte ardent de 1976, intitulé Le Déluge, la Peste, Paolo Uccello (Galilée, 1976), qu’il republia étrangement sans « la Peste » sous le titre Paolo Uccello, le Déluge (P.O.L, 1999), Jean-Louis Schefer formulait une réflexion analogue à celle de Meiss. Dans la fresque de Florence peinte en 1446-1448 figurant l’après Déluge, il reconnaissait une exacerbation de la perspective qui avait selon lui conduit Uccello à produire des corps en attente de leur « figure ». Or la conception de cet espace d’attente et des corps dé-figurés à l’intégrité en suspens qui s’y tenaient sans l’occuper vraiment provenait pour Schefer du souvenir de la peste qui avait réactivé celui, immémorial, du déluge. Autrement dit, à l’image du mauvais gouvernement de Lorenzetti, la peste désorganise la figuration, et cette désorganisation, ou cette mise en tension, s’avère être, en dernière instance, l’indice plastique du chaos s’emparant désormais des corps et des lieux – l’unique trace perceptible des effets de la peste sur la peinture.
À la vérité, pourtant, il en est une autre, plus méconnaissable encore puisqu’elle se dévoile comme le contrepoint exact du corps pestiféré : saint Sébastien. Meiss signale que ce dernier, « invoqué contre la peste depuis le VIIe siècle […], ne faisait pas cependant l’objet d’un grand culte, du moins en Toscane, jusqu’en 1348 ». À partir de cette date, cependant, et pendant des siècles, saint Sébastien n’eut de cesse d’être prié, et surtout représenté. Sa mort par sagittation autorisait en effet qu’on identifiât les flèches qui le martyrisèrent aux « flèches » de la peste, suivant une métaphore présente déjà chez Homère. Cela d’autant plus que Sébastien survécut à son martyre, se rapprochant ainsi des figures de Lazare et du Christ lui-même. Son corps, lié à une colonne, l’apparentait plus encore au Crucifié, à ceci près que son apparence apollinienne jouissait d’une sensualité supérieure à celle traditionnellement impartie au Sauveur.
Quoi qu’il en soit, par un singulier paradoxe de l’histoire de l’art, l’iconographie chrétienne réagit au choc de la peste qui dépeuplait les villes et putréfiait les corps en lui opposant une figure adonienne dont la beauté antique protégeait les cités et conjurait la terreur. C’est donc cette figure que devrait consulter un historien soucieux de mesurer les effets de la peste sur l’art .
Figure paradoxale, donc, puisque la peste n’y est plus que métaphore, puisque son souvenir s’y est dissous au point de faire de la figure du martyr une sorte de corps d’oubli du désastre. « Ce qui frappe », écrit Jacques Darriulat qui consacra à Sébastien le Renaissant un beau livre très complet (Lagune, 1998), « ce n’est pas la référence à la peste, mais plutôt le soin que le peintre prend à l’effacer » ; le peintre – tous les peintres. De sorte que désormais pèse sur toute figure de cette modernité commencée à la Renaissance le soupçon ou l’espoir que sa beauté, face à la peur, tienne lieu non seulement de contre-type, mais encore de philtre prophylactique.












