Trois premiers romans qui ont pour point commun, et point d’ancrage, la photographie. Trois manières pour de « jeunes » auteurs, Simone Somekh, Diane Chateau Alaberdina et Anne-Marie Garat, de développer ce que l’on pourrait appeler « l’ombre » de la littérature.
Simone Somekh, Grand angle. Mercure de France, 220 p., 21,80 €
Diane Chateau Alaberdina, La photographe. Gallimard, 160 p., 16 €
Anne-Marie Garat, L’homme de Blaye. Flammarion, 264 p., 19 €
Ce qu’(in)augure un premier roman, nul ne peut vraiment le dire, sauf à prétendre voir le futur d’un auteur entre les lignes de son texte, exactement comme on lit l’avenir dans une boule de cristal. Apercevoir des signes annonciateurs quand ce ne sont que des débuts d’intuitions, relever des obsessions quand il ne s’agit que d’impressions… Non, décidément, le reste, car reste immense il y a, s’écrit au conditionnel : autant de syllabes à deviner dans la charade de l’œuvre à venir, et, peut-être, dans le miroir de la littérature. Mon premier (premier) roman, de Simone Somekh aurait d’abord et avant tout les qualités des défauts de son narrateur, que l’on dira trop jeune, trop fougueux, impétueux, insolent presque.
On en veut pour preuve le chapitre zéro, début de récit chaotique s’il en est, la bagnole familiale que le narrateur expédie ad patres, mais pas le fils qui va avec. Comme si l’existence fuyait encore par le tuyau d’essence ! « On entendit un grand fracas et moi qui étais seul dans la voiture, je n’eus pas une égratignure car dans ce monde ce ne sont pas les accidents qui blessent mais les personnes, avec leurs mots et leurs idées stupides. » Il faut dire qu’Ezra Kramer a quelques excuses et autant de projets : né et élevé dans une famille de confession juive ultra-orthodoxe, il veut s’émanciper, intégrer une école plus ouverte, voir du pays, regarder (désirer) les femmes, et, comble du comble, devenir photographe (de mode). Pourquoi pas s’habiller en Prada pendant qu’il y est !
Grand angle : le titre parle de lui-même et dit fort bien la teneur d’un roman que l’on croirait d’apprentissage, à la fois primesautier et réfléchi. Où le narrateur, donc, s’emploie à rapprocher les êtres, les idées, les identités. Ce n’est pas un juif qui parle aux autres juifs (ce ne serait alors qu’un roman communautaire), mais un juif qui parle, aux autres, de sa, de la judéité… un peu comme d’autres parleraient de leur complexe d’Œdipe : « Je pense au paradoxe qui règne dans ma tête. À Brighton j’étais athée, à Manama je suis juif. Je suis peut-être un rebelle de nature, en conclus-je. »

Être sensible, Kramer s’exprime sur et par une surface sensible. De fait, la photographie lui permet de montrer ce qu’il ne peut pas forcément, ouvertement, dire. Par petites touches, intelligemment, naturellement, Kramer développe son point de vue et de vie. Quand il photographie Malka Portman, la sœur d’un camarade de classe, dans les toilettes de son école. Quand il réinterprète à sa façon les images de Steven Meisel. Quand il prend en photo les chiites de Barhein qui manifestent contre le régime sunnite. Sa manière de faire des photos est autant politique que non policée : « Qu’est-ce que tu aimes le plus et détestes le plus ? […] La photographie… et l’hypocrisie ».
À la fin du roman, Kramer se retrouve à Tel Aviv, homme libéré dans la grande ville libérale, et surtout retrouve son double, son frère de larmes, l’ami Carmi, le différent (l’homosexuel) entre tous les différents (les juifs), celui qui l’avait auparavant « révélé » à lui-même : « Je n’avais jamais pensé à Carmi en termes utilitaristes : c’était mon ami, mon frère, ma consolation et mon salut. Et en même temps mon désespoir, ma frustration et ma déception. Carmi avait été tout et rien à la fois, le maximum et le minimum, le meilleur de lui et le pire de moi, le meilleur de moi et le pire de lui. »
Mon deuxième (premier) roman tirerait son charme de son caractère, slave évidemment, petite musique nostalgique-mélancolique qui se perçoit à travers le style de l’auteure, comme une langue douce-étrangère parlée par un fantôme de passage : « C’était une enfance calme. J’avais appris à parler français et anglais. À l’école, j’étais une petite fille comme les autres. Mon père m’emmenait le dimanche dans la vieille ville pour manger des gâteaux dans le salon de thé. Je n’étais pas blonde. Je n’avais pas les yeux bleus, contrairement à tous les lieux communs que je pouvais entendre. On m’appelait Lud. »
L’Archipel Café, point de ralliement de quelques âmes perdues, n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de la jeunesse du même nom, Diane Chateau Alaberdina partageant avec Modiano le goût pour la mémoire qui s’évapore autant que l’attrait pour les vies en pointillé : « À l’époque, j’avais lu avec mon frère ses trois romans [ceux d’Agafonova] sans bien comprendre de quoi il était réellement question. J’avais à peine seize ans. Chaque année, je les relisais. Et à chaque fois, j’interprétais différemment l’histoire. Les personnages évoluaient lentement, comme s’ils venaient aussi à vieillir entre les mots. »
Lud, la narratrice, est photographe, plus précisément portraitiste, on pourrait ajouter voyeuriste : des corps, des âmes, des corps inséparables des âmes. Quand elle prend en photo Taisiya, la fille d’Agafonova, Lud va au-delà du cliché, elle s’immisce, s’insère littéralement dans le couple que Taisiya forme avec Samuel, installant entre la jeune femme, sa mère et elle une relation aussi trouble que double : « Pendant des semaines, j’ai regardé en boucle les images de Taisiya et de Samuel. J’avais dissimulé des tirages dans le tiroir de ma table, entre deux dossiers. Non seulement j’aimais les regarder, mais j’éprouvais de plus en plus un sentiment étrange à leur égard. Lorsque Milo et moi faisions l’amour, je pensais à eux. Je n’avais pas honte de moi. C’était quelque chose que j’avais admis, ce plaisir de me comparer et de me dire que je ne serais jamais la même femme que Taisiya. »
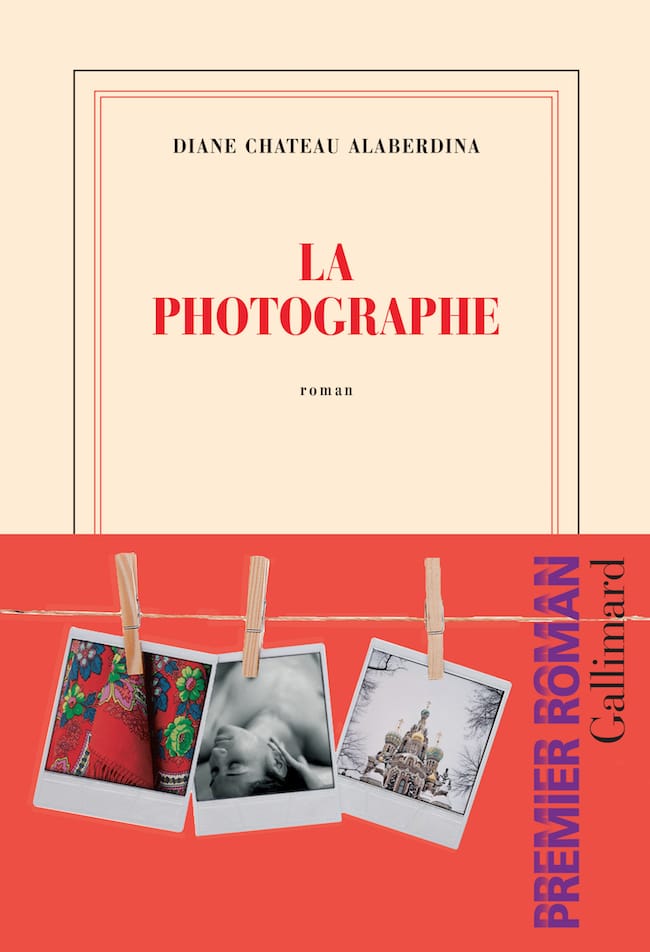
Un brouillard projectif/identificatoire s’étend à la surface de ce captivant récit-miroir, la narratrice parvenant à se tenir sur une ligne de crête, quelque part entre la fascination et le rejet, la création et la destruction : « Des ombres s’étaient formées sur le creux des épaules. Je lui ai demandé de se cambrer, de laisser voir son dos. Sur le moment, j’ai eu envie de frôler les vertèbres saillantes, de sentir leur force se dessiner au bout de mes doigts.
— C’est triste de te photographier.
Taisiya a écarté ses bras. Ses cheveux étaient étalés sur le parquet. Ils formaient une flaque dorée. Elle avait mis sa tête en arrière, comme si elle venait d’être tranchée.
— J’ai l’impression de me retrouver un peu en toi. »
Que l’auteure ait mis un peu plus que quelque chose d’elle dans ce livre, cela ne fait guère de doute. Mais quoi ? L’avenir de l’œuvre le dira, qui fixe la vie comme une épreuve. Parfois trouble, parfois nette. Parfois trouble et nette.
Mon dernier (premier) roman n’en serait plus tout à fait un, et pour cause… Publié en 1984 (l’année de L’amant, son impossible image qui dure pendant toute la traversée du fleuve…), L’homme de Blaye est réédité aujourd’hui avec une précieuse petite préface de l’auteure, qui rend hommage, en passant, à quelques hommes et femmes liges de l’édition (Denis Roche, Marie-Catherine Vacher, Bertrand Py).
Ce serait comme si l’on connaissait tout des livres de l’auteure à venir et, pourquoi pas, tout de l’auteure des livres à venir. Ses obsessions (les lieux, les maisons, les visages, les airs…), son style, sa manière à elle d’écrire en rond et d’écrire long. Car rien ne peut échapper à la sagacité d’un lecteur qui a déjà lu les romans-récits qui viendront après le premier nommé… Parmi eux, le très beau Photos de familles, le plus que térébrant Dans la pente du toit, le bien nommé Nous nous connaissons déjà…

Étienne Sylvestre court après son passé comme un fantôme après son ombre, il ne parvient pas à être et à avoir été, il ne sait pas aimer, il ne sait pas être aimé. On le voit avec les défauts de ses qualités, qui se retrouve perdu dans la vie et dans une ville, du côté de Bordeaux, un seul souvenir à partager, la photo d’un petit pan de mur avec du lierre et puis plus rien, juste une image manquante (impossible ?) : « ‟Je vais chercher ce que vous cherchez”
Elle dit gravement, un peu triste :
‟C’est inutile. Je ne trouve rien. Vous ne trouverez pas. Et il vous manque l’image.”
Elle s’en va, s’éloigne cette fois. À la grille, elle se retourne, lui fait un geste de la main.
‟Je vais chercher”, crie-t-il. »
Étienne Sylvestre est un homme d’images, ce n’est peut-être même que l’image d’un homme. Son métier de photographe, il l’a comme dilué dans son existence : « Étienne revoit son arrivée à la gare routière, l’hôtel, les places de la ville, la nuit, il était si vacant alors ! Ne s’accrochant à rien de sûr, ne sachant où son corps, son esprit dérivaient. »
Il y a dans ce premier roman d’Anne-Marie Garat comme une sorte de suspens, ou plutôt une fracture temporelle : on dirait que le présent est tombé dans le passé. Cette fracture donne à entendre une grammaire de l’être étrange, le point obscur de la vie que l’écrivaine n’aura de cesse de développer par la suite. Comme Simone Somekh et Diane Chateau Alaberdina après elle, comme d’autres écrivains avant elle, le regard intérieur plongé dans le bain lumineux de la littérature.












