Après L’ombre animale, le nouveau roman de Makenzy Orcel nous lance sur les pas de Poto qui traverse sac au dos cinquante ans de l’histoire d’Haïti. Malgré les violences et les infortunes, il avance obstinément, comme le personnage légendaire du titre, Maître-Minuit.
Makenzy Orcel, Maître-Minuit. Zulma, 320 p., 20 €
Première page : Poto se réveille menotté à un lit de l’hôpital général de Port-au-Prince, un pandémonium où « des dizaines de corps sont affalés pêle-mêle sur des matelas crevés, sur des civières, ou à même le sol crade, jonché de chiffons sanguinolents et couverts de mouches. d’autres suivent. ça déferle jour et nuit. une marée humaine. on dirait que c’est tout le pays qui est frappé par une sale épidémie. depuis des mois, des années, les médecins observent une grève manche longue ». Le ton est donné : cette histoire se raconte sans majuscules, taillée nette dans un flux qui dépasse les personnages, commençant bien avant eux et continuant après. Un flux irrépressible, sombre et poétique. Ou comme si ce qui se racontait ne pouvait être dit que par en-dessous, sans apprêt, hors de toute marque de grandeur, même la plus habituelle. Une histoire des petits, de ceux qu’on maintient dans l’obscurité, qui « crèvent, ce qui s’appelle crever, dans la honte la plus totale. Le liquide marron qui coule dans les caniveaux, à l’entrée principale du bâtiment, c’est la sauce des corps en décomposition dans la morgue sans climatiseur », écrit Makenzy Orcel.
À son voisin de chambre, Poto raconte comment il en est arrivé là ; en même temps, il fait l’histoire d’un pays comme atteint d’une maladie chronique. Dans lequel l’apparition d’un médecin au sein de son principal hôpital ne peut être qu’une mauvaise blague, « un canular », parce qu’on est le 1er avril.
La première partie s’intitule « Marie Élitha Démosthène Laguerre ». Ce superbe nom est presque toujours répété dans son entièreté. Peut-être parce que celle qui le porte est privée de toute autre gloire, comme de tout autre mot. Elle n’adresse jamais la parole à son fils, Poto. Chacun reste enfermé dans sa chambre, de chaque côté du couloir. Depuis longtemps, Marie Élitha Démosthène Laguerre ne s’adresse plus qu’à la colle qu’elle renifle, aux fantômes qu’elle poursuit à travers les nuits de Port-au-Prince, ou aux démons, qu’elle fuit dans des hurlements.
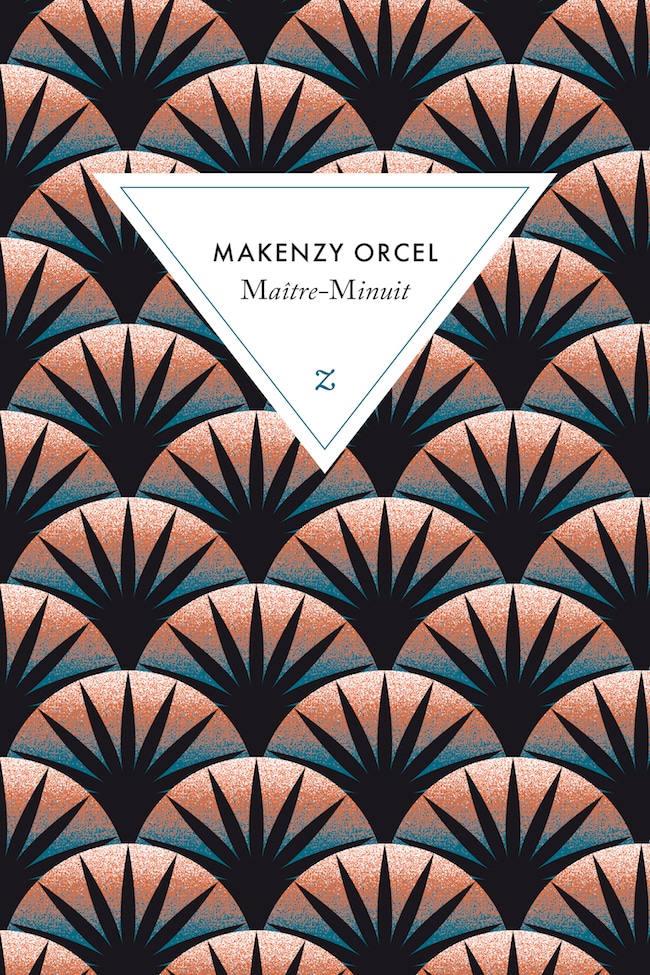
Poto pourrait parler avec Grann Julienne, « vieille dame aux allures pittoresques vivant retirée, loin de tout », y compris des problèmes. Au cœur de la province reculée de Plaine-d’Orange, au sein de la commune de Bombardopolis, Grann Julienne sait raconter les histoires : « je l’écoutais comme on écoute une chanson, un poème, passer d’un univers à l’autre, éplucher les vieilles légendes ». Elle sait éviter les phrases toutes faites : « c’est quoi un tonton macoute, Grann ? au lieu de dire c’est un assassin, elle dit : c’est le double maléfique du cousin Zaka. Où il passe il fauche tout, des vies et des biens, qu’il glisse dans son makout [sacoche] ». Ses mots pourraient guider Poto : « c’est qui Maître-Minuit, Grann ? c’est un homme qui reste debout, avance toujours, quoi qu’il arrive ». D’autant plus que le garçon a le don « d’observer à la fois les deux versants de la réalité : le versant visible et le versant invisible ». Il voit passer Maître-Minuit, le géant marcheur et impassible, et sur son cheval volant l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, le Prince de l’Indépendance. Mais il ne cultivera pas ce don, « en raison de [s]on opposition à toutes sortes de fétichisme, de croyances », et parce que Marie Élitha Démosthène Laguerre repart en hurlant vers Port-au-Prince. Poto se sent tenu de la suivre.
On respire difficilement dans Maître-Minuit de Makenzy Orcel. C’est que la dictature de Papa-à-vie, derrière lequel on reconnaît François Duvalier, est partout, étouffant tout espoir, tout bonheur, tout avenir : « le livre, au même titre que le sourire, le silence, la parole, être heureux, est un péché contre le régime ». La tyrannie s’étend à tous les secteurs de la société, y compris l’école, confisquée par la propagande et les fils de tontons macoutes, les sbires du pouvoir. Puisque Poto ne peut pas utiliser les mots, il dessine. Il y trouve son moyen d’être au monde. Il suit dans ses nuits Marie Élitha Démosthène Laguerre et la dessine. Il dessine Georges Baudelaire, l’amoureux de sa mère, qui, en dépit de toute logique, survit à son arrestation. Il dessine même les peurs du dictateur, retranché dans son palais, rongé par la terreur de se voir renversé.
Marie Élitha Démosthène Laguerre n’autorisant « personne à la détourner de sa chute, lui tisser un destin contre son gré », elle finit par s’absenter définitivement. Poto se met alors en route pour une longue marche, avec sur le dos le sac dans lequel il garde ses dessins.
Il vit dans la rue. Pour être toléré, il doit accepter de passer pour fou, jouer le rôle que lui assignent les tontons macoutes : « là là ! là là ! là là ! faisais-je en tapant des mains, en inventant du mieux que je pouvais des tours de reins, de pieds, de bras, tandis qu’ils se tordaient de rire, jubilaient. allez, encore, encore ! je continuais alors comme un con. j’étais leur folie, leur musique à eux, leur rituel pour passer une bonne journée. putain il danse trop bien le fou au sac à dos, vraiment il déchire […] j’avais bien compris qu’ici on n’a pas même droit à sa propre folie, son propre corps ».
Le pouvoir change, il est maintenant détenu par un président élu, ancien prêtre, comme Jean-Bertrand Aristide ; le chaos a remplacé la dictature, mais la violence politique subsiste, comme l’instrumentalisation des pauvres et des délinquants, la corruption. On se bat dans « la cité », un gigantesque bidonville adossé aux murs de quartiers sécurisés, afin de récupérer les miettes concédées par le pouvoir.

Makenzy Orcel © Francesco Gattoni
Une autre voix se mêle à la voix de Poto : celle d’un assassin, d’un nervi du pouvoir. On comprend que cette voix appartient à MOI, un caïd qui devient le mentor du jeune homme, une nouvelle silhouette que Poto, qui a été trop souvent livré à lui-même, essaye de suivre. Poto, éternel passant au sac à dos, continue à dessiner. Il court sous les balles qui vise MOI, se réfugie avec lui auprès d’une de ses amantes, Madeleine, et quand MOI s’évanouit, sans doute mort pour de bon, Poto prend sa place auprès de Madeleine. Mais il lui faut encore payer pour cela.
MOI fut peut-être le généreux Georges Baudelaire, le seul à se préoccuper de Marie Élitha Démosthène Laguerre, le seul à défendre même les méchants du lynchage, Georges Baudelaire qui se retrouva en prison pour avoir osé s’y enquérir du sort d’un ami. Le tourbillon de folie qui emporte l’histoire d’Haïti n’épargne personne, bat les cartes et les rejette en désordre. Reste l’humiliation coloniale, inscrite dans les mots : « kolon gèt manman w ». Une insulte à la mère de celui qui parle, mais, également sous-entendue, l’idée que tous les Haïtiens sont des bâtards, et que les colons continuent à les exploiter. Ces mots, son lieutenant Makawon les adresse à MOI comme une nouvelle illustration que les pauvres contribuent à leur propre malheur.
Le temps passe, même si ce n’est pas de manière réaliste. L’histoire se compresse comme un accordéon : Poto épouse Madeleine, devient un artiste reconnu, mais cela n’apaise pas son errance. Un amour d’enfance retrouvé ne lui permettra que de constater l’imposture des organisations humanitaires internationales. Haïti ne se sauvera pas non plus grâce à l’aide extérieure.
Lors d’une soirée arrosée, un excès de confiance conduit Poto vers une étonnante dernière partie, un microcosme du pays tout entier : un asile psychiatrique, « où même la normalité est considérée comme anormale ». Qu’on ne soit plus sous la dictature et qu’il ne soit pas fou, cela ne suffit pas pour qu’il sorte. Seul un nouvel acte de violence le conduira, sanglant et menotté, à un lit de l’hôpital général. Où, en racontant son histoire, il pourra enfin se libérer par les mots.
On émerge sonné de ce voyage halluciné dans le temps et l’espace d’Haïti – il faudrait aussi parler du désespoir d’un capitaine de navire, de la saveur des noms mêlés à la violence la plus brutale, « du massacre de Carrefour-Feuilles perpétré par des bandits de Savane-Pistache », de Gustave, mort par galanterie envers une putain… – mais on en sort avec des étoiles dans les yeux : d’avoir suivi la voix vive de Poto pendant trois cents pages, d’avoir senti le prix de ses rencontres et de la découverte de l’art. De l’avoir vu, quoi qu’il arrive, sac au dos, persister à avancer comme le géant Maître-Minuit, traversant les nuits jusqu’à laisser derrière lui la folie. « Il doit y avoir une limite même à l’infini », mais elle n’est pas dans ce roman fiévreux à l’intensité droite, n’oubliant pas les souffrances du passé et pourtant avançant vers l’avenir.












