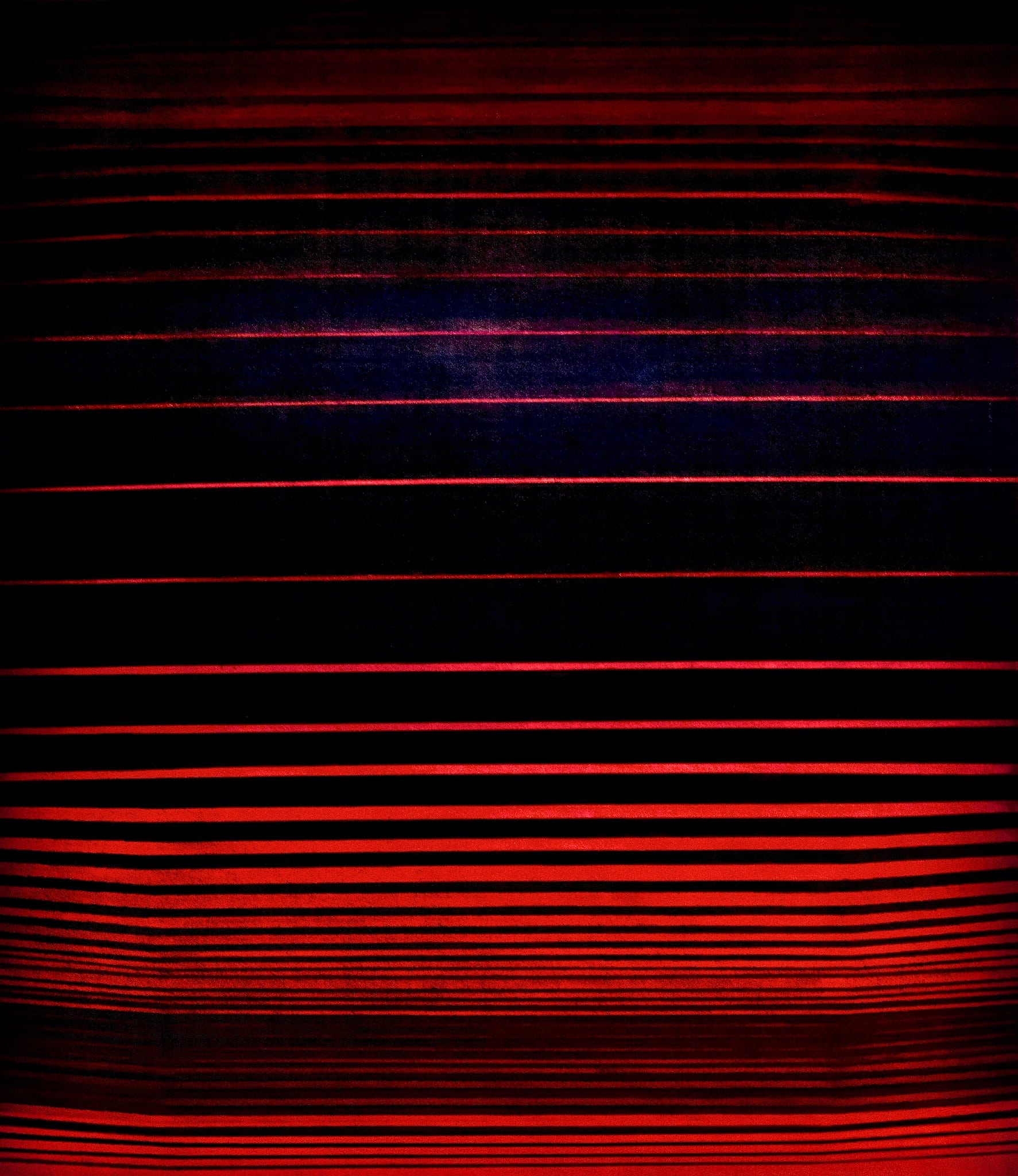Avec la publication de Oui Camarade !, œuvre de Manuel Rui, la cartographie de la littérature angolaise se précise pour le lecteur francophone. Marquant l’entrée dans la fiction de cette littérature, ces cinq récits allant du 31 janvier 1975 (premier gouvernement de transition) aux cinq jours suivant l’indépendance, proclamée le 11 novembre 1975, viennent capter le quotidien extraordinaire, la dangerosité et la délicatesse de la vie de ce temps-là, où tout un pays aux coordonnées complexes vit les dernières heures du joug colonial, la mise en place houleuse du gouvernement transitoire, précaire dès sa composition (l’écrivain y a d’ailleurs été ministre), et les premières journées historiques de sa libération.
Manuel Rui, Oui Camarade ! Trad. du portugais (Angola) par Elisabeth Monteiro Rodrigues. Chandeigne, 186 p., 20 €
Écrire l’enfance mûrie en guerre et le climax de l’indépendance d’un peuple, voilà la double et paradoxale euphorie des cinq nouvelles composant l’ensemble de Oui Camarade ! de Manuel Rui. Paradoxale, parce que l’hyper-expertise es stratégies et balistiques des guérilleros en culotte courte n’a d’égale que leur extraordinaire efficacité sur le terrain et dans le langage, et que ce régal de leur dialogue à hauteur d’adulte dérange par ailleurs : quelle jeunesse que celle-ci, vouée à tout moment aux balles perdues, aux embuscades sans issue et aux héros démembrés et anonymes, qui donne aux chiens des noms d’arme tel que Bazuka ? « Maintenant même les gamins donnent des leçons sur la guerre » : les petits « pionniers » ont grandi trop vite au son des balles et des déflagrations, le courage de ces gavroches en nombre est d’autant plus émouvant qu’il aborde les désastres et la politique avec une évidence désarmante, ramenant l’adulte au credo de la victoire quand il doute de l’arrivée des partisans.
Paradoxale encore quand l’individu éprouve en une seule ronde et en quelques heures toute l’échelle de variations du plus grand malheur au plus grand bonheur, ballottant entre le drame intime et la célébration commune. Se réjouir ou se désespérer ? Ou, selon les termes de l’écrivain : « Se dessaoûl[er] de l’euphorie collective » pour honorer la mémoire de l’aimé qui vient de mourir, ou être la camarade du peuple, qui porte fièrement les couleurs de l’allégresse en ce jour historique et va « colporter sa joie à travers les bases détruites des fantoches » ? Telle est la trame des « Deux reines » de cœur et de cortège, respectivement mère et amante, élues d’un jour pour incarner la victoire. En ce jour historique, Luanda regorge de ces oscillations de l’extrême, et pourtant c’est l’euphorie qui gagne, totale.
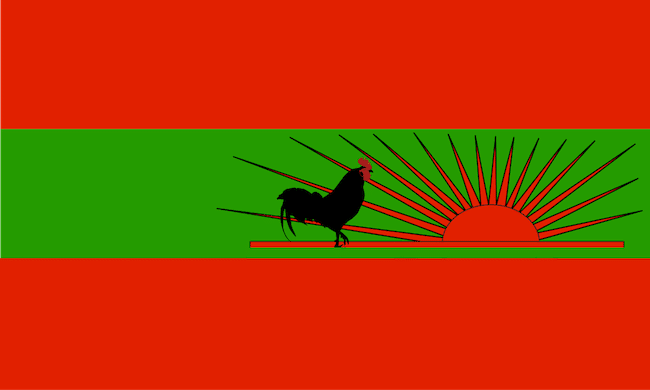
Drapeau de l’Unita
Euphorie, car Manuel Rui entraîne le lecteur et ses personnages dans la grande liesse de l’indépendance, au sortir de quinze années de guerre coloniale et de luttes, tandis que se secoue enfin le double joug de quatre décennies de dictature salazariste et de plusieurs siècles d’un colonialisme particulièrement féroce. Une immense espérance populaire, telle une vague qui emporte tout, avant que de devoir passer, hélas, au rude tamis de près de vingt-huit années de guerre civile, de pacifications précaires et d’affrontements fratricides entre les milices et les partis. Mais, au seuil du livre, rien de cela n’est encore écrit, même si tout affleure déjà. L’allant du texte n’exclut pas la critique : Oui Camarade ! s’ouvre donc sur le 31 janvier 1975, date du premier gouvernement angolais, transitoire, à Luanda. À l’heure des premiers discours adressés au peuple depuis le Palais, le récit « Le Conseil » fait de l’écart sa poétique, son diagnostic et sa politique, trahissant déjà ce qui suivra. Écart visible entre les membres du gouvernement : « Mon Vieux ! Ce gouvernement s’en fout. Regarde ça : les nôtres avec des tenues “Pouvoir populaire”, certains en Mobutu et le reste en costume cravate ! Je veux dire : si la différence se fait déjà là-dessus ce gouvernement n’ira pas au bout. Je les mets à couper » ; fossé qui mesure la promesse de l’homme politique irréaliste : « Nonobstant, il n’a manqué à Savimbi [leader de l’Unita] que de promettre l’air conditionné dans les rues, du désodorisant gratuit et une machine à tirer des billets de mille sous brevet déposé au nom d’Abrigada Chipenda » ; gouffre encore entre les lieux du pouvoir, hanté par les ors du colonialisme, et la rue où le peuple attend, les poches vides : « l’air conditionné à fond, et la longue tapisserie européenne, les candélabres, la grande table, et les chaises Louis je ne sais combien, déformaient la réalité vers d’autres latitudes. […] C’était une époque de grands néologismes qui venaient enrichir le lexique national très très loin du “luso-tropicalisme” ».
Oui Camarade ! est traversé de slogans et de fragments d’idéologie, débats intempestifs de rue, où les quidams et les camarades s’interpellent, hommes, femmes, vieillards, enfants, dans une égalité des voix, une cacophonie qui exigera du lecteur français qu’il se replonge dans l’époque. Se plaçant toujours aux côtés du peuple, Manuel Rui scrute la guérilla, fait le portrait de ses aventuriers d’un jour et de ses militants de la première heure, écoute aux portes des conseils ministériels, prélève des éclats de réel dans les zones les plus périphériques, dans les poches de résistance et les caches, et n’oublie pas de questionner les virtuosités fallacieuses du langage, donnant d’abord à entendre ceux qui n’ont pas toujours voix au chapitre. Manuel Rui, ce faisant, prend régulièrement le parti du MPLA, le « Éme-Pé-Là » dans la traduction sonore d’Élisabeth Monteiro Rodrigues et scande à l’envie ses formules (« Que la lutte continue ! » ; « LE ÉME-PÉ-LÀ EST LE PEUPLE LE PEUPLE EST LE ÉME-PÉ-LÀ » ; « La lutte ! /– CONTINUE ! / – La Victoire ! /– EST CERTAINE ! » ; « MPLA LA VICTOIRE EST CERTAINE »). Aussi, en filigrane, il participe d’une « histoire des vainqueurs », comme le rappelait Christine Messiant à propos de l’écriture officielle de l’histoire de MPLA [1] (vainqueurs à plusieurs titres : puisque non seulement de la guerre coloniale mais aussi de la lutte entre les différents mouvements de libération, le FNLA et l’Unita).
Dans l’étonnant récit « Cinq jour après l’Indépendance », les quelques jours qui précèdent et suivent l’indépendance sont comme une laisse de mer, une sorte d’entre-deux d’où le meilleur et le pire peuvent encore jaillir, espace-temps qui opère selon ses propres coordonnées et où le régime de l’attente, de l’inquiétude et de la veille domine (avant l’attaque, avant d’être découvert dans son abri par des forces adverses), mais aussi milieu particulier et propice au déploiement de l’indétermination et de l’inquiétude. Et certains ne pourront déployer leur talent que dans cet entre-deux-là, non qu’ils puissent prospérer en temps de paix, mais parce qu’à peine révélés dans le courage de leur jeunesse ils retourneront à l’ombre et à l’anonymat, touchés à leur tour par ces balles perdues qui sont autant de points finals orchestrant les lacunes du récit, les disparitions soudaines et le chaos de ce temps.

Souvent, l’écrivain passe le récit de la révolution au crible de l’humour et du récit saccadé. Cela commence par l’ironie savoureuse de faire venir en Afrique une montre en or, « automatique, lumineuse, fabriquée en Suisse », achetée au Portugal, vendue à Luanda, personnage principal de l’un des récits. Or l’Afrique neutralise le temps et l’Occident avec : la montre suisse, si parfaite dans son fonctionnement, sa machinerie, son luxe, n’a de valeur que symbolique. Passée de main en main, d’un camp à l’autre, « d’un général portugais mort au combat » au raconteur angolais de l’histoire, le « Camarade Commandant », pour terminer « au poignet d’un chef de police soûl et… corrompu » zaïrois, sa vocation est de constituer in fine un trophée dérisoire : échoué, comme le temps, à la frontière en un lieu où nul atelier de réparation ne saurait le faire repartir en cas de faiblesse, sinon celui de la fabrique collective. Face à la mer, faisant cercle autour du camarade commandant mutilé, le chœur d’enfants écoute tout autant qu’il coupe le récit connu par cœur, pour mieux en attiser les détails, y mimer les épisodes d’embuscades et de fusillades, en décélérer la fin, mais surtout en savourer la teneur de réel et de fiction tout ensemble. Ainsi, la montre est matière de récit, matrice d’interruptions et de suspensions du réel à la légende, de la guerre à la littérature, elle finit même par être remplacée par une autre montre à la main du conteur, et peu importe au fond. Car la montre qui demeure, c’est celle « qui dans le cœur de chacun ne s’arrêtait plus dans son tictaquement automatique, doré de rêve et de fantaisie », quand « personne ne voulait, cette fois-là, donner une fin définitive à l’histoire de la montre », cette « histoire qui naviguait dans la bouche des petits comme un bateau de musique sur une mer d’arc-en-ciel ».
Le travail d’Élisabeth Monteiro Rodrigues, qui a remarquablement traduit Mia Couto (La pluie ébahie, Histoires rêvérées) et sa langue aussi précise qu’inventive et singulière, est particulièrement précieux pour le lecteur, le guidant avec finesse et discrétion à travers la complexité réelle du texte, de ses enjeux poétiques, politiques, idéologiques. Elle laisse place à l’invention avec souplesse, recourt ponctuellement au néologisme pour rendre les sonorités, les textures et la plasticité de la langue portugaise (le « chouchouaillement » végétal pour xuxualhar, les tirs « déréussis » plutôt que ratés, les verbes « kandonguer » pour kandonguar, « faire le marché noir », et « malaugurer un enfant à la morgue »), pariant sur la capacité de la langue française à rendre audible le portugais écrit depuis l’Angola. Elle refuse d’effacer la façon dont le kimbundu y afflue continuellement et le façonne en profondeur, sans le démarquer par l’italique comme apport étranger : le musseque [bidonville], la maka [dispute], la mazukuta [danse populaire], la kionga [prison, caserne]. Elle accompagne ainsi par des choix forts l’avancée récente de la littérature angolaise dans la langue française à travers les traductions d’Ondjaki (Les transparents, Metailié, 2015 ; Bonjour Camarade, La Joie de lire, 2003), d’Agualusa (Le marchand de passés, 2006, Barroco Tropical, 2011, Théorie générale de l’oubli, 2014, La reine Ginga, 2017, tous aux éditions Métailié) et de Pepetela (Yaka, réédité en 2011 par Aden, traduit depuis 1984) survenues depuis une quinzaine d’années. Et plus encore, ce souci de saisir la co-présence des langues bantoues dans la langue portugaise permet de mieux mesurer l’altérité et le dialogue avec l’autre rive : celle de la littérature portugaise contemporaine où António Lobo Antunes (Comissão das Lágrimas, Dom Quixote, 2011, pour ne citer qu’un livre), Maria Dulce Cardoso (Le retour, Stock, 2014), Lídia Jorge (Les mémorables, Métailié, 2015), Pedro Rosa Mendes (Baie des tigres, Métailié, 2001) font retour chacun à sa manière, par la fiction et le récit, aux années de déroute de la dictature et d’indépendance des colonies – qui, à Luanda et à ses zones obscures, qui aux Retournés des colonies arrivés un matin de 1975 sur les quais de Lisbonne, qui encore à l’historiographie portugaise de la révolution des Œillets, du 25 avril 1974, qui aux stigmates, aux paysages et aux mémoires angolaises mouvementées, en traversant le pays en 1997 pour rejoindre le Mozambique. Ils montrent ainsi combien ces deux pays n’en ont pas fini, loin s’en faut, avec leurs histoires officielles et leurs revenances contrariées dans la littérature et combien, sur le terrain où elle opère, la littérature est imprévisible.
-
Christine Messiant, « Chez nous, même le passé est imprévisible », dans L’Angola postcolonial, Karthala, coll. « Les Afriques », 2008, p. 153-202.