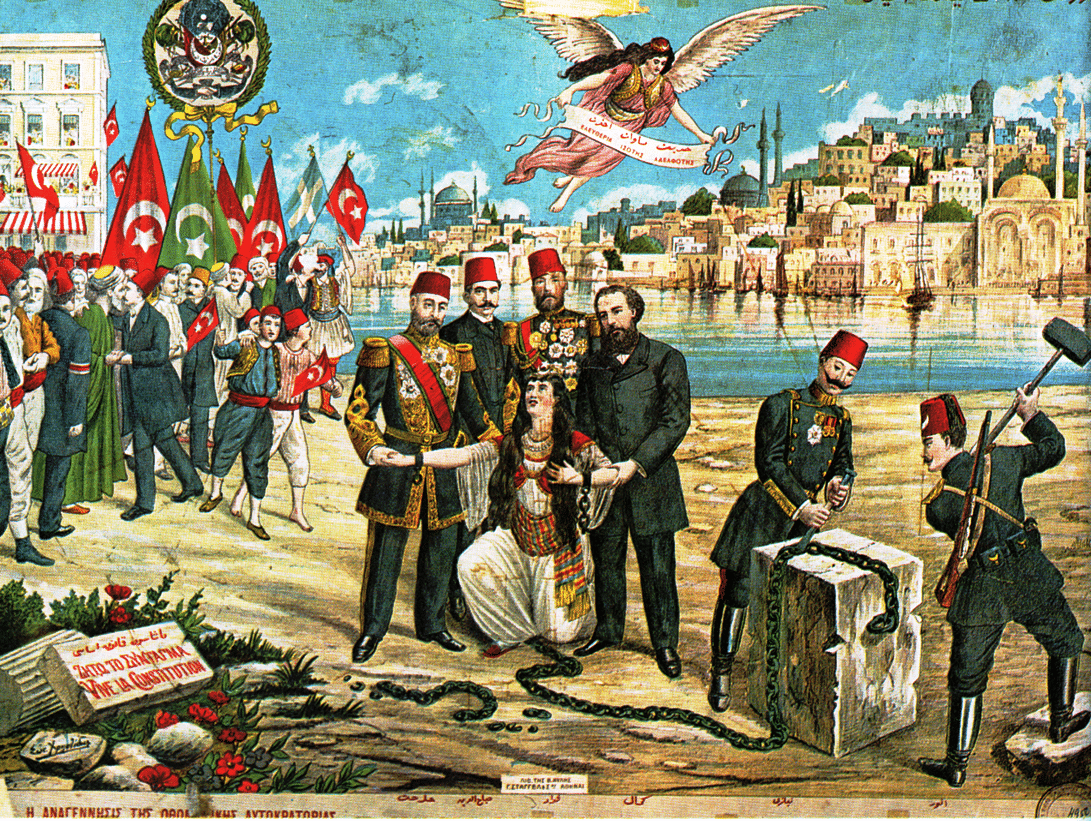On dirait que cette ville n’existe plus. Aline Cateux termine Mostar : ceci n’est pas une ville en la disant « innommable » : « on sait ce qu’elle n’est plus », mais « on ne sait pas comment l’appeler ». Pourtant, elle est toujours habitée. Plus de trente ans après des guerres impitoyables conduites par les ethno-nationalistes serbes puis croates, une grande partie de ses habitants ont été déplacés, d’autres ont fui ou ont été tués, emprisonnés, dénoncés par des voisins sur critères ethniques.
Au sud de la Bosnie-Herzégovine, Mostar n’est plus la jolie petite ville multiculturelle que j’avais connue dans les années 1970. Elle est toujours traversée par le fleuve Neretva, unie par un pont construit au XVIe siècle du temps de l’occupation ottomane. Un pont au cœur de la vieille ville, qui a résisté aux combats de la Seconde Guerre mondiale, mais que la rage ethno-nationaliste des années 1990 a détruit. Depuis, il a été reconstruit pour les touristes.
L’anthropologue Aline Cateux, autrice d’une remarquable série radiophonique sur « la solitude des Bosniens », a rencontré Mostar par hasard, à la fin des huit années de guerres yougoslaves, en juillet 1999. Elle rentrait d’une mission humanitaire auprès des femmes de Srebrenica. À peine arrivée dans la vallée, elle est saisie d’effroi par les destructions, les traces de balles, les usines rasées, les églises debout et les minarets des mosquées à terre. Dans la vieille ville, elle remarque la rivière, les ruines du vieux pont détruit par l’artillerie croate, et une passerelle branlante qui l’a remplacé. On estime à 80 % de la ville les destructions de la guerre. La réaction devant la passerelle de son amie originaire de Mostar, qui revenait pour la première fois depuis la guerre, la trouble : elle « fait un petit malaise, elle ne veut pas traverser, elle veut partir, elle veut sortir de la ville ».
Après cette visite, Aline Cateux s’est posé une question qui l’a habitée des années durant : « Que se passe-t-il ici ? » Elle veut savoir comment cette ville a disparu, en ne se limitant pas à la destruction des bâtiments. Il y a eu d’importants changements démographiques. 60 % de la population a été déplacée puis restructurée par le nettoyage ethnique et l’arrivée de déplacés d’ailleurs. Elle constate comment les Mostariens ont vécu, de « façon brutale », une « reconstruction incomprise » devenue « une entreprise de remplacement ». Sans oublier les « politiques mémorielles déployées après la guerre qui ont réussi à séparer les Bosniens et à anesthésier les consciences des crimes commis ». Tout ce qui pourrait ressembler à une mémoire yougoslave a été effacé au profit des discours nationalistes.
Pendant plus de vingt ans, Aline Cateux est revenue régulièrement. Charmée, amoureuse du lieu et des gens rencontrés, elle a habité Mostar, appris la langue, marché dans les rues, interrogé tout ce qui pouvait l’être. Jusqu’à ce que, comme son amie revenue pour la première fois en 1999, elle ait envie de partir, elle aussi, épuisée. Son livre nous fait découvrir, au fil des années, l’évolution d’une ville ravagée, ses charmes, ses conflits, ses chagrins, ce qui reste de son imaginaire. Il met au jour la ville invisible tout en se détachant des discours mémoriels habituels. D’emblée, l’autrice avertit ses lecteurs : « Je suis écœurée du flot de touristes et de journalistes qui passent par Mostar, qui posent sans cesse les mêmes questions… », qui réduisent les Mostariens à leur appartenance ethnique.
Au contraire, elle a entrepris une enquête anthropologique approfondie, devenue le sujet de sa thèse, et qu’elle nous fait partager avec talent dans un livre aussi rigoureux qu’émouvant. Il est conçu à partir de deux mouvements : les « désorientations » produites par les ruines et la disparition de repères spatiaux, de paysages familiers, de l’esprit de la ville ; et les « reconfigurations » c’est-à-dire la reconstruction produite par qui, et pour qui ? Elle s’est promenée dans les rues et sur les traces de rues, seule ou en compagnie d’habitants avec lesquels elle a entretenu des amitiés et de longues conversations, sans poser de questions sur la guerre, à eux d’en prendre l’initiative. Il faut dire que, vingt ou trente ans après, elle est toujours là.

Durant les dix mois de siège en 1993, le partage entre Mostar Ouest aux mains des nationalistes croates et Mostar Est bombardé a dessiné une ligne de front. Les milices croates ont fait vivre un calvaire aux populations non croates (humiliations, famine, tortures, viols, déportations), et personne ne l’a oublié, d’autant qu’aujourd’hui nombre des responsables de cette guerre se sont reconvertis en démocrates champions de la réconciliation. En marchant dans la partie Ouest, Aline Cateux découvre une partie « agréable, ombragée, spacieuse, des petits quartiers de maisons cachées… », mais il lui faut quelques années pour cesser d’être irritée. « Jusqu’au début des années 2010, écrit-elle, on perçoit de grandes différences avec la partie Est. » La peur et les traumatismes sont là. C’est le cas à propos du pont, par exemple.
Le 9 novembre 1993, l’artillerie croate le détruit. Beaucoup de Mostariens ressentent un terrible choc, la perte du pont c’est la perte de la ville. Au début des années 2000, l’Union européenne « présente la reconstruction du Pont comme celle d’un lieu de rencontres dans Mostar qui en manque cruellement. Une fois ces rencontres rendues possibles, la réconciliation ne devrait pas tarder ». Discours démagogique ! Le pont est reconstruit, sa forme critiquée, et la réconciliation n’y est pas. Ce pont n’est qu’un lieu de passage, et une référence obligatoire dans les discours publics, un objet touristique.
Les reconfigurations sont encore plus affligeantes. Qui en décide ? « Après la guerre, plusieurs choses divisent la population de Mostar : leur ethnicité, leur lieu de résidence, leur expérience de la guerre. Cette dernière est particulièrement cruciale dès lors qu’il s’agit de déterminer qui a la légitimité pour s’exprimer et qui doit se taire. » En naissent des situations et conflits complexes racontés par Aline Cateux. Pour elle, cette reconstruction est également une forme de destruction qui « asphyxie ses habitants », la poursuite par d’autres moyens de l’effacement de la ville. Elle cite plusieurs initiatives aux graves conséquences – fermetures d’usines, « rétrécissement des espaces détruits par le tourisme », disparition des jardins et des parcs, impunité et corruption –, comme cet hôpital transformé en un centre commercial alors que le système de santé est un vrai désastre. « Tu réfléchis dix fois avant d’aller à l’hosto », lui dit-on. Ou bien l’abandon d’autres lieux transformés en décharges publiques, les autorités municipales n’ayant guère pris en charge la collecte des ordures. Il y en a tout au long du fleuve, là où jadis on se promenait avec ses enfants, où l’on donnait ses rendez-vous amoureux. L’une d’elles, la plus importante décharge, empeste et empoissonne l’environnement malgré les mouvements de protestation. C’est une « bombe écologique », affirme un des contestataires, alors que la municipalité et le gouvernement n’ont toujours rien mis en œuvre en 2022. Ce qui l’amène à cette question : « Que faire face à un État défaillant et hostile ? » Car évidemment, derrière cette sinistre réalité, grouillent la corruption et les petits arrangements.
La reconfiguration passe par de nombreux projets ou conflits qui détruisent ce qui reste. Ils volent la ville à ses habitants de plus en plus découragés, ils y substituent un autre monde dans lequel les Mostariens d’hier ne se reconnaissent pas, nostalgiques de « l’esprit de la ville » probablement disparu. Les actions judiciaires n’aboutissent jamais, les partis ethno-nationalistes contrôlent les tribunaux, ce qui « a fini par décourager une très grande majorité de Bosniens ». La désespérance gagne. « C’est désormais une certitude, constate Aline Cateux, pour les personnes avec qui je discute, il n’y a aucune issue, il n’y a aucun espoir. C’est, entre autres, ce qu’illustrent les départs massifs. »