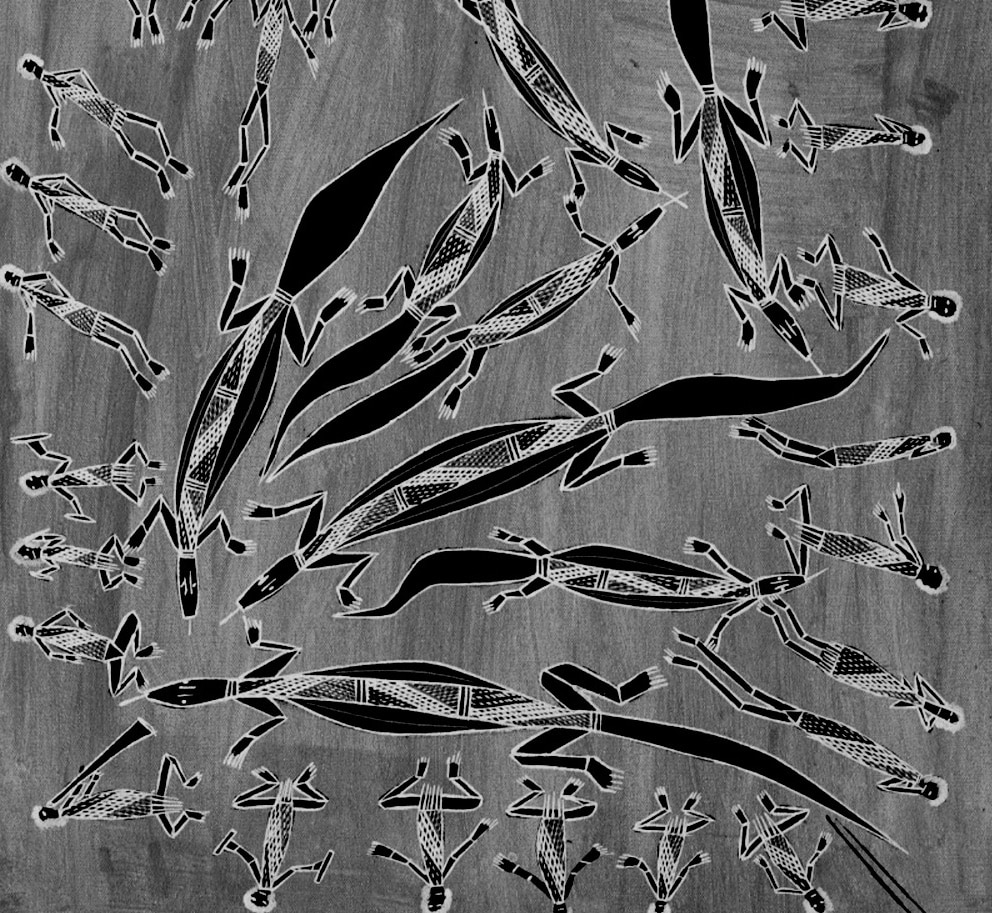Le livre de Clotilde Leguil apporte des lumières et des mots pour dire la complexité de la question du consentement et de la désobéissance qui concerne à la fois le champ des relations interpersonnelles amoureuses et sexuelles et celui des rapports politiques entre forces antagonistes. L’hypothèse fondamentale du livre est que rien ne peut être pensé de sérieux en ce domaine tant que l’on raisonne en termes d’entités figées entrant dans des relations formelles ou formalisables, mais qu’il est nécessaire, au contraire, de faire entrer en ligne de compte la dimension d’une temporalité au cours de laquelle les termes se déplacent, se transforment et les relations se métamorphosent.
Dans son particulièrement limpide et pertinent La doctrine du consentement, la philosophe espagnole Clara Serra a souligné combien la notion de consentement dans le contexte des relations sexuelles, qui est au cœur de propositions de lois dans différents pays d’Europe, était ambivalente et ne pouvait être prise en charge de manière satisfaisante dans une perspective contractualiste.
Non seulement le contexte culturel et politique patriarcal en général mais aussi le contexte plus singulier d’affaires où la situation même ne permet pas au consentement de s’énoncer interdisent à ce critère d’être suffisant, même s’il demeure l’horizon évident d’une préservation de la liberté individuelle : une évidence, mais pas un critère suffisant puisqu’il est souvent impossible de l’établir. Le tout contractuel ne permet pas de prendre en compte les situations (peut-être majoritaires) où la contractualisation – ou même l’explicitation – n’est tout simplement pas envisageable.
Mais, au-delà de la réforme juridique qui porte si heureusement sous le regard des institutions cette dimension de l’existence humaine depuis le succès du mouvement #MeToo (tendance fragile dont rien ne garantit qu’elle constitue un acquis définitif), le rapport entre les sexes repose sur une dynamique du désir dont la complexité, l’opacité et l’ambivalence ne trouveront jamais, pour reprendre les mots de Clara Serra, leur « espace d’existence sous la forme du contrat ». Ce n’est certes pas à un au-delà de la loi que les méandres du désir nous confrontent, au sens où ils s’en affranchiraient légitimement, mais c’est à un autre type d’au-delà, celui du Freud d’Au-delà du principe de plaisir, celui, pourrait-on dire, de l’inconscient de l’esprit des lois cher à Montesquieu.
En ce sens, le livre de Clotilde Leguil, La déprise. Essai sur les ressorts intimes de la désobéissance, semble venir, comme par une harmonie préétablie, compléter les travaux des féministes et creuser cette zone d’ombre qu’elles désignent comme limite au geste juridique toujours déjà trop patriarcal. Ce livre, en effet, troisième volet d’une sorte de trilogie (Céder n’est pas consentir, 2021, L’ère du toxique, 2023), parachève le panorama de la relation amoureuse à partir du regard que la période contemporaine porte sur la permanente éventualité de la violence qui peut surgir en elle et des traumatismes qui en découlent.

Après avoir analysé la toxicité toujours possible dans cette folie à deux, Leguil s’intéresse plutôt pour finir à la dialectique très subtile qui permet d’en sortir. Loin de rejeter de manière puritaine le dérèglement psychique induit par cet état amoureux, elle en restitue la positivité, montrant qu’il est toujours aussi une déprise de soi qui permet, dans la rencontre d’un autre qui déstabilise, de sortir de soi et d’échapper à ses propres limites. Mais cette situation de vulnérabilité prometteuse et créatrice a son envers qui met l’amoureux ou l’amoureuse à la merci d’une dépendance toujours possible qui fera du désir de l’autre la loi venant gouverner une volonté aliénée ayant perdu contact avec son propre désir.
Prenant comme leitmotiv la formule de l’incontournable Lacan, « ne pas céder sur son désir », Clotilde Leguil montre que c’est en désobéissant à l’obscure autorité de l’autre réel, lui-même relayant une dépendance plus archaïque, que l’amoureux/se peut renouer ou même plutôt reconstruire son désir à l’abri de toute injonction toxique, de toute emprise (qui va de la servitude ordinaire, moteur du couple endormi dans ses habitudes, à la grande et violente relation maltraitante qui peut aller jusqu’au féminicide). Ce pas de côté, qui n’est rien d’autre qu’une manière d’affronter l’universelle dépendance de la psyché humaine par rapport à la parole, ne peut se faire que par un travail sur la parole elle-même (la cure analytique en étant une modalité privilégiée) qui fasse apparaître son ambivalence profonde, sa polysémie en quelque sorte, qui interdit de la réduire à un message unique et qui substitue à la grosse voix de l’emprise monolithique la polyphonie poétique qui ouvre sur un autre destin possible.
Ainsi la rencontre amoureuse peut-elle aboutir à une réinvention d’un soi-même s’étant détaché des automatismes et des répétitions anciennes à condition de ne pas les avoir remplacées par des servitudes nouvelles. Tel est le sens de la déprise qui ne fonde pas le sujet sur une maîtrise mais sur un devenir autre, tout autre, au prix d’un affrontement avec l’Autre (le symbolique, le langage) qui se donne les moyens de ne pas le rencontrer comme un Un (discours monolithique, personnalité charismatique qui nous sauverait du chaos du monde et des pulsions) mais comme un autre, c’est-à-dire un multiple, un lieu de bifurcations, un compagnon d’aventures.
On voit que cette problématique, qui, à un certain niveau, peut sembler un honnête manuel de la bonne rencontre pour les jeunes filles, côtoie des problématiques plus politico-économiques et s’attache à déplier le fonctionnement de cet oxymore, introduit dans la culture occidentale par La Boétie, de la servitude volontaire. Au cœur du livre, le chapitre 5 qui lui est consacré fourmille de réflexions éclairantes sur le rôle de la voix dans l’emprise, tant psychique que politique : la voix en tant qu’elle est ce qui du langage atteint le corps et le traverse. Comme le dit Lacan, « tout ce que le sujet reçoit de l’Autre par le langage, l’expérience ordinaire est qu’il le reçoit sous forme vocale ».

Cette résonance de la voix de l’Autre dans le corps est l’un des ressorts par où l’obéissance s’insinue au plus profond du comportement d’un être qui sent en lui comme une vibration qui l’habite : associée à la genèse du surmoi, voix de la (mauvaise) conscience, elle permet de comprendre que la psyché humaine n’obéit pas seulement, comme l’établit Kant, à la loi morale, mais que cette loi lui enjoint de découpler son désir de sa jouissance et d’admettre que, pour faire face au risque de la séparation, de la perte, de la privation, il doit être prêt à tout, et notamment à céder à l’emprise de l’Un qui le comble (lui attribue une identité, lui assigne une place) tout en l’asservissant.
La jouissance, c’est la passion de l’identité au détriment du plaisir. La passion de l’identité qui l’emporte dans l’emprise, c’est le fait d’être habité par le désir de l’autre dans des proportions qui occultent, et peuvent aller jusqu’à effacer le désir originaire, c’est-à-dire une expression de la pulsionnalité, toujours déjà passée sous les fourches de l’autrification, mais qui n’est pas identité, mais multiplicité inquiétante et affolante. Si aucun moyen (aucun « bon encontre ») n’est à disposition pour l’affronter, la canaliser ou l’orienter dans le sens d’une singularité à trouver, il lui est plus facile alors de se « précipiter » (au sens chimique) dans l’ornière du désir de l’autre qui offre une forme Une, une identité toute faite, antidote au morcellement, rassurante et apaisante, réunissante et hantée par le retour à l’inerte (la pulsion de mort).
L’Autre des foules, le chef, ou l’autre de la relation amoureuse qui s’enlise dans la dépendance à l’égard du compagnon mortifère. La mauvaise nouvelle est donc que l’emprise s’articule à une jouissance, dont on pourrait donner comme illustration dans le champ du politique : « plutôt Hitler que le Front populaire », plutôt le fascisme que l’acceptation du multiple, de la multiplicité, de l’immigration, de la présence de l’autre, de la rencontre qui entraîne au-delà de soi même vers des désirs inédits, inouïs… L’inouï justement dont Clotilde Leguil montre si bien comment, au cœur de cette « ob-ouïssance » qu’il renverse en une désob-ouïsance, il ouvre sur la déprise qui engendre l’émancipation. Manifeste pour une émancipation amoureuse qui réintroduit la temporalité dans les méandres de l’identité et l’histoire dans ceux des nationalités et permet aux amoureux d’envisager, sinon de réaliser tout de suite, une autre vie, et aux peuples un autre monde.
Sans doute pourrait-on désirer que cette analyse soit moins européo-centrée, que la Chine par exemple, très fugacement évoquée, ou le reste du monde, et l’emprise impérialiste qui le domine, y aient au moins autant de place que Flaubert ou Camus. Mais c’est justement sur un film japonais que se termine le propos et sur une image lumineuse de la désobéissance.